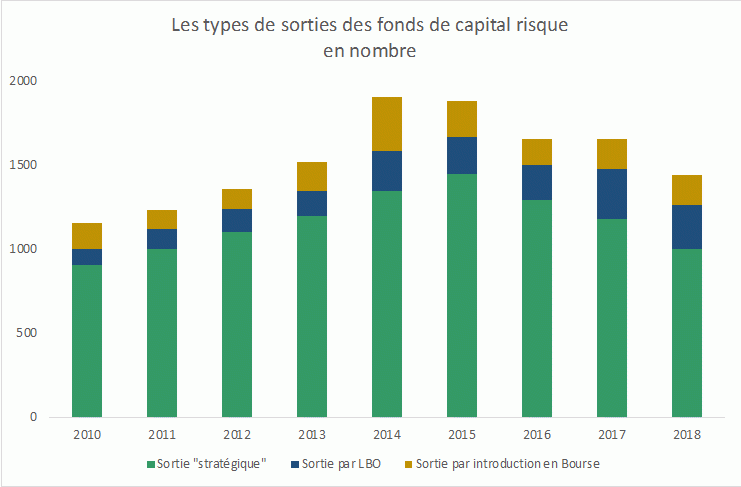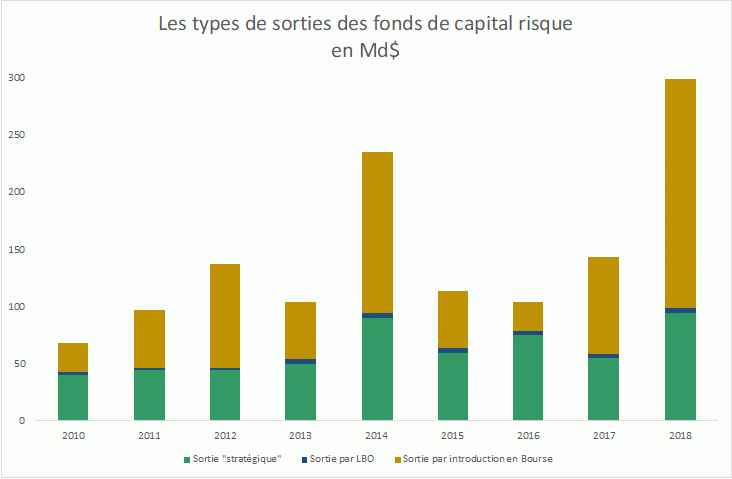La Lettre n°173 de Novembre 2019
Actualités : Compte rendu de la table ronde « La désaffection pour les marchés boursiers et la montée des investissements non cotés »
A l’occasion de la parution de la nouvelle édition du Vernimmen, que nous avons ouvert cette année par un avant-propos sur la désaffection pour les marchés boursiers et la montée des investissements non cotés[1], nous avons organisé une table ronde à laquelle participait Monique Cohen, Associé d’Apax Partners, administrateur de Safran, BNP Paribas et Hermès.
En voici la transcription de son intervention (les notes de bas de page sont de la rédaction).
Vernimmen.net : Monique, cela fait une vingtaine d'années que tu travailles chez Apax, qui est l'un des pionniers en France et en Europe du capital investissement. Tu as une double casquette d'ailleurs, puisque tu es aussi administratrice indépendante d'Hermès, de BNP Paribas, de Safran, et tu es aussi administratrice pour les participations que tu suis et dans lesquelles tu as investi. Puis, pendant longtemps, tu as été directrice générale d'Altamir, qui était une idée innovatrice du fondateur d'Apax France de dire « Je veux offrir, par la bourse, l'accès au private equity au plus grand nombre ». Pour quelles raisons ? Et quel bilan fais-tu vingt ans après ?
Monique Cohen : Plusieurs points. Avant de rejoindre le private equity, je me suis occupée chez Paribas de mettre en bourse des sociétés. Donc pendant quinze ans, je me suis occupée du côté, pour ensuite pendant vingt ans, m’occuper du non-coté.
Quand j'étais responsable des introductions en bourse chez Paribas, je refusais systématiquement de coter en bourse les petites sociétés au motif que, quelque part, elles seraient très déçues une fois la cotation passée, parce que justement, dès lors que le flottant est très faible en montant, les investisseurs, très rapidement, se désintéressent du sujet, les analystes financiers ne suivent plus le fil et quelque part, la cotation n'a plus de sens.
Historiquement, mes premiers échanges avec Apax étaient fondés sur des refus d'accepter d'introduire en bourse des sociétés qu'ils avaient en portefeuille. Et c'est ce que Maurice Tchenio[2] m’a rappelé quand il m'a recrutée. Et a posteriori, j'avais raison. En effet, toutes ces sociétés cotées par des confrères ont eu des parcours boursiers pas très flamboyants, simplement parce qu'elles n'ont pas changé de dimension et qu'elles sont restées un peu ternes en bourse, sans beaucoup de suivi.
Alors maintenant, pour répondre précisément à la question. Altamir a été créé dans les années 1990 par le fondateur d'Apax, Maurice Tchénio. Et c'était effectivement une idée géniale parce qu'il était convaincu que, pour un particulier, il était plus intéressant d'atteindre le non-coté de manière diversifiée. Surtout si la structure avait des caractéristiques suffisamment transparentes et suffisamment motivantes fiscalement, ce qui était le cas puisque Altamir est une société de capital risque, c'est-à-dire une sorte de PEA dans le non-coté. Si vous achetez des titres Altamir et que vous les détenez pendant cinq ans, comme votre PEA, les plus-values qui sont réalisées par la structure ne sont pas imposées. Donc c'est extrêmement intéressant. Et comme Altamir était à l'époque un véhicule qui co-investissait avec les fonds fermés levés par les équipes d'Apax, cela nous permettait à nous d'investir un montant plus important. On investissait 500 millions levés auprès d'investisseurs du non-coté et 500 millions qui étaient la valeur evergreen Altamir. Donc on gérait un milliard. Et Altamir prenait systématiquement des positions à côté de celles que l'on mettait dans nos fonds non cotés.
Depuis l'objet a un peu évolué, et aujourd'hui Altamir est un fonds de fonds, ce qui est très différent. Mais au départ, le concept était extrêmement porteur et malheureusement, ce qui s’est passé, c'est que c'était un véhicule là encore trop petit. Je me suis appliquée à le faire grossir quand j'ai rejoint Apax en montant des opérations de marché successives, c'était mon savoir-faire. Mais quelque part, c'est un véhicule qui aurait vocation à peser plus d’un milliard. Il y a une décote d’illiquidité, une décote de holding qui diminue un peu la valorisation optimum du portefeuille.
Vernimmen.net : Et de ton expérience, comment réagissent des dirigeants d’entreprises de petite taille cotées en Bourse et qui se sentent délaissées, incomprises et mal valorisées ?
Monique Cohen : J’ai connu des dirigeants d'entreprise très affectés par le fait qu'avec quelques échanges, leurs cours de bourse perdaient 40 % sans que fondamentalement le message, les résultats, la stratégie ne le justifient. Arriver à ne pas être atteint par ça, c'est bien, et c'est extrêmement important.
Mais quelque part aussi, c'est un petit peu un cercle vicieux. Parce que si le cours de bourse est trop bas, la bourse ne jouera pas son rôle puisque l’entrepreneur n'aura pas envie de lever de l'argent à un niveau très décoté. Si l’entrepreneur est convaincu que la bourse n'offre pas le prix qu’il juge être le prix de son entreprise, est-ce qu’il acceptera d'être dilué par l'augmentation de capital dont il aura besoin pour son développement ?
Et donc, là, je passe le petit message private equity. À ce moment-là, il faudra trouver le bon fonds d'investissement qui acceptera de faire un retrait de cote parce que ça, c'est une gymnastique classique : on met en bourse, on retire de bourse et ainsi de suite. Et puis, les gens oublient que l’entreprise a été cotée en bourse. J'ai parlé à un banquier récemment qui me parlait de la Coface et quand je lui ai dit que j'avais fait la mise en bourse de la Coface en 1999, il m'a regardé en disant : « Coface a déjà été cotée ? » Coface a été cotée, retirée de cote, recotée. Voyez, on s'amuse beaucoup à ce type de choses, ça occupe.
Mais quelque part, le fait de trouver le bon fonds de private equity demandera à l’entrepreneur d'accepter une gouvernance différente. Là aussi, vous avez dit ne pas avoir trop envie d'avoir des administrateurs dans votre tour de table. Je pense qu'un bon fonds de private equity, et là c'est un petit moment de publicité pour Apax, un bon fonds de private equity est très utile en gouvernance, dans le fait de dialoguer avec le dirigeant sur une stratégie. C’est un partenaire totalement aligné avec le management, pour l’aider à réfléchir. Je pense qu'on réfléchit mieux à deux que tout seul. Et qu’un bon fonds de private equity, ça sert également à ça. Simplement, ça regarde un peu ce qui se passe dans la cuisine, voilà.
Vernimmen.net : Ne reproche-t-on pas aux fonds du non coté de penser à la sortie à peine entrés dans le capital de l’entreprise et d’avoir un horizon de temps qui peut être différent de celui de l’entrepreneur ?
Monique Cohen : Mais la stratégie de sortie, parce que ça semble un peu un épouvantail, ça tient à la notion même de fonds d'investissement. Un fonds, c'est de l'argent qui a été collecté auprès de mandants à qui il faut rendre cet argent. Et il vaut mieux leur en rendre plus que ce qu'ils vous ont confié pour qu'ils reviennent dans le fonds suivant. L'horizon de sortie est normalement à cinq ans. J'ai connu des époques où Apax accompagnait les sociétés sur sept ans, dix ans. Il n'y a pas d'obligation. Simplement si vous gardez trop longtemps votre participation, que vous ne rendez pas l'argent, les fonds de pension qui vous ont confié cet argent sont un peu plus réticents à investir dans votre fonds suivant, parce que tout va très vite aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez une société en portefeuille depuis deux ans, on commence à s'inquiéter en vous posant des questions aberrantes du type « Qu'est ce qui se passe de travers dans la société dans laquelle tu as investi ? »
Vernimmen.net : Il y a deux Monique Cohen, celle d’Apax et l’administratrice indépendante. C'est la même personne ? C'est le même comportement ? Est-ce les mêmes questions que tu poses pendant les séances du conseil, dans les réunions avec les dirigeants ?
Monique Cohen : J’essaie d’être la même, de ne pas être frappée d’une forme de schizophrénie en entrant dans les différents conseils d'administration. En fait, la réalité, c'est que les enjeux ne sont pas les mêmes. Lorsque je suis administrateur dans une société dans laquelle mon fonds est investisseur, et généralement Apax est un actionnaire majoritaire, c'est un actionnaire déterminant pour l'entreprise. Le poids de ce que je vais demander, de ce que je vais dire est totalement différent du poids que je peux avoir lorsque je m'exprime autour de la table en tant qu'administrateur indépendant chez BNP Paribas, chez Safran, chez Hermès ou quand j'étais administrateur chez JC Decaux.
Je pense que ça ne peut pas être la même manière de s'exprimer, puisque ça n'a pas la même autorité, ça n'a pas le même poids. D'un autre côté, un administrateur indépendant dans un groupe coté a une responsabilité extrêmement importante parce qu’il est responsable, bien sûr, de la qualité de l'information financière qui est transmise, de son approche des risques et de son approche de la fiabilité des processus qui sont menés dans l'entreprise ; mais il est là aussi pour représenter un contrepoids aux opérationnels. C'est ce qui forme une bonne gouvernance.
Je pense qu’un conseil d'administration d'un grand groupe doit être équipé d’administrateurs capables de poser les bonnes questions aux dirigeants, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe dans la cuisine, ou en tout cas, de montrer leur intention de comprendre ce qui se passe dans la cuisine, comme je le fais dans les sociétés dans lesquelles je suis investisseur. Si ce n’est pas le cas, c'est la porte ouverte à des dérives dont on a vu l'illustration dans certains grands groupes français, malheureusement. Donc, il faut rester capable de poser les bonnes questions. Donc, ça veut dire travailler, lire les dossiers et rester pertinent dans sa compréhension de ce qui se passe, sans pour autant confondre opérationnel et administrateur.
Vernimmen.net : Monique, crois-tu à l'avenir des fonds d'investissement cotés en bourse qui investissent dans des PME ? Si les PME ne vont plus en bourse, vois-tu cela se développer ?
Monique Cohen : Je vois tellement cela se développer que nous venons de lancer, chez Apax, un fonds qui s'appelle Comitium dont on a obtenu l'agrément AMF. Ce sera donc une structure de gestion totalement indépendante d'Apax, avec un agrément spécifique encore une fois. Nous avons recruté deux gérants et l'objectif de ce projet est de lever un fonds dont la vocation sera de prendre des participations, disons, de référence, entre 10 et 20 % dans des sociétés de taille moyenne cotées, dévalorisées, ou en tout cas sous-valorisées par le marché aujourd'hui. Les deux gérants vont travailler suivant les quatre secteurs qui sont les secteurs d'expertise d'Apax et les associés d'Apax, spécialistes de ces secteurs, travailleront avec les gérants, le moment venu, ces derniers seront éventuellement administrateurs des sociétés dans lesquelles nous aurons investi. L'idée étant d'apporter à ces sociétés qui resteront cotées, qui sont des sociétés encore une fois de taille moyenne, le savoir-faire du non-coté dans le côté. Nous l'avons réussi, je pense, dans des sociétés comme Altran, comme GFI, comme Albioma.
Et notre intention n'est plus de le faire dans nos fonds actuels, parce que nos mandants n'apprécient pas du tout le mark to market, ce n’est pas encore du mark to planet[3], mais c'est bêtement du mark to market. Et ça, c'est un verdict, le mark to market est beaucoup trop volatil pour les gens qui investissent dans le private equity. Donc, lorsqu'on a fait une incursion dans le coté sans réussir à sortir les sociétés de bourse, on s'est trouvé coincé par le mark to market de ces lignes, alors qu'on était très conscient du travail qu'on accomplissait dans les entreprises et qui n'était pas relayé par la valorisation que donnait le marché. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré avoir un projet très précis indépendant de nos autres fonds. Et ce projet, c’est Comitium. Comme tu vois, ma réponse est oui.
Vernimmen.net : J'ai une autre question pour toi, je ne sais pas si la réponse va être oui. Mes collègues chercheurs à HEC me disent toujours : « Pascal, méfie-toi des fonds d'investissement, quand ils introduisent en bourse des sociétés, c’est qu’ils n’ont pas trouvé d'autres solutions et ils ne laissent pas d'argent sur la table ». Ne pas laisser de l'argent sur la table veut dire que l’on introduit l’entreprise au plus haut possible de sa valorisation, et justement le premier jour de cotation, ça ne monte pas beaucoup et cela baisse plutôt. Est-ce ton sentiment ?
Monique Cohen : Ce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance des marchés cotés dans le secteur non-coté est très peu répandue, je pense. En tant qu'associée d'un grand fonds à Paris, je dois être la seule à avoir le passé boursier que j'ai, quinze ans dans le coté, vingt ans dans le non-coté. Je ne pense pas qu'il y ait d’autres exemples, à part André François-Poncet, qui avait aussi une bonne compréhension des marchés chez BC et maintenant chez Wendel. Je pense qu'on est très, très peu nombreux à avoir cette expertise. Donc, il y a une très forte méfiance du non-coté envers le coté. Et pourquoi cette méfiance ? D'abord, par une incompréhension des mécanismes. Et puis, surtout quand on va choisir d'aller en bourse pour sortir, on ne pourra pas vendre 100 % de notre société. Il n'y a pas d'interdiction, mais cela n'est pas possible. Pratiquement, le maximum que vous puissiez proposer au marché, c'est 50 % des titres que vous détenez. Et donc se retrouver à avoir vendu 50 % a priori dans de bonnes conditions, sinon vous n'auriez pas accepté de le faire, c'est que la fenêtre a été opportunément ouverte et que les valorisations vous ont plu. Vous allez quand même rester avec 50 % qui, là, vont subir le mark to market. Et ça, c'est très pénible. Donc, contrairement à ce qu'on pense, sortir en bourse pour un fonds d'investissement, c'est vraiment une décision qui est prise parce qu'il y a d'autres contraintes. Parfois même la volonté du dirigeant qui y trouve une forme de notoriété qu'il souhaite avoir. C'est rarement le premier choix du fonds.
Question d’un participant dans la salle : Il y a une situation sur le private equity aujourd’hui qui peut vous faire des sources d’inquiétude. C’est que ça a été une classe d’actifs très rentable, mais la conséquence c’est qu’elle a tendance à préempter un peu la bourse. On l’a vu aux États-Unis où sur vingt ans le nombre de sociétés cotées a été divisé par deux, en passant de 8 000 à 4 000 environ, et on voit un peu les mêmes mécanismes qui arrivent en Europe avec un private equity qui prend un peu trop de place.
Monique Cohen : Préempter des mises en bourse. De même que j’indiquais que la sortie pour nous, l’alternative boursière, c’est toujours une alternative, on va essayer d’avoir en parallèle un processus pour vendre à un industriel ou à un autre fonds s’il a une histoire à raconter après nous.
Oui, le private equity essaiera d’être toujours une alternative, et nous chez Apax, dans la mesure où on a cette approche sectorielle, on est très régulièrement en amont sur les sujets où l’actionnaire, le dirigeant vont regarder ce que travailler avec Apax signifie et ce qu’aller en bourse signifie. Donc oui, vous avez tout à fait raison sur ce point.
Question d’un participant dans la salle : Serge Weinberg rappelait récemment qu’il trouvait que les prix payés par le private equity étaient peut-être trop élevés. Est-ce aussi votre avis ?
Monique Cohen : J'ai lu avec attention ce que Serge Weinberg a écrit. Il souligne que le contexte est extrêmement corrélé au niveau des taux d'intérêt actuels. Il est effectif qu'avec des taux qui maintenant sont considérés durablement bas, la valorisation des actifs réels monte énormément. Nous avons tous cette conviction dans le private equity que l’on est en train d'acquérir des actifs beaucoup plus chers qu'on ne le souhaiterait. C'est beaucoup plus satisfaisant pour nous d'acheter un actif en-dessous de 10 fois l’EBE qu’aujourd'hui entre 15 et 18, comme c'est le cas pour certains actifs de qualité avec un bon niveau de croissance.
Maintenant, comme il y a beaucoup d'argent qui afflue dans la classe d'actifs, toujours pour la même raison (recherche de rendement), il faut qu'on déploie l'argent qui nous est confié et donc ce qu'on essaie de faire pour rester réaliste, c'est « choisir nos combats ». C’est-à-dire véritablement décider sur quels sujets on va se battre pour acquérir l'actif, parce qu'on sait qu’il partira très cher. Ensuite, c’est d’avoir l'honnêteté, quand on fait nos simulations, de faire des projections de sorties, non pas comme les banquiers nous en montrent, les banquiers continuent à dire : « on paie cher mais on sort cher, à ce petit jeu, on gagne à tous les coups ». Donc, nous, ce que nous faisons pour nos comités d'investissement, c'est dire : je choisis ce combat, je vais payer un multiple d'entrée très élevé, parce que le contexte est ce qu’il est, il y a beaucoup d'argent et peu d'actifs de très bonne qualité. Mais je fais des simulations de sortie à cinq ans, à six ans, à sept ans avec des baisses significatives de multiples. On passe énormément de temps à regarder quels sont les multiples historiques, à regarder les périodes où les multiples ont été les plus bas. Et c'est seulement lorsqu'on a fait ce travail et qu'on est convaincu qu'on va quand même offrir à nos mandants un retour suffisant au bout de cinq ans, même si au lieu de sortir à 15 fois l’EBE, on sort à 11. Ce n’est que là qu'on va se décider à pousser les feux. Mais le contexte est ce qu'il est. Encore une fois, il faut qu'on déploie l'argent.
Question d’un participant dans la salle : Quelle est votre approche ESG ? Est-elle différente de celles des sociétés cotées et comment intégrez-vous cela dans vos investissements ?
Monique Cohen : Le thème ESG, j’en suis tout à fait convaincue, est un thème qui va s'imposer de plus en plus et ça va aller très très vite parce que, pour l'instant, c'est encore un peu du tick the box, mais ça va devenir incontournable. Chez Apax, nous avons depuis sept ans une approche ESG méthodique. On a très tôt signé les PRI[4], et on a un responsable ESG dans la société de gestion qui a tout d’abord établi un diagnostic sur la société de gestion elle-même, nos dépenses carbone, voir combien d’arbres il fallait qu’on plante en compensation, etc. (ils sont essentiellement liés aux voyages que nous effectuons, nous, et que nous faisons effectuer à nos différents consultants). Donc on a fait beaucoup de travail sur nous-mêmes. Il a ensuite piloté la mise en place d'une feuille de route ESG dans chacune des sociétés que nous avons en portefeuille. C'est extrêmement important, parce que nous rendons compte tous les trimestres à nos investisseurs sur les chiffres réalisés. Nous avons un paragraphe entier sur la manière dont la feuille de route qu’on leur a présentée est mise en œuvre. Nous considérons que ce qui ne se mesure pas effectivement est difficile à suivre. Donc pour chaque société, nous essayons, dès la mise en œuvre de la feuille de route, d’avoir des données très précises qui sont suivies, selon la nature de ces données au trimestre, au semestre, à l'année. Nous montrons à nos investisseurs l'impact effectif en surplus d'EBE créé dans les sociétés. C’est extrêmement suivi par nos mandants et je pense que quand nous l'avons fait, nous étions précurseurs. Nous avons d'ailleurs des trophées de certains de nos investisseurs (des trophées en bois que l’on garde). Aujourd'hui, je pense que ça s'est totalement inversé comme dynamique, c'est-à-dire que l’on ne nous félicite plus. On nous dit si vous n'avez pas une politique ESG pour votre société de gestion et des stratégies ESG dans les sociétés dans lesquelles vous investissez, on ne vous confie pas de l'argent. Donc la logique est totalement différente. Ce n’est plus un nice to have, c'est un must have.
Dans mon univers, je pense que ça va beaucoup plus vite que dans l'univers du coté, c'est-à-dire que vous avez des investisseurs très très importants, Apax lève essentiellement son argent hors de France, on lève notre argent auprès des fonds de pension canadiens, les fonds de pension américains, les grands fonds publics asiatiques ou du Moyen-Orient. Et les fonds de pension américains ou canadiens sont extrêmement rigoureux là-dessus. Si ce que vous leur expliquez n'est pas crédible, vous pouvez passer deux heures sur une conférence téléphonique à justifier de la feuille de route d'une société en ESG.
Question d’un participant dans la salle : Je voudrais connaître votre position sur l'actionnariat salarié. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de ceux qui étaient au contact du business, et donc les salariés. Comment vous appréhendez ces parties prenantes dans le cadre de vos développements ?
Monique Cohen : Pour ce qui est du non-coté, vous savez tous qu’il y a un très fort alignement d'intérêts entre l'investisseur fonds et les managers qui se fait au travers du package mis en place, celui-ci est essentiellement fondé sur un surplus de valeur donnée aux manageurs dès lors que le BP est dépassé. Donc, c'est un partage de la survaleur au-dessus du business plan qui a fait l'objet de la thèse d'investissement du fonds.
Ce que nous faisons très systématiquement, c'est que nous discutons avec le dirigeant. C’est lui qui décide de la façon dont ce package va être alloué. Pour nous, c'est un message extrêmement important parce que c'est un outil de gestion de son équipe et nous avons tout vu : nous avons le dirigeant qui garde 80 % du package pour lui, le dirigeant qui ne garde que 10 % du package pour lui et qui répartit les 90 % extrêmement bas chez ses cadres. Et puis au-delà de ça, nous essayons, je dis bien nous essayons, de mettre systématiquement en place un FCPE[5] dédié et le fonds abonde une partie de ce FCPE. La problématique que ça crée, c'est que les entreprises dans lesquelles nous investissons sont très souvent, pas seulement françaises, pas seulement avec des salariés autorisés à souscrire ce type d'instrument, mais avec des salariés partout dans le monde. Et là, ça crée un déséquilibre. Je me souviens d’une société de facility management que j'avais acquise, le dirigeant, qui était vraiment un dirigeant exceptionnel, qui n’avait gardé que moins de 10 % du package pour lui et réparti le reste entre ses cadres, voulait absolument mettre en place un outil de motivation qui descendait très bas, puisque nous avions accepté d'abonder le fonds en question. Et puis il s'est arrêté parce qu'il avait des cadres en Belgique et en Allemagne, des cadres en Angleterre, et qu’afficher un avantage qui concernait seulement les salariés en France, mais qui ne pouvait pas être proposé à l'international pouvait créer un problème dans l’entreprise.
[2] Le fondateur d’Apax France et le co-fondateur d’Apax.
[3] Allusion à la table ronde précédente, dont le compte rendu vous a été donné dans La Lettre Vernimmen.net d’octobre 2019, n° 172.
[4] Principles for Responsible Investment.
[5] Fonds commun de placement d'entreprise : un fonds de placement réservé à l'actionnariat salarié.
Tableau : Typologie des sorties des fonds de capital-risque
La comparaison de deux graphiques produits par KPMG[1] sur l’historique des sorties des investisseurs en capital-risque au niveau mondial est éloquente.
On notera déjà qu’aucun des deux graphiques ne mentionne la sortie par liquidation ou faillite de la participation. Or dans le domaine de l’investissement en capital-risque, au moins aux premiers stades, c’est la sortie la plus fréquente, puisqu’au bout de dix ans entre 70 et 80 % des entreprises créées ont disparu[2].
En nombre, la cession à un concurrent est de loin la sortie la plus fréquente (dite, par euphémisme, cession stratégique) :
Et celles en LBO augmentent au cours du temps, sans surprise puisque le point de départ, 2010, suit le quasi-arrêt de 2009.
En valeur, c’est la sortie en bourse qui truste très largement la première place :
On peut en effet penser que si l’ex-start-up, devenue entreprise, a réussi brillamment là où la plupart échouent, son management est en mesure d’imposer son choix. L’introduction en bourse laisse quand même plus de liberté aux dirigeants que le LBO ou la cession à un concurrent. Sans parler des mega-réussites pour lesquelles les acquéreurs peuvent être rares au moment où se pose la question de l’introduction en bourse pour des raisons de taille ou d’anti-trust (Alibaba, Uber, Critéo, etc.).
Recherche : La responsabilité sociale de l'entreprise est-elle rentable pour elle ?
Avec la collaboration de Knowledge@HEC
Rodolphe Durand, Luc Paugam et Hervé Stolowy ont cherché à déterminer si l'inclusion dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, sans doute le principal indice international de durabilité, offre des avantages aux sociétés cotées[1].
Chaque année, le DJSI sélectionne des entreprises pour faire partie d'un groupe d’entreprises leaders en matière de durabilité économique, environnementale et sociale, en évaluant la gouvernance d'entreprise, les pratiques de travail, les actions en faveur de la transition climatique et les normes dans leurs chaînes logistiques.
La composition de l'indice change d'année en année, des entreprises étant ajoutées, supprimées ou maintenues dans l’indice.
Des recherches antérieures ont révélé que l'ajout, le maintien ou la suppression d'une entreprise à l'indice DJSI avait peu d'incidence sur le cours des actions et le volume des transactions par rapport à d'autres entreprises du même secteur ayant une rentabilité semblable.
Le travail des auteurs a confirmé ces résultats, mais ils sont allés plus loin dans l'analyse de l'effet du DJSI sur la visibilité d'une société auprès des analystes et sur le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs à long terme. Pour ce faire, ils ont comparé les entreprises de l'indice DJSI à d'autres entreprises qui affichaient une solide performance en matière de RSE, mais qui ne figuraient pas dans l'indice DJSI. Le groupe témoin était donc composé d'entreprises qui présentaient une différence marginale de performance RSE par rapport aux entreprises du DJSI.
L'examen des effets de la visibilité de la RSE est important, tout d'abord en raison des ressources que les entreprises consacrent à ces activités. De plus en plus d'entreprises mettent en place des systèmes d'information, publient des rapports sur la RSE et paient des consultants pour auditer l'information fournie sur la RSE. Il est donc naturel de se demander si les ressources considérables consacrées à l'inclusion de l'indice de durabilité produisent des effets positifs sur le marché, en plus des avantages intrinsèques de la RSE.
Deuxièmement, le nombre et l'importance des indices de durabilité ont considérablement augmenté au fil du temps, ce qui nécessite un examen empirique des effets de l'inclusion dans ces indices.
R. Durand et alii ont constaté que l'ajout ou le maintien dans l'indice DJSI attire davantage l'attention des analystes financiers, et que davantage de rapports sont rédigés sur ces sociétés. Il conduit également à une augmentation du pourcentage d'actions détenues par des investisseurs à long terme, ce qui indique une tendance à ce que les investisseurs professionnels accordent de plus en plus d'attention à la RSE des entreprises visibles. Par conséquent, les entreprises peuvent tirer un avantage des activités de RSE et, plus particulièrement, de leur inclusion dans l'indice DJSI.
L'influence des indices de durabilité n'a peut-être pas atteint son plein potentiel. Face aux redoutables défis climatiques et aux exigences croissantes de la société civile, il est probable que l'impact des indices de durabilité croîtra avec le temps.
Q&R : Comment une entreprise choisit-elle sa place de cotation ?
La place naturelle de cotation est le pays d’origine de l’entreprise, sauf cas très particulier. C’est là que l’entreprise est la mieux connue des investisseurs locaux qui sont ainsi susceptibles de la valoriser au mieux. Il existe bien évidemment des exceptions ; ainsi L’Occitane et Prada ont choisi de se faire coter à Hong Kong (il est vrai que leurs activités sont très développées en Asie) et Cellectis et Criteo ont choisi New York afin de faciliter leur implantation aux États-Unis, où se trouvent cotées la plupart des sociétés comparables. Le groupe de trading et de mines Glencore, basé en Suisse, a fait le choix de Londres (et de Hong Kong) car la plupart des groupes miniers sont cotés à Londres. Mais seul un nombre marginal d’entreprises des grands pays européens n’est pas coté sur son marché national.
Quant à une éventuelle seconde cotation sur une place étrangère, l’expérience des années 2000 a montré que, le plus souvent, elle entraîne des coûts et des contraintes supplémentaires sans se traduire par un accroissement de la liquidité ou une valorisation significativement meilleure.
Seuls des groupes de pays émergents trouvent, quand leur marché financier local est peu développé (Russie, Amérique latine…), intérêt à être cotés à New York, Londres, Paris ou Hong Kong. Ainsi, le groupe Internet nigérian Jumia a fait son introduction en bourse à New York en 2019. Quant à Alibaba, après la cotation sur le NYSE de New York en 2014, plus laxiste que la bourse de Hong Kong en matière de standard de gouvernance, il vient de se faire coter sur cette dernière, qui a mis de l’eau dans son vin[1], pour attirer une cotation par le biais d’une augmentation de capital de 11 Md$, génératrice de commissions… difficiles à négliger pour une bourse.
[1] De l’eau dans son thé fonctionne moins bien…
Autre : FORMATIONS
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Ingénierie financière » le 12 mars et le 16 octobre 2020, à Paris.
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 4 mai et le 17 novembre 2020, à Paris.
- « Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity » le 23 avril et le 22 octobre 2020, à Paris.
- « Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2020 » le 23 mars et le 30 septembre 2020, à Paris.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
OPRA et augmentation de capital simultanée de Free
Vous avez peut-être été surpris de l'annonce de Iliad, plus connue sous sa marque Free, d'une OPRA (offre publique de rachat d'actions) de 1,4 Md€ financée par une augmentation de capital du même montant, les deux opérations étant réalisées à un prix largement supérieur au cours d'Iliad au moment de l'annonce le 12 novembre : 120 € contre 95 €. L'augmentation de capital est entièrement garantie par le fondateur et principal actionnaire, Xavier Niel, qui ne participera pas à l'OPRA et dont le pourcentage pourrait passer de ce fait de 52 % à 72 %.
Il est en effet étrange de procéder au même moment à une création d'actions nouvelles et à une destruction d'actions au même prix, et pour la même quantité d'actions. Peut-être vous êtes-vous même dit que cela n'était pas sérieux.
En fait, c'est probablement le seul outil disponible, compte tenu du droit boursier, pour un majoritaire qui veut renforcer significativement son contrôle sur une société cotée sans pour autant la retirer de la cote, puisqu’une OPA, même simplifiée, doit porter sur la totalité du capital. Quant à un ramassage en bourse, compte tenu de son ampleur (20 % du capital et 40 % du flottant), il risquerait de faire flamber les cours, d'autant que son initiateur devrait déclarer ses achats quotidiens de titres.
Si, actionnaire de Free, vous vous interrogez pour savoir si vous devez participer à l'OPRA, la réponse est dans le chapitre 39 du Vernimmen 2020.
De l’importance de raisonner en net en matière d’endettement
Le cabinet Redbridge DTA a publié une étude sur le financement des sociétés non financières du SBF 120 où il apparaît que l’endettement brut des groupes concernés est de 622 Md€ fin 2018, pour un EBE de 197 Md€, soit un ratio de 3,2 qui commence à vous inquiéter. Heureusement Redbridge, qui connaît son métier, indique aussi que les liquidités et équivalents se montent à 278 Md€, ce qui fait apparaître une dette nette de 344 Md€, soit 1,7 fois l’EBE 2018.
Comme quoi, en moyenne l’endettement net des grands groupes français cotés n’est pas, sauf quelques exceptions limitées, un vrai sujet d’inquiétude une fois que les disponibilités sont prises en compte, pour autant qu’elles soient aisément accessibles (ce qui est normalement le propre des liquidités).
Pour plus de détails, lire ou relire le chapitre 13 du Vernimmen 2020.
Faire une augmentation de capital pour faire baisser son coût du capital ?
Ceux d’entre vous qui nous lisent régulièrement savent que de tout temps nous avons pensé que le coût du capital de l’entreprise n’était pas déterminé par sa structure financière. En particulier, nous nous sommes toujours élevés contre les rachats d’actions financés par endettement pour prétendument faire baisser le coût du capital, qui permettent surtout à leurs promoteurs, les banquiers d’investis-sement, de vendre deux produits en un (les rachats d’actions et le crédit ou l’obligation émise) au mépris de l’honnêteté intellectuelle.
Comme l’avantage fiscal de la dette (déductibilité fiscale des intérêts de la base imposable) mis en avant à tort pour étayer cette argutie disparaît sous le triple effet de taux d’intérêt très bas, de taux d’impôt sur les sociétés au plus bas historique, et d’une limitation quasi générale de la déductibilité plafonnée à un pourcentage de l’EBE, nous entendions moins l’argument ces temps-ci.
Pour plus de détails, voir le chapitre 33 du Vernimmen 2020.
Pour la première fois, nous venons de voir utiliser l’argument exactement inverse : celui de l’augmentation de capital, en l’occurrence celle de 200 M€ de La Perla, qui permettrait de faire baisser le coût du capital, sous la plume du banquier arrangeur de cette opération. Quelle révolution copernicienne ! Mais pas plus que l’endettement permettait de faire baisser le coût du capital, l’augmentation de capital ne le peut non plus, puisque le coût du capital ne dépend que du risque de marché de l’actif économique.
On ne manquera pas d’en sourire.
Fonds d’investissement et bourse
Les fonds d’investissement ont la réputation, scientifiquement démontrée par les chercheurs en finance, de ne pas laisser d’argent sur la table, autrement dit de valoriser les actions des entreprises qu’ils introduisent en bourse au plus haut qu’ils le peuvent et que l’acceptent les investisseurs. Ces derniers ne peuvent alors pas se livrer au petit jeu de participer à l’introduction pour revendre quelques heures/quelques jours après en empochant la décote d’introduction, autrefois estimée entre 5 et 10 %.
L’introduction en bourse de Verallia, participation d’Apollo, début octobre, en est une illustration. Pour un prix d’introduction de 27 €, dans le bas de la fourchette annoncée (26,5 € - 29,5 €), le cours, après avoir un peu et brièvement monté (28,6 € au maximum), s’est stabilisé au bout de six jours de négociation vendredi soir à 27,16 €.
En revanche, en Scandinavie, la société de gestion de fonds d’investissement, EQT, semble avoir été beaucoup plus laxiste/généreuse/soucieuse du long terme. Introduite le 23 septembre dans le haut de sa fourchette de 62 à 68 SEK, à 67 SEK, son cours a flambé de 25 % le premier jour et terminait à 90 SEK vendredi soir, soit une performance de 34 %. De quoi laisser de bons souvenirs aux actionnaires de départ, terreau toujours favorable pour de nouvelles augmentations de capital afin de doter cette société de gestion de fonds d’investissement (40 Md€ en LBO, infrastructures, dettes) de capitaux propres nouveaux pour investir comme actionnaire de départ significatif (cornerstone) dans les fonds qu’elle lève régulièrement. Ceci explique peut-être cela.
Mais cette introduction en bourse, longtemps après celles des grands américains (KKR, Apollo, Carlyle, Blackstone), illustre paradoxalement la désaffection pour les marchés boursiers et la montée continue des investissements non cotés, puisqu’elle va donner plus de moyens à EQT pour retirer de la cote plus d’entreprises, même si rien n’est définitif en la matière, comme le montre l’exemple de Verallia. On peut toutefois se dire que Verallia n’est venue en bourse que parce que le marché du private equity la valorisait probablement moins bien.
Pour plus de détails sur ce sujet, voyez l’avant-propos du Vernimmen 2020 qui est consacré à cette thématique, et l’article d’actualité de cette lettre.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.