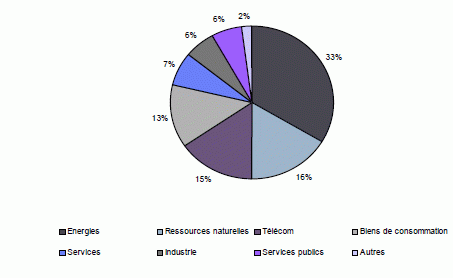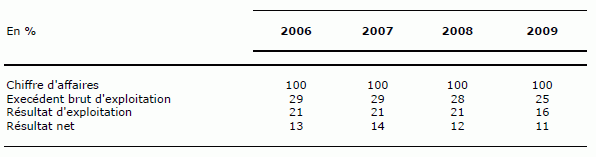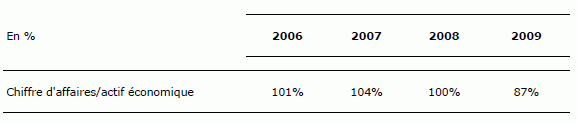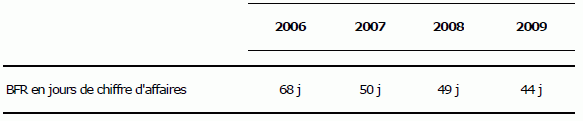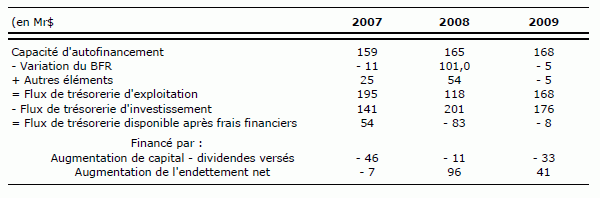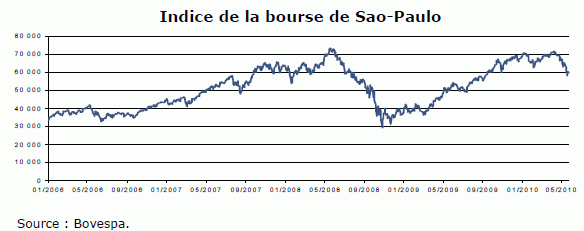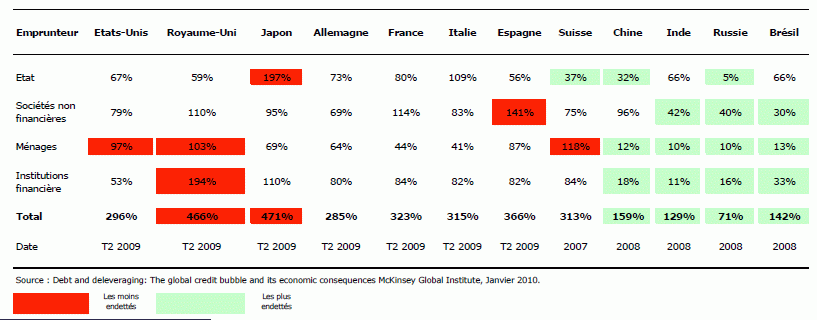La Lettre n°87 de Mai 2010
Actualités : L'analyse financière des groupes brésiliens
377 entreprises brésiliennes étaient cotées en décembre 2009 sur la bourse de Sao Paulo. En éliminant de l’échantillon celles du secteur financier, celles ne disposant pas de 4 années de comptes et celles trop petites, on aboutit à un ensemble de 182 sociétés représentant 97 % de la capitalisation boursière brésilienne (qui est d’environ 930 Md€, soit les deux tiers de celle d’Euronext Paris ou à peu près celle de l’Australie).
Nous leur avons appliqué la méthodologie d’analyse financière habituelle (1). Leurs comptes agrées sont disponibles sur demande via la boite aux lettres du site www.vernimmen.net. Pour la plupart, elles clôturent leurs comptes au 31 décembre.
Création de richesse
Le chiffre d’affaires cumulé des entreprises brésiliennes de l’échantillon est de 382 Md€, soit l’équivalent du chiffre d’affaires cumulé de BP et Shell.
Les entreprises brésiliennes cotées font apparaître une très grande diversité de taille : les 20% les plus grandes font 80 % du chiffre d’affaires, 86 % du résultat d’exploitation avec des chiffres moyens de 8 Md€ et 1,4 Md€.
A l’inverse, les 20% les plus petites font 0,6% de chiffre d’affaires, - 3 % du résultat d’exploitation avec des chiffres moyens de 66 M€ et – 1,7 M€.
La concentration est nettement plus forte qu’en Chine (2) et similaire à celle de l’Inde (3).
L’énergie est le premier secteur avec 33% du total du chiffre d’affaires, en lent déclin relatif depuis quelques années au profit des télécoms et des biens de consommation. Les ressources naturelles souvent citées comme secteur emblématique du Brésil sont en déclin et ne font plus que 16 % du chiffre d’affaires 2009 :
Sans surprise le niveau de croissance de ces entreprises cotées a été fort depuis 2006 avec + 9 % / an en moyenne. Comme l’inflation brésilienne a été de l’ordre de 5 % / an, ces entreprises ont cru en volume de l’ordre de 4 % / an, soit plus que l’économie brésilienne dans sa totalité qui s’est contentée d’un taux de croissance en volume de 3,4 % / an environ sur cette période.
Cette forte croissance se serait accompagnée d’une stabilité des marges
d’exploitation, s’il n’y avait pas eu 2009 :
A titre de comparaison les marges d’exploitation des groupes européens ont été en 2009 de l’ordre de 11 %. A la différence de la Chine (où ce même ratio était de 9 %) spécialisée dans des exportations à bas prix, le Brésil tire parti de ses richesses naturelles et de produits à plus forte valeur ajoutée.
Investissements
La gestion de l’actif économique ne montre pas de faiblesse :
Le besoin en fonds de roulement s’améliore constamment en jours de chiffre d’affaires :
Sans surprise, compte tenu de sa croissance en volume plus proche de celle des pays développés que de la Chine ou de l’Inde, les investissements ne représentent que 1,4 fois la dotation aux amortissements.
Financement
Compte tenu d’une croissance qui n’est plus spectaculaire et grâce à une bonne rentabilité comme on le verra dans un instant, les entreprises brésiliennes de notre échantillon ont dégagé depuis 2007 un flux de trésorerie disponible après frais financiers à peu près équilibré :
L’augmentation de l’endettement qui a progressé des deux tiers entre 2006 et 2009 reste globalement raisonnable puisque représentant 1,5 l’excédent brut d’exploitation 2009, soit le niveau moyen des grands groupes européens.
Rentabilité
La rentabilité des entreprises brésiliennes cotées est correcte : autour de 10 % après impôt pour la rentabilité économique en 2009 (16 % les années d’avant) contre un coût du capital de 12 %. La rentabilité des capitaux est encore meilleure compte tenu d’un effet de levier modéré : environ 15 % en 2009 et 20 % avant.
En versant 49 % de leurs bénéfices sous forme de dividende, les groupes brésiliens ont adopté une politique de distribution en accord avec une croissance qui se ralentit même si elle ferait rêver ici, surtout en ce moment …
En fait, la seule caractéristique financière des entreprises cotées dans ce pays qui les rattache aux pays émergents sont les paramètres boursiers : PBR de 4 et PER 2009 de 30, ce qui n’est particulièrement pas donné pour des entreprises qui ne font que gagner que leur coût du capital On y lira l’anticipation par les investisseurs de meilleurs résultats à venir que le volume d’activité du premier trimestre 2010 de l’économie brésilienne (+ 9,8 % en rythme annualisé) pouvait laisser présager.
Après tout, le PIB du Brésil dépassera celui de la France cette année. Ainsi va le monde ….
Boursièrement, les groupes brésiliens ont été affecté comme les autres et ont perdu plus fortement de leur valeur en 2008 avant de se reprendre en 2009.
* * *
Du coté de la comptabilité
L’IASB, du coté de la comptabilité, a annoncé une consultation publique en vue de modifier sa normes IFRS 9 sur les instruments financiers. La possibilité pour les entreprises de valoriser leurs passifs financiers en valeur de marché et d’inclure le gain ou la perte en résultant dans leurs résultats pourrait ainsi être supprimée.
Si comme il est probable, cette disposition est adoptée, il ne sera plus possible pour une entreprise ou une banque de s’enrichir de sa propre décrépitude pour reprendre le titre de l’article que nous avions consacré à ce sujet dans la Lettre Vernimmen.net n° 80 d’octobre 2009. Le gain ou la perte résultant apparaîtraient dans le compte des other comprehensive income et donc en capitaux propres sans passer par le compte de résultat.
Outre son caractère contre-intuitif, l’IASB s’est rendu compte que les investisseurs n’étaient pas demandeurs de ce traitement comptable qu’ils extournaient systématiquement. Comme quoi, même avec l’IASB, la raison peut prévaloir …
(1) Voir le chapitre 10 du Vernimmen 2010.
(2) Voir la Lettre Vernimmen.net n° 54 de janvier 2007.
(3) Voir la Lettre Vernimmen.net n° 72 de janvier 2009.
Tableau : L'endettement des pays
Si la dette des organismes gouvernementaux japonais est la plus élevée de l’échantillon à 197 % du PNB, elle est à 93 % détenue localement (ce même ration est de 44 % pour la France), ce qui la rend plus supportable.
Dans le monde développé, l’importance de la dette des entreprises par rapport au PNB doit beaucoup au degré d’internationalisation des entreprises et donc à leur taille (puisque ce sont les plus gros qui sont les plus internationales) : Royaume-Uni, France, Suisse. Alternativement, elle reflète un niveau d’endettement important par rapport au flux de trésorerie dégagés : Chine, Japon, Espagne.
L’endettement des ménages est le plus haut dans les pays qui ont connu une bulle immobilière récente : Etats-Unis, Royaume-Uni et Espagne, car l’essentiel de l’endettement des ménages est de nature immobilière.
On remarquera le poids de l’endettement des sociétés financières britanniques (194 % du PNB) dû à l’importance du secteur financier britannique et de ses banques (HSBC, Barclays et RBS).
Les pays émergeants constituent une classe bien à part avec un niveau d’endettement relatif 2 à 3 fois plus faible que pour les pays développés. Quant au très faible niveau d’endettement de la Russie, on pourra le mettre sans risque sur le faible niveau de gouvernance générale qui n’incite pas les prêteurs à prêter (peut-être le reste d’un goût amer des emprunts russes) !
Recherche : Pourquoi les entreprises s'introduisent-elles en bourse ?
La recherche en finance consiste le plus souvent à élaborer des modèles explicatifs des décisions financières, et à tester les prédictions de ces modèles à partir de bases de données comptables et financières. L’article que nous présentons ce mois-ci relève d’une autre approche : l’interrogation directe (et anonyme) de directeurs financiers. Les résultats obtenus n’ont pas la même robustesse scientifique, puisque les taux de réponse sont généralement faibles (moins de 5%) et que la sincérité des réponses, même anonymes, peut être mise en cause. Il s’agit toutefois d’un bon complément aux travaux scientifiques, très utile notamment pour les comparaisons internationales.
L’article porte sur les introductions en bourse des entreprises européennes (1). Les auteurs ont adressé un questionnaire de plus de 100 questions à 1808 entreprises européennes introduites en bourse entre 1994 et 2004 ; ils ont obtenu 78 réponses (soit 4,3%, un taux satisfaisant pour ce genre d’étude). Leur échantillon est suffisamment varié (tailles et caractéristiques des entreprises, places boursières et années d’introduction) pour être exploitable.
Les résultats sont pour la plupart semblables à ceux obtenus sur les entreprises américaines (2). Le bénéfice attendu de l’introduction le plus souvent cité (par 83% des directeurs financiers) est l’amélioration de la réputation et de la visibilité de l’entreprise.
Ceci est conforme à la prédiction du prix Nobel Robert Merton, selon lequel une plus grande visibilité (notamment auprès des analystes) et une base d’investisseurs élargie permettent aux entreprises introduites en bourse de voir leur coût du capital diminuer (3). Pour 56% des interrogés, l’introduction en bourse a permis une amélioration du pouvoir de négociation face aux créanciers.
L’autre bénéfice attendu est de financer la croissance. L’introduction en bourse apparaît comme une étape normale dans le développement d’une entreprise. Cet objectif est reconnu dans 75% des cas (et la réduction du taux d’endettement dans 35% des cas). Les entreprises qui augmentent leur capital à l’occasion de l’introduction sont effectivement celles qui ont les taux de croissance les plus élevés. Toutefois, la part d’émission de nouvelles actions dans les introductions est assez faible (35% en moyenne) ; l’essentiel consiste en la mise sur le marché d’actions existantes. L’objectif reste celui de la croissance, mais externe : coter les actions en bourse et les utiliser pour des opérations de fusions-acquisitions. Le choix de la place de cotation tient compte dans plus de la moitié des cas de cet objectif.
L’introduction en bourse offre également une porte de sortie aux détenteurs du capital. Elle leur permet de céder leurs actions en plusieurs étapes et souvent à un prix plus élevé que celui obtenu en l’absence de cotation. Cet objectif est cité dans 60% des cas, et les auteurs remarquent qu’il est particulièrement mis en avant au Royaume-Uni.
(1) F. Bancel et U.R. Mittoo (2009), Why do European firms go public ?, European Financial Management, vol.15, n° 4, pages 844-884.
(2) Par exemple J. Brau et S.E. Fawcett (2006), Initial public offerings : an analysis of theory and practice, Journal of Finance, volume 61, n°1, pages 399-436.
(3) R. Merton (1987), A simple model of capital market equilibrium with incomplete information, Journal of Finance, volume 42, n°3, pages 483-510.
Q&R : CDS, CDO et Abacus par François Meunier
Les CDS s’expliquent en deux mots à partir d’un exemple. Un contrat de CDS sur Carrefour commencera par définir le montant couvert, par exemple 10 M€, avec une protection formulée ainsi : contre le versement d’une prime, par exemple de 1,5% du montant couvert, soit 150.000 €, je toucherais 10 M€ si Carrefour fait défaut, et rien s’il ne fait pas défaut. Si jamais je possède des obligations Carrefour pour un montant de 10 M€ et que j’ai des craintes sur la solvabilité de Carrefour, il me suffira de les adosser à un CDS pour 10 M€, et je me retrouve virtuellement avec une obligation sans risque. (Pas complètement, je subis le risque de la contrepartie qui m’a vendu la protection. S’il s’agit d’une entité qui est triple A comme l’État français, j’ai donc synthétiquement en main l’équivalent d’une obligation de l’État français.)
Je peux tout autant acheter le CDS sans disposer par avance de l’obligation Carrefour. Payant simplement ma prime, je gagnerais avec mon CDS « sec » 10 M€ en cas de faillite de Carrefour. Il y a donc là un moyen extrêmement commode de se mettre à découvert de (ou shorter) Carrefour. En l’absence de CDS, le seul moyen de vendre à découvert consiste à emprunter l’obligation auprès d’un investisseur qui la détient déjà (contre un intérêt) et de lui rendre physiquement à un terme prédéterminé. Si Carrefour fait défaut, le prix de rachat à terme est tombé à zéro et je gagne la différence.
Il n’est pas facile de trouver des investisseurs prêts à vous prêter des titres et souvent le marché des prêts et emprunts de titres est souvent complètement illiquide. Le marché des CDS est un substitut commode. Mais il n’est pas non plus facile de trouver des intermédiaires prêts à vous vendre des CDS secs, sur Carrefour ou sur toute autre actif.
Des contraintes réglementaires empêchent souvent de le faire ; ou encore on se heurte à la solvabilité de la contrepartie qui vend le CDS.
La solution alors est de fabriquer « synthétiquement » des obligations Carrefour et de les vendre à des investisseurs. Il suffit que je constitue un fonds – appelez le Abacus – qui achète des obligations du Trésor français et qui vous vende en même temps des CDS Carrefour sur un montant couvert identique (et gagés sur la valeur des obligations du Trésor). Le fonds se financera en émettant ses obligations propres, qui sont évidemment assises sur la valeur agrégée des emprunts d’État et des CDS. L’investisseur qui achète de telles obligations aura en main l’emprunt d’État et l’obligation de payer le même montant au cas où Carrefour ferait défaut. Si Carrefour fait défaut, il perd tout ; à l’inverse il touche le coupon de l’emprunt d’État et la prime du CDS – qui n’est pas très éloignée du coupon que verserait l’obligation Carrefour : n’est-ce pas là la définition d’une obligation Carrefour ? On appelle cela un CDO pour Collateralised Debt Obligation. Le fonds fait comme si il avait lui-même émis des obligations Carrefour alors bien sûr qu’il n’est pas Carrefour.
Par une arithmétique simple :
Obligation Carrefour + CDS Carrefour = Obligation sans risque,
Et donc :
Obligation sans risque - CDS Carrefour = Obligation Carrefour « synthétique ».
A partir de là, le monde vous est ouvert : mettez à la place de l’obligation Carrefour des obligations immobilières subprime ou des tranches de fonds de titrisation subprime et vous avez le système qui a fait gagner tant d’argent au hedge fund Paulson & Co (1 Md$), et tant perdre à IKB et à RBS. L’acheteur de CDS subprime est Paulson ; le fonds émetteur des obligations synthétique subprime est Abacus ; les investisseurs malheureux sont IKB et le rehausseur de crédit ACA (qui a acheté une sorte de caution de la part d’ABN AMRO, racheté bien à tort par RBS) ; l’arrangeur de tout cela est Goldman Sachs. Cherchez le vice.……
Autre : NOS LECTEURS ECRIVENT : Pour ou contre les CDS « secs » ou peut-on parier sur le malheur des autres ? par François Meunier (1)
La nouvelle tourmente sur le marché de la dette réalimente le débat sur les CDS ou credit default swaps). (Voir encadré ci-après à destination de ceux de nos lecteurs qui voudraient mieux connaître ce sigle recouvre.)
Passe encore, disent certains, qu’on puisse utiliser ces produits financiers comme instruments de couverture contre le risque de défaut d’une contrepartie, dette souveraine ou privée. Mais il est inacceptable de disposer de CDS « secs », sans objet à couvrir. Cela devient de purs instruments de spéculation, sans utilité sociale. « Parce que ces CDS secs constituent une grande partie de l’encours de CDS en circulation, les arguments pour les bannir sont aussi solides que ceux pour bannir les cambriolages de banque », dit Wolfgang Mundchau dans une chronique inhabituellement virulente du Financial Times du 28 février 2010 : Time to outlaw naked credit default swaps.
Pour d’autres au contraire, cette technique de couverture est bénéfique. Acheter un CDS sec, c’est se donner la possibilité de vendre à découvert, de shorter, l’actif financier dont on pense que le prix va baisser, une opération en général difficile à faire sur les marchés financiers et jamais sur le marché des marchandises courantes (vous ne pouvez pas vendre une botte de poireaux dont vous ne disposez pas). Les spéculateurs ne sont jamais une population très aimée, mais les spéculateurs qui deviennent riches quand les marchés chutent, c'est-à-dire quand les temps sont difficiles, sont carrément antipathiques. Ils vivent du malheur des autres. Pourtant, vendre quand on dispose d’une information ou d’une conviction que la hausse de prix ne peut pas durer, c’est transmettre au marché l’information qu’il est prudent d’arrêter d’acheter. Le spéculateur ne gagne de l’argent que quand il vend haut ce qu’il a acheté bas ; ou, à l’envers, quand il vend haut ce qu’il va racheter bas dans le futur. Acheter bas fait remonter le cours ; vendre haut le fait baisser. Par conséquent, sauf cas bien documentés, l’intervention du spéculateur est en moyenne stabilisatrice (autrement, il perdrait de l’argent !).
Le hedge fund Paulson & Co impliqué (mais non mis en examen) dans la plainte de la SEC, autorité de contrôle des marchés financiers aux États-Unis, contre la banque Goldman Sachs a fait précisément ceci, chercher par un montage complexe et détourné à vendre à découvert le marché immobilier subprime aux Etats-Unis, ceci juste avant sa chute. Les avocats de la vente à découvert, et donc des CDS secs, font valoir que si cette technique avait davantage été répandue, bien d’autres que John Paulson, faisant comme lui le constat de la surévaluation du marché immobilier américain en 2006 et 2007 mais sans moyen de prendre position à la baisse, auraient pu commencer à vendre. Ce qui aurait refroidi les investisseurs et calmé le marché. Et peut-être évité le retournement de la mi-2007. Pouvoir facilement vendre à découvert, c’est dans la plupart des cas empêcher le marché de monter à des niveaux stratosphériques ; de la même façon que pouvoir acheter, c’est empêcher les prix de marché de s’effondrer. (On observe qu’il y a des bulles de marché, et non des « anti-bulles », preuve de la facilité plus grande à acheter qu’à vendre.)
Jusqu’ici, rien de nouveau : les arguments suivent la ligne de partage habituelle entre pro- et anti-marchés. Et pourtant quelque chose gêne ! Pour l’indiquer, voici un exemple hautement fictif, mais pour autant tout à fait réalisable aujourd'hui.
Imaginez que Boeing décide de baisser brutalement de 20% le prix catalogue de son futur B777. Cela force Airbus à faire de même sur son A350, futur concurrent du B777. Les marges des deux constructeurs s’effondrent. Mais auparavant, Boeing a acheté des wagons de CDS sur Airbus. En raison de l’effondrement de la rentabilité, le prix des obligations des deux constructeurs chutent et le prix de leurs CDS s’envole. Résultat : la guerre des prix affaiblit Airbus, mais pas Boeing qui aura les profits de sa position short sur Airbus. Ainsi, les CDS pourraient enrichir l’arsenal de la concurrence industrielle. Choquant ? Bien sûr ! Illégal ? Pas forcément aujourd'hui, bien qu’on sente qu’un devoir d’information incombe à Boeing vis-à-vis des investisseurs qui lui ont vendu les CDS. C’est ce qu’estime la SEC dans sa présente action en justice contre Goldman Sachs : la banque aurait manqué à son devoir d’information sur son fonds Abacus, celui qui vendait des protections à Paulson & Co, financées par l’émission d’obligations auprès d’investisseurs.
L’exemple est extrême mais illustre une vraie difficulté des CDS. Ces produits, présentés comme des instruments d’assurance financière, s’écartent pourtant du principe fondamental de l’assurance, qui est qu’on ne peut acheter une assurance qu’à titre de protection, c'est-à-dire contre un risque qu’on subirait personnellement. C'est le principe indemnitaire. Avec en corollaire l’interdiction pour l’assuré de céder son contrat d’assurance et donc de le valoriser constamment sur un marché. Pourquoi cette précaution (2) ? Pour simplifier, elle sert à éviter un danger associé depuis toujours au marché de l’assurance, et qu’on oublie trop sur les marchés financiers, à savoir l’aléa moral. Il n’est pas bon de permettre au voleur de prendre une assurance sur la maison qu’il va voler ; ou au tueur à gage une assurance-vie sur son « contrat ». Quelle garantie a-t-on sur le marché du crédit que le risque est bien exogène, qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’acheteur d’assurance de provoquer le risque contre lequel il se couvre, ou à tout le moins de ne rien faire contre. La question n’est pas innocente. Beaucoup de hedge funds ont fait il y a deux mois un pari assez facile à gagner : vendre la dette grecque (par achat de CDS) tout en vendant massivement l’euro. Pas besoin d’une grande liquidité sur le marché du CDS grec. Au contraire même : plus le cours des CDS montait (plus de 8% par an au cœur de la crise), plus montaient les doutes sur la pérennité de la zone euro, et donc plus sûrement allait baisser l’euro. Il est donc essentiel qu’il n’y ait pas d’interférence entre le risque et celui qui est censé le porter. Or, sur le marché du crédit, les interférences abondent comme le montre l’exemple d’Airbus et de Boeing (3). C’est bien pour cette raison que les assureurs prennent des précautions extrêmes quand ils structurent leurs produits : ils souhaitent que l’assuré n’ait pas de prise importante sur le risque à assurer et cherche au contraire à le réduire au maximum. Ils introduisent des clauses de partage du risque ou des obligations de prévention par des audits préalables. Ceci en sus, comme on l’a vu, du principe indemnitaire et de non cessibilité (4).
Rien de tout cela sur le marché des CDS. Dans un laps de temps inférieur à une décennie, on a mis sur le marché des produits d’assurance non indemnitaires, cessibles à tout vent, sans les précautions contractuelles qui vaudraient pour des produits de la sorte, dans la totale opacité sur les acheteurs et les vendeurs, en dehors de tout marché organisé.
Ce n’est pas nier l’utilité de ces produits de couverture, à preuve le développement gigantesque du marché. Mais niant obstinément les manifestes difficultés liées aux asymétries d’information, les CDS sont venus sans le cadre contractuel, juridique, institutionnel et réglementaire approprié. C’est cela qu’il faut corriger au plus vite.
(1) Président du comité scientifique de l’Association Française des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG).
(2) Qui n’existait pas forcément aux origines de l’assurance. Quand les premiers Lloyd’s se réunissaient dans un célèbre bar londonien au 17e siècle, c’était bien à des paris sur le succès ou l’échec de telle ou telle expédition maritime qu’ils se livraient, et ce faisant permettaient à des investisseurs de se couvrir.
(3) C’est moins vrai sur d’autres marchés sur lesquels existent des dérivés. Par exemple, les options de change euro/dollar représentent un petit encours sur un marché extrêmement liquide et difficile à manipuler.
(4) C’est pour cette raison qu’ils sont peu à l’aise avec les normes comptables IFRS (IFRS 4), qui introduisent la notion de juste valeur – et donc l’idée d’une valorisation par un marché – pour un contrat d’assurance, même si des portefeuilles de polices d’assurance peuvent faire l’objet de cession entre assureurs.