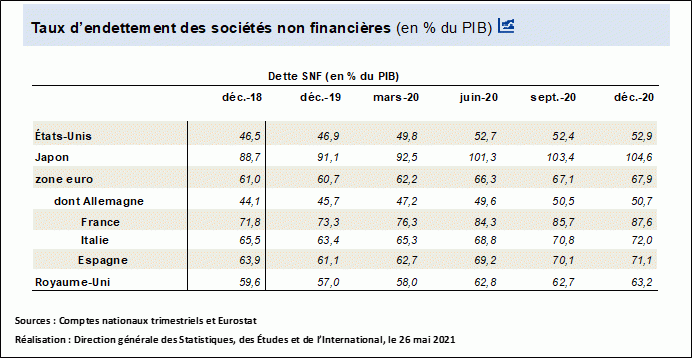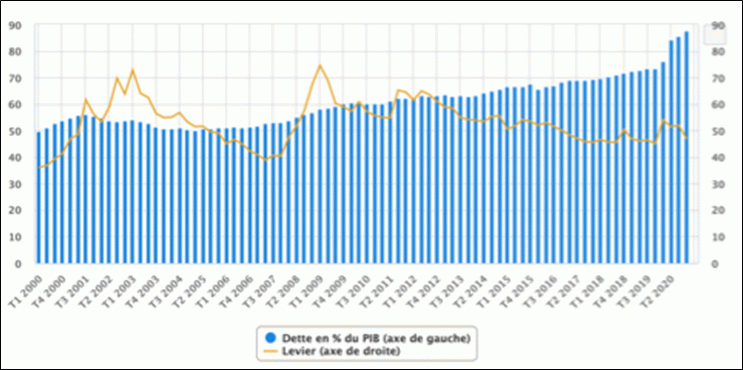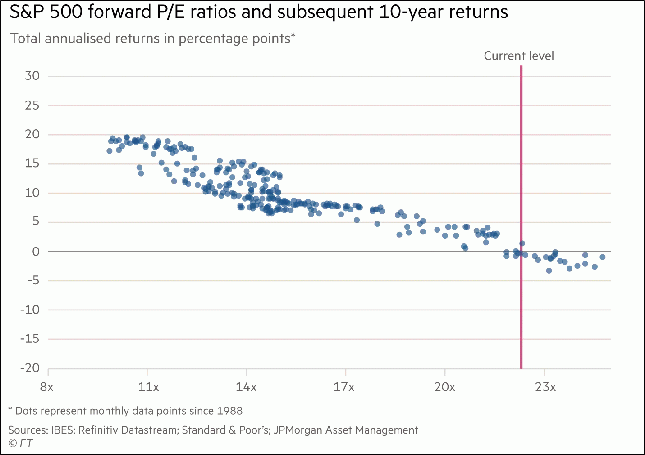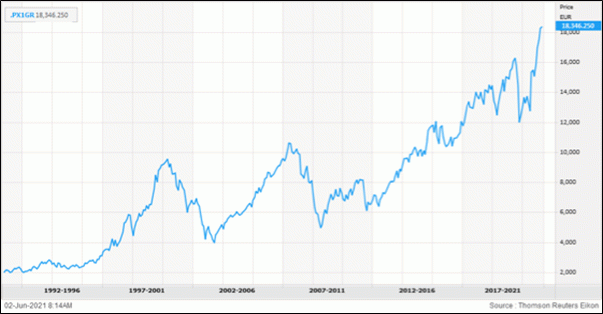La Lettre n°190 de Juillet 2021
Actualités : La couverture du Vernimmen 2022
Comme chaque année nous offrons aux lecteurs de Lettre Vernimmen.net la primeur de la couverture du nouveau Vernimmen, inspirée cette année d’une envie très forte de se changer les idées !
L’édition 2022 sera disponible en librairie le 25 août et elle témoignera de la formidable accélération de l’écologisation de la finance d’entreprise enregistrée depuis un an, à laquelle nous consacrons aussi notre avant-propos annuel.
Actualités : Que penser du ratio dettes des entreprises/PIB ?
Divers organismes (Banque de France, BRI, etc.) publient régulièrement le ratio de l’endettement des sociétés non financières sur le produit intérieur brut (PIB), et font des comparaisons internationales, qui ne sont guère flatteuses pour les entreprises françaises. Ainsi, la Banque de France calcule que des six grands pays de l’OCDE, les entreprises françaises sont celles qui ont le plus augmenté leur endettement en pourcentage du PIB, passant de 56 % en 2001 à 87,6 % 20 ans plus tard, juste derrière les groupes japonais qui sont eux à 104,6 %, et bien devant les entreprises allemandes à 50,7 % :
Faut-il s’en inquiéter ?
Nous ne le pensons pas, pour trois raisons.
La première, c’est que dans ces ratios les liquidités détenues par les entreprises ne sont pas prises en compte pour faire, comme il se doit, un calcul en endettement net. Or, les liquidités détenues sont considérables et leur impact est très significatif. Au 31 décembre 2020, l’endettement brut des sociétés françaises était estimé par la Banque de France à 1 888 Md€, mais les disponibilités étaient, elles, de 886 Md€, soit 47 % du montant précédent. Autrement dit, le ratio des dettes nettes en pourcentage du PIB est de 55,5 %, et non de 87,6 % comme calculé en brut, qui est pourtant l’agrégat mis en avant, à tort à notre avis.
La seconde raison est que ces chiffres de dettes sont calculés à partir des comptes sociaux des entreprises, et non à partir de leurs comptes consolidés. Ce qui veut dire que lorsqu’une maison mère française s’endette pour financer ses filiales étrangères, la dette entre dans le ratio, mais pas l’actif qui en est la contrepartie et qui constitue comptablement une immobilisation (financière). Pour des raisons fiscales, le taux d’impôt sur les sociétés en France étant depuis des années dans le haut de la fourchette des taux observés dans les principaux pays de l’OCDE[1], les groupes français logent pour la plupart la dette du groupe en France, et non à l’étranger, quitte à capitaliser la filiale étrangère, dont les remontées de dividendes s’effectueront dans le cadre du régime mère-fille, avec une taxation à 1,4 %.
La troisième raison peut être illustrée par l’acquisition de Tiffany par LVMH pour 13,4 Md€. C’est autant de dettes de plus au débit des entreprises françaises, mais comme Tiffany a des activités marginales en France, c’est un impact nul sur le PIB, et donc une dégradation du ratio dettes/PIB, alors qu’il n’y a aucun appauvrissement instantané, ni de doutes quant à la capacité de LVMH de rembourser, le moment venu, sa dette d’acquisition. Or, les groupes français sont des gros acquéreurs à l’étranger (cf. Sanofi, Total, Vinci, Schneider, Dassault Systèmes, etc.).
* * *
Si les macro-économistes font du PIB leur indicateur favori, car il mesure, en tant que somme des valeurs ajoutées, la richesse créée pendant une année, une entreprise ne rembourse pas ses dettes avec sa valeur ajoutée, mais avec ses flux de trésorerie disponible. Partant de la valeur ajoutée, l’entreprise paie d’abord ses salariés et impôts de production avant d’obtenir son EBE, qui est une bien meilleure approximation de sa capacité à rembourser ses dettes que ne peut l’être la valeur ajoutée.
Au total, on remarquera que si l’endettement brut des entreprises françaises en pourcentage du PIB est passé de 56 % à 88 % de 2001 à 2020, il a régressé de 56 % à 47 % de leurs capitaux propres, en venant d’un plus haut de 75 % au premier trimestre 2009[2].
Si nous voulions jouer les macro-économistes, nous pourrions noter que les capitaux propres des entreprises sous revue sont donc passés de 100 % du PIB en 2001 à 187 % en 2020, soit de 1 500 Md€ à 4 028 Md€ (les dettes brutes sont passées dans l’intervalle de 840 Md€ à 1 888 Md€). Or, les capitaux propres étant l’indice de la capacité d’une entreprise à résister à une crise, on ne peut être que rassuré de cette évolution.
Sans être la meilleure mesure de l’importance des dettes des entreprises, le ratio dettes brutes/capitaux propres nous paraît largement supérieur au ratio dettes brutes/PIB.
Et si on le prend en dettes nettes des liquidités et non en dettes brutes, on peut même l‘estimer, fin 2020, à 25 % des capitaux propres.
Et comme l’INSEE publie une estimation de l’EBE des entreprises françaises dans ses Comptes de la Nation, 420 Md€ en 2019 et 371 Md€ en 2020, on peut calculer le ratio dettes bancaires et financières nettes/EBE qui s’établit en 2020 à 2,7 avec l’EBE de 2020 ou 2,4 avec celui de 2019.
Au total, il nous semble donc qu’il n’y a pas de quoi écrire à sa tante, ou en tout cas si on le fait, c’est pour lui recommander de ne plus prêter attention aux ratios dettes des entreprises/PIB.
Tableau : PER et taux de rentabilité ultérieur
Ce graphique publié par le Financial Times montre en abscisse le PER auquel vous achetez le portefeuille de marché (aux États-Unis), et en ordonnée le taux de rentabilité historiquement constaté 10 ans après sur votre investissement.
Avec notre casquette de pédagogue, et sans porter de jugement sur la rentabilité à 10 ans d’un investissement fait aujourd’hui sur le marché américain, nous nous réjouissons de ce graphique qui rappelle une fois de plus que taux et multiple varient en sens inverse.
Recherche : Financement entrepreneurial : le choix entre business angels et fonds de capital-risque
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Les fonds de capital-risque (en anglais, venture capitalists), acteurs essentiels du financement entrepreneurial, sont l’objet de nombreuses études académiques en Europe et aux États-Unis. La recherche académique sur les business angels (aussi appelés angel investors ou tout simplement angels[1]) est plus rare, en raison de la difficulté à obtenir des données suffisamment riches pour nourrir les études empiriques. Si les fonds de capital-risque sont des investisseurs professionnels qui investissent les fonds de leurs clients, les business angels sont des individus qui investissent en leur nom propre et engagent leur fortune personnelle ou celle de leur famille. L’article que nous présentons ce mois[2] constitue à ce titre une exception. Il exploite des données issues d’un programme de soutien aux entreprises mis en place en Colombie-Britannique, un état de l’ouest canadien. Les données couvrent la période de 1995 à 2009 et portent à la fois sur les business angels et sur les fonds de capital-risque ayant financé les entreprises concernées (469 jeunes pousses). La richesse de cette base permet aux auteurs d’étudier la question suivante : business angels et fonds de capital-risque sont-ils complémentaires ou substituables ? Leurs résultats empiriques vont dans le sens de la substituabilité.
Ils vont ainsi à l’encontre de la vision dominante du financement entrepreneurial, qui considère ces deux formes de financement comme complémentaires. Selon cette vision, les business angels fournissent les capitaux nécessaires au financement de l’entreprise dans les premières étapes de son développement, et en cas de succès les fonds de capital-risque prennent le relais pour financer la croissance. L’entreprise bénéficie de la complémentarité entre, d’une part, les business angels qui sont séduits par l’idée de départ et peuvent mobiliser leurs fonds rapidement, et, d’autre part, les fonds de capital-risque qui ont des moyens supérieurs et peuvent engager les fonds de leurs clients lorsque les perspectives de succès apparaissent. C’est sur ce modèle que se sont développées Google et Facebook, et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles il est considéré comme le modèle naturel du financement entrepreneurial.
Il existe cependant une autre vision, soutenue par l’article, selon laquelle ces deux formes de financement sont substituables. Selon cette vision, les entreprises financées par les business angels tendent à conserver ce mode de financement lorsqu’elles se développent, quitte à faire appel à des réseaux (angels networks) leur permettant d’accéder aux fonds nécessaires. Dans le même temps, certaines entreprises n’ont recours qu’aux fonds de capital-risque. Business angels et capital-risque seraient donc en concurrence, et le choix entre ces deux modes de financement dépendrait davantage de caractéristiques spécifiques à l’entreprise que du stade de son développement. L’obtention d’un financement par un business angel à un certain stade augmente de 30 % la probabilité d’un nouveau financement angel, et diminue de 25 % la probabilité d’un financement par capital-risque. Les effets sont inversés dans le cas d’un financement par capital-risque. Pour reprendre l’expression des auteurs, il existe un « effet dynamique négatif » entre business angels et fonds de capital-risque dans le financement des jeunes pousses.
Une fois identifiée la substituabilité, les auteurs étudient sa source. Une explication possible serait que les investisseurs orienteraient les étapes futures de financement vers des investisseurs de leur type. Un business angel pousserait l’entreprise dans laquelle il a investi à financer son développement en faisant appel à d’autres business angels (et de même pour les fonds de capital-risque). À partir d’un test économétrique[3], les auteurs écartent cette possibilité. Il semble que le choix entre les deux modes de financement dépende principalement des caractéristiques de la jeune pousse elle-même.
La force de cet article réside en cet échantillon original permettant de tester des effets difficilement mesurables sur l’ensemble des entreprises. C’est aussi une de ses limites : les entreprises de l’échantillon appartiennent toutes à une zone géographique limitée, et presque toutes à un même secteur (la haute technologie) en raison des objectifs du programme de soutien. Les résultats, s’ils devaient être généralisés, auraient toutefois des implications très concrètes. Si les business angels constituent des substituts au capital-risque et sont mieux adaptés à certaines entreprises, alors les politiques visant à favoriser le financement des jeunes pousses doivent englober ces deux modes de financement.
[1]Les Canadiens francophones emploient l’expression « investisseurs providentiels ».
[2] T. Hellmann, P. Schure et D. H. Vo , « Angels and venture capitalists: substitutes or complements? », Journal of Financial Economics, vol. 141, n° 2, à paraître août 2021, p. 454 à 478.
[3] Les auteurs utilisent le fait que certains modes de financement ont été favorisés fiscalement sur la période pour distinguer entre les deux explications possibles (technique de la « variable instrumentale »).
Q&R : Il y a actionnaires activistes et actionnaires activistes
Nous reproduisons ci-après le début de la préface que Virginie Morgon, présidente de la société d’investissement cotée Eurazeo, a écrite pour l’ouvrage de Simon Gueguen (qui rédige la rubrique « Recherche » de La Lettre Vernimmen.net) et de Lionel Melka, Les Fonds activistes, chez Dunod, qui permet de faire le tour de cette question, et que l’on peut lire sur la plage à défaut du Vernimmen 2022 !
« Dans l’univers de ce qu’on appelle improprement "l’industrie financière", je n’ai jamais été membre de l’école de la discrétion et de l’opacité. De celles et ceux qui, à partir des florissantes années 1980 et 1990, ont considéré que pour vivre heureux, il fallait vivre cachés, et que le secret et le mystère étaient les conditions du succès. D’une part, parce que la discrétion amène la confusion et que la confusion conduit au fantasme : celui d’une "finance sans visage", mue par son intérêt propre, soucieuse de ne rendre des comptes qu’à elle-même, à la fois marionnettiste et bouc-émissaire, idiote utile de dirigeants publics en quête de responsables, d’analyses trop simplistes et de populations angoissées par une mondialisation mal maîtrisée. Un fossé artificiel s’est creusé dans les discours et les esprits : d’un côté l’économie "réelle", celle des entrepreneurs, des salariés, de la production et de l’innovation ; de l’autre l’économie financière où tout se vaut et s’amalgame : private equity, hedge funds, pension funds, investment banking, spéculateurs, actionnaires… La confusion est partout, avec son lot de raccourcis et de caricatures. J’ai toujours pensé que la responsabilité principale en incombait aux acteurs financiers eux-mêmes, à notre incapacité collective à communiquer sur ce que nous faisons, à resituer nos métiers dans la chaîne de création de valeur, à démontrer notre utilité sociale et même notre nécessité.
C’est pourquoi l’ouvrage de Lionel Melka et Simon Gueguen, comme tous ceux qui exposent et expliquent ces métiers mal connus, est salutaire et doit être salué. Il vient à point nommé après des années riches en actualités et en débat sur l’activisme actionnarial.
Son sujet d’étude est exemplaire du constat général que je dresse. Derrière le terme "activiste", négativement connoté, il y a une réalité méconnue et multiple, des acteurs aux intérêts et aux méthodes divergentes.
Dans un souci de simplification, une confusion est née dans le débat public entre la méthode et la finalité des acteurs activistes. La méthode est communément admise : l’activisme est la manière par laquelle un investisseur use des prérogatives accordées aux minoritaires afin d’influencer la stratégie, la situation financière ou la gouvernance d’une société cotée, à travers une prise de participation qui peut demeurer mineure ou s’accroître au fil du temps. La finalité de l’activisme révèle une typologie complexe d’acteurs, très précisément décrite par les auteurs. Cette diversité oblige à un jugement nuancé sur cette forme de comportement actionnarial : perspective court terme ou investissement durable ; finalités managériales, stratégiques, financières ou ESG, chaque activiste développe des objectifs qui lui sont propres et rendent incongrue une classification de ce type d’acteur dans une catégorie uniforme.
Lorsqu’en 2008, Eurazeo, elle-même société cotée exemplaire en matière de gouvernance, que j’ai l’honneur de diriger, allié à Colony Capital, prend une participation dans le Groupe Accor, elle est qualifiée d’activiste. Lorsqu’elle cède sa dernière action dix ans plus tard, cette "campagne" a donné naissance à deux leaders mondiaux incontestés, Accorhotels et Edenred. Le groupe a même stabilisé sa gouvernance à travers une configuration rare où l’investisseur dit "activiste" – Sébastien Bazin – devint lui-même le dirigeant de la société dont il était l’actionnaire.
La question n’est donc pas de savoir s’il faut être pour ou contre le développement de l’activisme actionnarial, devenu au cours des dernières années une modalité d’action significative en Europe et aux États-Unis. L’enjeu est de distinguer ce qui relève de l’approche court-termiste, déstabilisante, menaçant l’intérêt social des sociétés concernées et la volonté d’autres acteurs dits "activistes"– la majorité ! – d’utiliser leurs prérogatives d’actionnaires minoritaires pour accompagner, transformer, influer positivement sur la stratégie et la conduite des affaires de sociétés dont ils veulent préserver et accroître la valeur au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes.
En résumé : si l’investisseur activiste est en fait un investisseur actif, alors il correspond à une évolution vertueuse qui résonne dans le monde des sociétés cotées avec le développement massif de l’industrie du private equity dans le non coté au cours des vingt dernières années.
Dans le premier cas, une régulation est utile et même nécessaire. Les auteurs évoquent les pistes possibles : elles tournent autour du renforcement du dispositif de transparence s’appliquant aux investisseurs prenant des positions publiquement, directement ou indirectement, en vue d’influencer la stratégie, la situation financière ou la gouvernance d’une société.
Dans le second cas, le nouveau type d’investisseur actif doit être encouragé, surtout, comme le relèvent les auteurs dans le dernier chapitre de cet ouvrage, quand il s’inscrit dans une démarche de prise en compte des sujets devenus si important de responsabilité sociale et environnementale par les entreprises. »
La suite est dans l’ouvrage Les Fonds activistes, disponible en librairie depuis mars[1].
Bonne lecture !
Autre : Formations
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Ingénierie financière » le 19 octobre 2021, à Paris.
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 19 novembre 2021, à Paris.
- « Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity » le 26 octobre 2021, à Paris.
- « Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2021 » le 27 septembre 2021, à Paris.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière, des réponses à des questions qui nous sont posées ou des citations.
Sic transit gloria mundi
Il était une fois dans les années 1990 un groupe coté (Poliet), actif dans la distribution de matériaux de construction (Point P), la fabrication de matériaux de construction (Weber et Broutin), contrôlant les Ciments français et détenant le contrôle à 100 % d’une pépite de la menuiserie industrielle, Lapeyre.
Comme son cours de Bourse était loin de refléter la valeur de ses actifs, Poliet prit la décision d’introduire en Bourse Lapeyre, et ce fut la première fois qu’en France on utilisa la technique de construction d’un livre d’ordres[2] pour ce faire. Ce fut un immense succès grâce aux qualités d’alors de Lapeyre : forte croissance, forte rentabilité, forte part de marché : bref, le L’Oréal de la menuiserie industrielle !
Il y a quelques jours, Saint Gobain, qui acquit le contrôle de Poliet en 1996, a cédé Lapeyre à Mutares, fonds spécialisé dans le redressement d’entreprises en très grandes difficultés, pour un prix négatif de 243 M€, soit environ 3 fois la perte annuelle. Mutares trouvera ainsi dans les caisses de Lapeyre de quoi financer un plan de redressement, et Saint Gobain, qui n’a pas réussi à le redresser, fait un investissement ultime dans Lapeyre avec un pay-back de 3 ans, ce qui ne court pas les rues.
Le CAC 40 tutoie-t-il actuellement ses plus hauts historiques de 2000 ?
Non. Il les a dépassés en janvier 2007, puis de nouveau en octobre 2013 et se situe actuellement à environ 2 fois son record de 2000, comme l’illustre ce graphique qui tient compte du réinvestissement des dividendes versés dans le CAC 40 au fur et à mesure où ils sont payés.
Seule la non-prise en compte des dividendes fait succomber à cette illusion d’optique qui voudrait que le niveau de 6 500 en 2021 soit équivalent au niveau 6 500 en 2000. Personne ne confondrait un euro d’aujourd’hui avec un euro de 2000. Le principe est le même, et pourtant cette erreur fait la une de beaucoup de média ces temps-ci. Elle trouve probablement sa source dans une situation où les particuliers étaient les premiers actionnaires directs des entreprises, mais pour cela il faut remonter quelques 100 ans en arrière.
Depuis, le développement des véhicules d’investissements collectifs (SICAV, assurance-vie, etc.) et plus généralement des gestionnaires d’actifs les a réduits à moins de 10 % du capital de la plupart des sociétés cotées de taille significative. Et que fait une SICAV qui reçoit un dividende ? Elle le réinvestit en attendant de céder des titres en portefeuille pour faire face à d’éventuels rachats dépassant les souscriptions. Que fait un particulier d’un dividende reçu sur son PEA ou son assurance-vie ? Il le réinvestit.
Plutôt que le CAC 40, dans la durée mieux vaut suivre le CAC 40 GR, avec réinvestissement des dividendes.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.
[2] Pour plus de détail sur la construction d’un livre d’ordres, voir le chapitre 27 du Vernimmen 2021.