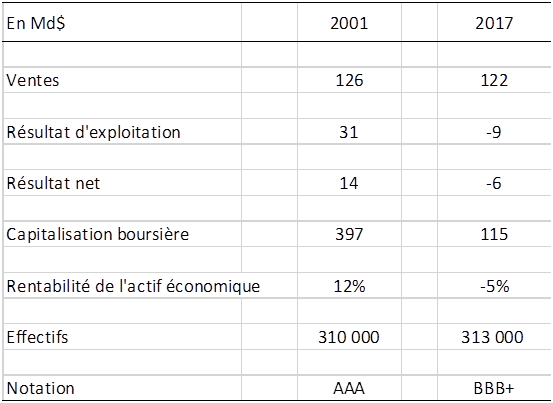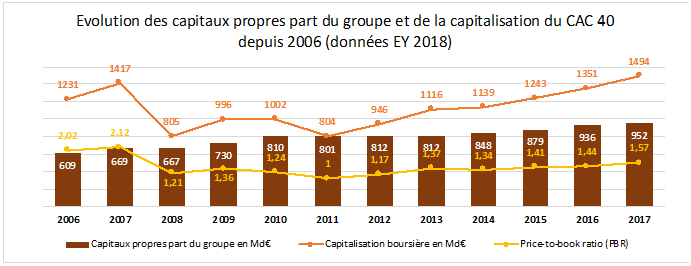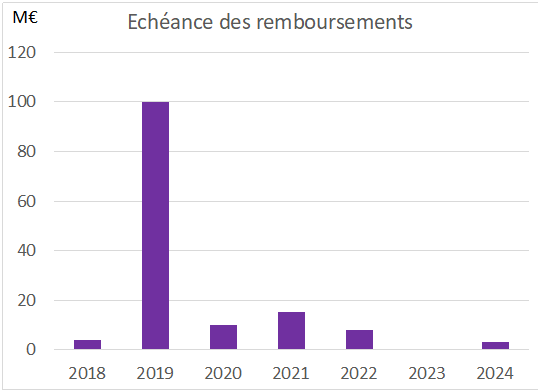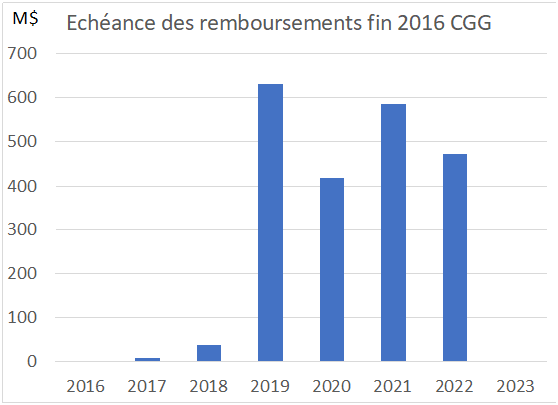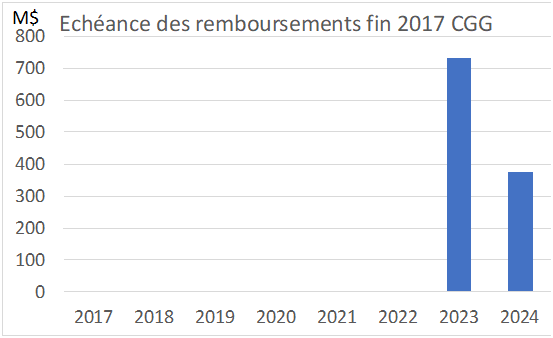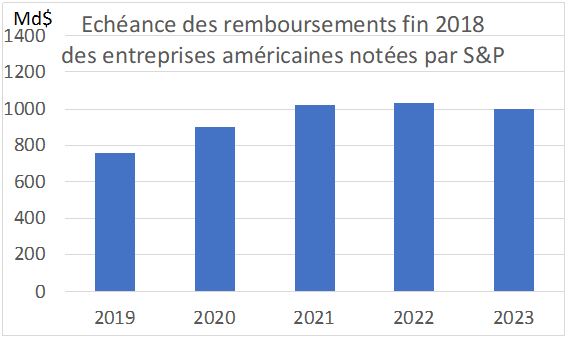La Lettre n°162 de Octobre 2018
Actualités : Les tribulations de General Electric ou l'éternel recommencement des conglomérats
Il y a une quinzaine d’années, nos étudiants étaient pour la plupart fascinés par General Electric, très désireux de rejoindre le groupe, réputé pour son programme de formation des jeunes diplômés avec 4 séjours de 6 mois dans 4 divisions différentes et dans 4 pays différents.
General Electric était alors la première capitalisation boursière mondiale (environ 400 Md$), la dette du groupe était notée AAA et Jack Welch, son patron récemment retraité, était une légende vivante.
Aujourd’hui, c’est une toute autre histoire. L’action s’est fait expulser de l’indice Dow Jones industriel dont elle faisait partie depuis l’origine, la notation de ses dettes est passée à BBB+ (ce qui n’a rien de déshonorant[1]). Les étudiants vibrent plus au nom de Uber, Tesla, Amazon ou L’Oréal. Et si General Electric était coté en France, ce serait la 5e capitalisation boursière derrière Total, LVMH, L’Oréal et Sanofi à 95 Md€. Depuis 2017, General Electric n’apparaît plus dans le classement des 20 premières capitalisations boursières américaines que nous publions en annexe du Vernimmen.
Un graphique et un tableau valent mieux que de longs discours pour analyser la situation :
Le graphique du cours de bourse de General Electric depuis 1962 :
qui montre une division par 4 de son cours de bourse depuis le plus haut (fugitif de 2001) et un retour au niveau où il était en 1996.
Et celui de l’évolution de ses performances boursières depuis son point haut du début des années 2000 :
Autrement dit, en 2017, General Electric a fait à peu près autant de chiffre d’affaires qu’en 2001 (environ 125 Md$), avec sensiblement le même nombre de personnes (un peu plus de 310 000), mais avec un résultat d’exploitation négatif de 9 Md$ contre un gain de 31 Md$ 16 ans auparavant…
Que s’est-il passé ?
Le choix des métiers exercés : l’allocation de ressources semble moins heureuse depuis le début des années 2010
Pour répondre à cette question, citons Henry Mintzberg, professeur de management à l'Université McGill de Montréal : « La façon de gérer un conglomérat est que vous ne le gérez pas. Vous choisissez de bons métiers et vous choisissez de bons managers pour les diriger. Point final. »
Après la longue carrière de Jack Welch à la tête de GE, le conseil d’administration a eu la main moins heureuse en matière de choix de dirigeants. Son successeur (J. Immelt) a été délicatement poussé vers la sortie en 2017 à 61 ans, et le successeur de celui-ci s’est fait montrer la porte au bout de 13 mois (J. Flannery).
Quant au choix des métiers exercés, l’allocation de ressources semble encore moins heureuse depuis le début des années 2010 : vente en 2013 de NBC Universal, alors que la valeur des actifs de média télévisuels et cinématographie bat en ce moment des records ; vente des activités de finance, GE Capital, post-crise de 2008 alors que la finance américaine est repartie très fort et que sa valorisation est au plus haut ; acquisition d’Alstom pour se renforcer dans les turbines des centrales thermiques alors que leur part de marché décline inexorablement, transition énergétique aidant ; renforcement dans les équipements pour l’industrie pétrolière juste avant la chute des prix du pétrole.
Soyons réalistes. De la même façon que l’on trouve rarement deux grands hommes à la suite, l’histoire a montré que l’on trouvait rarement deux grands managers à la suite pour gérer une organisation aussi complexe qu’un conglomérat.
Dans les pays où les marchés financiers sont peu développés, les conglomérats sont souvent un substitut qui alloue en son sein des capitaux rares par ailleurs entre les différentes activités. Pensons ainsi à Reliance en Inde, Cévital en Algérie, Argos en Colombie ou Schneider dans la France des années 1960.
De nouveaux conglomérats sont en train d’apparaître : Amazon, Alphabet, Tesla, Dyson, Alibaba, etc.
Quand les marchés financiers sont plus développés, la forme de conglomérat a du mal à survivre, car très souvent le groupe vaut moins que la somme des parties. Les investisseurs sont en effet confrontés à deux types de problèmes. Le premier est la complexité de l’analyse intrinsèque d’un conglomérat aux activités multiples et sans synergie dont le portefeuille s’impose à l’investisseur qui a le plus souvent la faculté, à son gré, d’être ou de ne pas être exposé à tel ou tel métier du conglomérat en achetant des actions d’entreprises mono-activité présentes dans les métiers du conglomérat. D’où un premier niveau de décote. Le second niveau de décote tient à la crainte de mauvaise allocation des ressources financières au sein du conglomérat, entre les activités fortement rentables et celles qui le sont moins. La crainte est que les flux de trésorerie disponible générés par les premières servent surtout à supporter les seconds et non pas à développer sans relâche les premières.
La seule façon d’y faire face, dans des marchés financiers à maturité, et de contrecarrer cette décote, est d’apporter un savoir-faire managérial particulier aux filiales, souvent développé ou conceptualisé par un manager brillant au charisme fort. Ainsi Harold Geneen et ITT dans les années 1960, qui apportèrent à de nombreuses entreprises les techniques de management modernes. Ainsi Lord Hanson et Hanson Trust au Royaume-Uni dans les années 1980, pour revitaliser des entreprises britanniques qui s’étaient endormies et aux généreux frais généraux. Ainsi Jack Welch et General Electric avec la méthode des Six Sigmas, pour améliorer la qualité et l’efficacité des processus. Mais une fois ces innovations managériales appliquées, puis étudiées et popularisées au-delà du conglomérat, son avantage compétitif disparaît et se pose la question de sa survie qui ne devient plus taboue quand le manageur mythique prend sa retraite ou disparaît. Dans des marchés financiers développés, le conglomérat survit alors rarement longtemps au départ de son Pygmalion.
Est-ce pour autant la mort annoncée des conglomérats, à l’instar du plus fameux d’entre eux, General Electric, qui est un peu l’arbre qui cache la forêt des conglomérats récemment disparus en tant que conglomérats ? Alstom, Maersk, Philips, Siemens, le groupe Fiat, Lagardère, Kering, Benetton, pour se limiter à l’Europe...
Non, car de nouveaux conglomérats sont en train d’apparaître. Amazon (distribution, services informatiques, production télévisuelle), Alphabet (Internet, médecine ? automobile ?), Tesla (automobile, batteries, panneaux solaires), Dyson (électroménager, automobile), Alibaba (e-commerce, paiements, services informatiques), etc. en se fondant sur une puissance financière et des marges inouïes qui permettent de financer des recherches tous azimuts. Et nous ne doutons pas que, dans la lettre Vernimmen n° 498 de mai 2051[2], nous vous parlerons de l’extinction de ceux-là, mais aussi de l’arrivée d’une nouvelle génération de conglomérats.
En attendant, nous vous donnons le nom du prochain conglomérat qui ne survivra pas longtemps à la disparition de son mythique fondateur : Berkshire Hathaway.
[1] Pour plus de détails, voir la Lettre Vernimmen.net n° 29 de mai 2004.
[2] Ou de juin 2051, difficile à dire pour l’instant
Tableau : Les capitaux propres en valeur et en montant comptable
Etabli grâce aux données que publie EY dans son profil annuel des groupes du CAC 40[1], le graphique suivant met en rapport la valeur des capitaux propres avec leur montant comptable.
La progression des capitaux propres est inférieure à la celle des capitalisations boursières
On remarque que, de 2006 à 2017, la progression du montant comptable des capitaux propres, 343 Md€, qui correspondent aux résultats nets réinvestis sous déduction des dividendes et des rachats d’actions et majorés des augmentations de capital, est inférieure à la progression des capitalisations boursières cumulées, 263 Md€. Ce qui veut dire que, d’un point de vue strictement financier, les actionnaires du CAC 40, en acceptant de ne pas se verser 343 Md€ de résultats en dividendes, mais de les réinvestir dans ces groupes, n’ont vu la valeur de leur patrimoine ne progresser que de 263 Md€, soit seulement de 77 % des fonds réinvestis. En relatif, ils se sont appauvris de 80 Md€ par rapport à une distribution intégrale des résultats.
On notera cependant qu’il suffirait d’une progression de 5 % de la valeur du CAC 40 pour effacer cette perte d’opportunité. Et comme on n’investit pas dans un portefeuille d’actions avec une vue à court terme…
L’explication principale de cet état tient à un Price Book Ratio d’un quart plus faible en 2017 comparé à 2006, principalement sous l’influence des groupes financiers qui, s’ils se sont nettement mieux comportés que leurs pairs européens, continuent toutefois à être moins valorisés que leurs capitaux propres comptables et, comme ils représentent environ 15 % du CAC 40 en 2017, leur poids dans le résultat final n’est pas négligeable.
Recherche : Environnement, parties prenantes et performance financière : des relations complexes
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à l’Université
de Cergy-Pontoise
La prise en compte d’intérêts multiples au sein d’une entreprise est un sujet complexe. Née dans les années 1980, la théorie des parties prenantes (stakeholder theory) considère que le développement et la survie à long terme de l’entreprise nécessitent la prise en compte des intérêts de toutes ses parties prenantes (salariés, clients et fournisseurs, pouvoirs publics, investisseurs de toute nature, etc.). Cette théorie s’oppose à la vision actionnariale, selon laquelle c’est l’intérêt des actionnaires qui prévaut. Beaucoup d’études ont été réalisées depuis pour savoir si ces deux visions étaient plutôt complémentaires ou opposées, c’est-à-dire si une prise en compte explicite des intérêts des parties prenantes favorisait ou pénalisait les actionnaires.
Trois chercheurs[1] ont voulu ajouter la préoccupation environnementale à l’équation. L’idée est la suivante : si cette préoccupation est partagée par les différents acteurs de l’entreprise, alors la prise en compte de l’environnement peut aider à résoudre le conflit entre actionnaires et parties prenantes. L’étude porte sur deux secteurs économiques bien choisis : l’agroalimentaire (food and beverage) d’une part, et les produits ménagers et de soin (household and personal products) d’autre part. Ces deux secteurs sont de gros consommateurs de ressources naturelles, et le public est particulièrement attentif à leur rapport à l’environnement.
L’article est techniquement très abouti. Les auteurs ont développé une nouvelle mesure de l’orientation « parties prenantes » des entreprises, en collaboration avec des experts et des dirigeants d’entreprise. Ils ont procédé de même pour construire un indice de « proactivité environnementale », dont l’objectif est de capter à la fois l’affirmation d’une prise en compte
de l’environnement et les initiatives environnementales prises par les dirigeants. Des questionnaires électroniques ont alors été envoyés aux cadres dirigeants (en charge des questions environnementales) des entreprises françaises des deux secteurs concernés en 2009 et 2010.
L’étude empirique consiste à étudier les liens entre trois variables : les deux variables ainsi construites et une variable de performance financière. Pour cette dernière, les auteurs utilisent alternativement le rapport du résultat au chiffre d’affaires (productivité) ou le rapport du résultat au montant investi (rentabilité). Ils obtiennent comme premier résultat un lien faible et légèrement négatif entre orientation « parties prenantes » et performance financière. Sur l’échantillon étudié, il semble donc que la prise en compte explicite des parties prenantes se fasse plutôt au détriment de l’intérêt des actionnaires. En revanche, la proactivité environnementale a un impact positif sur la performance financière. Surtout, et c’est probablement le résultat central de l’article, dans les entreprises proactives sur le plan environnemental, la relation entre orientation « parties prenantes » et performance financière devient positive. Autrement dit, une prise en compte active de l’environnement permet de réconcilier l’intérêt des parties prenantes et celui des actionnaires.
Les auteurs concluent donc sur
une complémentarité complexe entre environnement, parties prenantes et performances financières. Les résultats restent probablement dépendants de l’échantillon d’étude ; mais cet article propose une explication intéressante aux résultats contradictoires obtenus jusqu’à présent sur ce sujet. Les intérêts des parties prenantes sont divers et contradictoires, et la mise en place de bonnes pratiques en matière d’environnement et de soutenabilité permet de répondre à une partie de ces intérêts sans pénaliser la performance financière.
[1] F. BRULHART, S. GHERRA et B. V. QUELIN (2017), « Do stakeholder orientation and environmental proactivity impact firm profitability? », Journal of Business Ethics, pages 1 à 22.
Q&R : Qu'est-ce qu'un mur de la dette ?
Un mur de la dette, c’est quand un directeur financier n’a pas fait correctement son travail. Il a laissé se concentrer les échéances de la dette de son entreprise sur une ou deux années, n’a pas agi à l’avance pour en étaler le remboursement sur plusieurs années et se retrouve maintenant au pied du mur, c’est le cas de le dire, à la merci du bon vouloir de ses prêteurs et de la bonne tenue du marché de la dette. En effet, l’entreprise ne génère pas assez de flux de trésorerie disponible et de dispose pas d’assez de liquidités pour pouvoir rembourser la prochaine échéance de la dette. Voici un mur de la dette :
Si le problème est un problème de liquidité, trop de dettes venant rapidement à échéance, de nouvelles dettes sont levées pour rembourser par anticipation ou le moment venu les actuelles dettes afin d’en étaler la charge de remboursement sur plusieurs années.[1]
Quand un directeur financier a laissé se concentrer les échéances de la dette de son entreprise sur une ou deux années
Si le problème est un problème de solvabilité, trop de dettes tout court compte tenu de la capacité de génération de flux de l’entreprise et du montant de ses actifs, il faut envisager une restructuration beaucoup plus lourde du passif passant par des abandons de créances, des transformations de dettes en capitaux propres, une augmentation de capital et/ou des cessions d’actifs.[2]
En voici un exemple à fin 2016, celui de CGG, spécialiste des études sismiques pour les groupes pétroliers. CGG a entamé début 2017 des discussions avec ses créanciers pour restructurer son passif, négociations qui ont abouti à l’été 2017 et dont la mise en œuvre s’est achevée début 2018 pour des premières échéances de la dette à restructurer en 2019.
En ce domaine, l’anticipation est la clef du succès.
Post-restructuration, les échéances de remboursement de la dette de CGG sont devenues :
Bref, un nouveau mur, mais dans 5 ans, donc amplement le temps nécessaire pour rétablir une situation opérationnelle compromise et traiter le problème de ce mur de la dette de 2023.
Par contre, et à titre d’exemple, ne constitue pas un mur de la dette, comme trop de journalistes ont tendance à le croire, le profil suivant des remboursements arrivant à échéance au plus tard fin 2023 (des entreprises américaines notées par S&P) :
C’est un profil on ne peut plus normal, qui n’a rien d’inquiétant ou de sensationnel. Il ne témoigne pas d’un mur de la dette.
[1] Pour plus de détails, voir le chapitre 41 du Vernimmen 2019.
[2] Pour plus de détails, voir le chapitre 50 du Vernimmen 2019.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. Vous en trouverez quelques-uns publiés le mois dernier dans cette rubrique :
Gestion active, gestion passive
Morningstar, dans une étude de juin 2008 à juin 2018 sur 9 400 fonds européens actifs ou passifs et gérant 2 900 Md€, montre que les gérants actifs battent en 10 ans leurs concurrents passifs dans seulement deux catégories de fonds sur 49. Ce n’est pas une surprise pour ceux d’entre vous qui croient à l’efficience des marchés, dans le sens que lui a donné le prix Nobel Eugène Fama (voir le chapitre 16 du Vernimmen), ou à l’intelligence collective face à l’intelligence individuelle dans le traitement d’un très grand nombre de données.
La prise en compte de fonds passifs plutôt que des index auxquels ils se référent permet de tenir compte de leurs frais, même s’ils sont modestes, et donc de comparer les rentabilités nettes de frais pour les investisseurs.
Par contre, l’étude n’a pas éliminé de son très vaste échantillon les faux fonds actifs qui se prétendent actifs pour pouvoir facturer des commissions de gestion élevées mais qui, dans la réalité, se contentent de détenir un portefeuille similaire à celui de leur indice de référence, modulo quelques surpondérations ou sous-pondérations. Les autorités de marché leur font depuis peu la chasse et il est à souhaiter qu’elles soient efficaces pour éliminer cette forme de délinquance en col blanc.
Connaissez-vous Ester ?
C’est le European Short-Term Rate qui va remplacer l’Eonia à partir de 2020. Calculé par la BCE à partir du taux des emprunts en blanc (sans garantie) contractés en euros par les banques européennes pour une durée d’un jour, il résultera de la moyenne pondérée par les volumes des taux observés après élimination des 25 % des volumes consentis aux taux les plus élevés et des 25 % les plus faibles.
Il est donc nettement moins susceptible des lamentables manipulations observées il y a quelques années par des banques malhonnêtes qui faisaient de fausses déclarations pour influencer le calcul de l’indice ou cacher les vrais taux qu’elles payaient. ESTER est en effet calculé sur les transactions enregistrées auprès de la BCE et non sur de simples déclarations faites par les banques.
La valeur de Uber
S’il semble que la dernière transaction enregistrée sur Uber date de l’entrée de Toyota dans son tour de table pour 500 M$ en août 2018, valorisant la start-up mondiale à 72 Md$ ; il semble aussi que Goldman Sachs et Morgan Stanley l’aient valorisée il y a quelques semaines à 120 Md$ en vue d’une introduction en bourse qui pourrait intervenir début 2019 et pour laquelle ils ont été embauchés comme conseils.
Trois commentaires :
Il est extrêmement difficile de valoriser Uber, entreprise mondiale mais qui perd des montants encore substantiels, dont le modèle économique a toute chance de changer du tout au tout avec l’avènement de la voiture connectée. C’est dans ce contexte que la remarque d’un entrepreneur qui avait quitté l'école à 14 ans pour bâtir un groupe européen prend toute sa valeur : « le meilleur expert sur la valorisation, c’est celui qui fait le chèque » (Guy Verrecchia, président fondateur de UGC).
Les banques américaines n’ont aucune pudeur pour afficher des valorisations élevées pour obtenir un mandat d’introduction en bourse, qui de toute façon n’aura lieu dans le meilleur des cas que quelques mois après. Et ceux d’entre vous qui ont vu le film Pentagon papers se souviennent probablement de la mine déconfite de Katharine Graham/Meryl Streep quand elle découvre que le prix de l’introduction en Bourse du Washington Post sera plus bas de quelques dollars de ce que Lazard lui avait fait miroiter.
Au pire, il sera toujours temps de dire si l’introduction en bourse se fait, in fine à 90 Md$ par exemple, que c’est une bonne affaire pour les souscripteurs puisque l’on parlait de 120 Md$ quelques mois avant.
Qui vous a dit que la finance n’était pas aussi une affaire de marketing ?
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook et là pour LinkedIn.