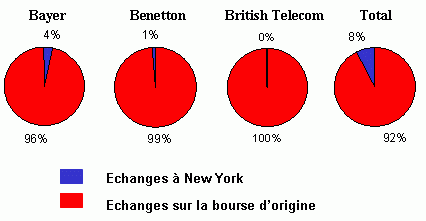La Lettre n°29 de Mai 2004
Actualités : Les entreprises doivent-elles se fixer un rating cible ?
Cette importance croissante est bien évidemment largement due à la transition de l’Europe continentale d’une économie largement intermédiée (économie bancaire) à une économie où les marchés financiers deviennent prédominants.
Ainsi, les directeurs financiers des groupes ne peuvent plus aujourd’hui s’affranchir de cette contrainte additionnelle. Le rating devient même une de leurs préoccupations premières (1). Les décisions financières sont alors prises en fonction de l’impact qu’elles auront sur le rating ; ou, plus précisément, les décisions ayant un impact négatif sur la notation seront rejetées.
Certaines sociétés se fixent même aujourd’hui des objectifs de rating (Vivendi Universal par exemple). Cela peut apparaître paradoxal à double titre :
- alors même que toute la communication financière s’axe autour de la création de valeur (pour l’actionnaire), les entreprises ont une propension beaucoup plus faible à se fixer publiquement des objectifs de cours de bourse qu’à se fixer des objectifs de rating;
- en se fixant des objectifs de notation financière les entreprises se fixent un nouvel objectif : celui de la préservation du patrimoine des obligataires ! C’est louable et se comprend dans un contexte d’une économie de marchés financiers, mais cela n’a jamais fait partie du pacte social.
Nous voyons plusieurs explication à ce paradoxe :
- tout d’abord, il faut reconnaître que la dégradation de la notation financière est une nouvelle majeure pour un groupe qui va bien au-delà de la communication obligataire. Elle est psychologiquement difficile à gérer et «fait désordre». Un downgrade s’accompagne presque systématiquement d’une baisse du cours de l’action (3). Donc en cherchant à préserver une notation financière c’est aussi le patrimoine des actionnaires que la direction de l’entreprise préserve, au moins à court terme ;
- une dégradation peut également avoir un coût immédiat si l’entreprise a émis des emprunt avec step up du coupon, c’est-à-dire une clause de majoration du coupon en cas de dégradation de la notation. Ce mécanisme vise à protéger les prêteurs contre un downgrade. Il accentue bien évidemment l’attention portée par l’entreprise à sa notation financière ;
- une bonne notation financière est garante d’une certaine flexibilité financière. Plus la notation est bonne, plus il sera facile d’émettre sur un marché, les transactions étaient alors moins tributaires des aléas des marchés. En particulier, une société qui est investment grade pourra quasiment tout le temps émettre des obligations (4) alors que les fenêtres de marchés se refermeront régulièrement pour les entreprises below investment grade (5). A cet égard, le coup de froid depuis un mois sur le marché du high yield est très illustratif puisque de nombreuses émissions ont dû être repoussées. Le marché du high yield se rapproche par cet aspect du marché actions ;
La flexibilité accrue des sociétés les mieux notées sera probablement accrue par la mise en vigueur des nouvelles normes de solvabilité pour les banques (Bâle II) (6). En effet, les prêts aux entreprises les mieux notées nécessiteront moins de capitaux propres réglementaires en regard. Les banques prêteront donc plus aisément à ce type d’emprunteur ;
- certaines banques vendent le concept d’amélioration du coût du capital, et donc d’optimisation de la valeur en fonction du rating. Ainsi, le coût du capital minimal serait obtenu pour une notation BBB. Cette approche repose sur l’économie fiscale apportée par les frais financiers (7) mais est contre-balancée à partir d’un certain niveau d’endettement par la valeur actualisée des coûts de faillite. Nos lecteurs qui nous connaissent savent que nous sommes peu adeptes de cet argument. Il nous paraît difficile, en effet, de soutenir que les sociétés notées BBB sont sensiblement mieux valorisées que les autres alors même que le rating moyen des sociétés est plus proche de A et que de grands groupes comme Nestlé ou Astra Zeneca avec des cash flows stables ne cherchent pas à jouer l’effet de levier pour au contraire garder une très bonne notation ;
De la même façon, se fixer comme objectif d’avoir le rating le meilleur possible, c’est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette ! On aura certes minimisé le coût de la dette. Et alors ? Si la conséquence est un niveau pléthorique de capitaux propres requis, le coût du capital n’en aura sûrement pas été baissé pour autant.
Le système a un effet encore plus pervers que la fixation d’un rating cible : certaines sociétés se refusent à être notées par les agences de rating, ou, demandent à être notées et conservent la notation confidentielle (shadow rating). Se faire noter fait donc peur et les directeurs financiers arbitrent alors entre le manque de flexibilité lié à l’absence de rating (émissions impossibles auprès de certains investisseurs, marché obligataire largement réduit,…) et le potentiel manque de flexibilité induit par une mauvaise notation.
A l’extrême, nous avons même rencontré des sociétés qui, dans le processus de notation initiale, cherchaient à obtenir le plus mauvais rating possible compte tenu de leur caractéristiques financières. Elles se ménageaient ainsi une flexibilité, une possibilité de dégradation marginale de leur situation sans que leur rating ne soit remis en question. Dans ce cas précis, la prudence a clairement un impact sur la valeur car une notation moins bonne est synonyme de coût de la dette plus élevé. Mais c’est la prime de la police d’assurance : elle paraît toujours trop chère avant l’accident.
Au total, la volonté de bon nombre d’entreprises de se fixer un rating cible rappelle que le choix d’une structure financière est d’abord le choix d’un niveau de risque qu’acceptent de courir les actionnaires et que le marché européen de la dette est en train de devenir un vrai marché avec des produits différents, segmentés, offerts aux investisseurs qui ont besoin de repères pour faire leurs choix.
(3) Voir le travail de recherche résumé dans la Lettre Vernimmen.net de juillet 2004.
(4) A des conditions plus ou moins bonnes …
(5) Voir pour plus de détails le chapitre 31 du Vernimmen.
(6) Voir la Lettre Vernimmen.net n° 20 du juin 2003.
(7) Voir pour de détails le chapitre 38 du Vernimmen.
Tableau : Les courbes de taux d'intérêt
Aujourd'hui, le paysage a totalement changé : les courbes de taux ont une forme normale (taux long terme supérieurs aux taux court terme) : les marchés s'attendent donc à une progression des taux courts par rapport à leurs niveaux actuels qui tous restent historiquement très bas.
La hausse des taux dont on parle beaucoup ne s'est pas encore véritablement matérialisée et paradoxalement, les entreprises bénéficient plutôt aujourd'hui d'une baisse du coût de leur endettement compte tenu de la baisse des marges (qui se rajoutent au taux sans risque pour un emprunteur). Outre une amélioration globale du risque des entreprises, la situation d'excédent de capitaux propres et donc les capacités de prêts non saturées de la plupart des banques européennes sont les principales raisons de cette sympathique évolution des marges.
La seule exception est le Royaume-Uni où la courbe des taux est plate : l'argent à 1 an coûte aussi cher que l'argent à 30 ans : un peu plus de 5% contre de 2,3% à 5% pour l'euro. Cette situation n'est pas durable puisque le risque n'est pas rémunéré. Il est clair que c'est la conséquence d'un resserrement précoce des taux par la Banque d'Angleterre pour lutter contre l'inflation.
S'il est un pays où ce sujet ne semble pas être à l'ordre du jour, c'est bien le Japon : l'argent à 1 jour coûte 0,03% (sic) et à 30 ans 2,30% !
Recherche : Introduction en bourse et informations contenues dans les livres d'ordres
Parmi les différentes méthodes d’introduction en bourses utilisées par les banquiers d’affaires, la procédure dite de bookbuilding, importée des Etats-Unis, représente une très large majorité des opérations d’introduction en bourse dans la plupart des pays occidentaux (1).
Au cours de cette procédure, le banquier conseil de l’opération d’introduction, qui peut agir seul ou au sein d’un syndicat, et l’entreprise introduite fixent un intervalle de prix d’émission indicatif. Sur la base de ce prix indicatif, la banque conseil peut alors promouvoir l’opération auprès d’investisseurs au cours de roadshows. Les investisseurs qui souhaitent participer à l’opération indiquent leur intérêt à travers la soumission d’ordres indicatifs (volume demandé) ainsi, qu’éventuellement, l’indication d’un prix limite au delà duquel ils ne souhaitent pas être servis. Sur la base de l’information recueillie, la banque conseil, qui tient le livre d’ordre, va pouvoir fixer un prix d’émission définitif et allouer de manière discrétionnaire les actions émises aux différents investisseurs à la date d’introduction.
Le pouvoir discrétionnaire dont bénéficie la banque conseil dans l’allocation des actions émises et la fixation du prix d’introduction a été interprétée de trois manières différentes par les chercheurs en finance.
La première interprétation, la plus ancienne, repose sur l’idée de L. Benveniste et P. Spindt (2), selon laquelle les investisseurs, qui ont une vue très claire sur la valeur de l’entreprise introduite, doivent être incités à révéler cette information pour permettre une introduction en bourse au prix le plus efficace. Les investisseurs qui fournissent l’information la plus détaillée sont récompensés en se voyant allouer une part plus importante de leur demande, et le prix d’introduction est fixé en dessous de sa véritable valeur pour les remercier de l’information qu’ils ont fournie.
La seconde interprétation repose sur l’idée que les banquiers conseils souhaitent favoriser la détention des actions émises par des actionnaires de long-terme qui ne revendront pas immédiatement après l’introduction en bourse. Dans le cas contraire, cela pourrait avoir pour effet de déprimer le cours à court terme. Par ailleurs, la création d’un actionnariat de long-terme peut être souhaitée par l’entreprise introduite.
Enfin, la dernière interprétation, cohérente avec les récents scandales mis à jour aux Etats-Unis par les enquêtes de la SEC, considère que les banquiers d’affaires utilisent leur discrétion afin de maximiser leurs profits au détriment de l’entreprise introduite en bourse. Les banquiers d’affaires génèrent des profits importants auprès de leurs grands clients institutionnels à travers, notamment, les commissions de trading. Ils vont donc favoriser ces clients en leur faisant bénéficier d’allocations importantes dans des introductions en bourse dont la sous-évaluation initiale est élevée. Par ailleurs, ils peuvent également faire bénéficier d’allocations généreuses les dirigeants d’entreprise auprès desquels ils souhaitent développer leurs activités rémunératrices de corporate finance. Ces comportements observés aux Etats-Unis et sanctionnés par la justice, devraient toutefois avoir aujourd’hui totalement disparus.
J. Jenkinson et H. Jones (3) étudient les livres d’ordre d’une banque d’investissement européenne concernant 27 introductions en bourse réalisées entre 1996 et 2001 en Europe suivant la procédure de bookbuilding. Dans ces livres d’ordre, le détail des offres des différents investisseurs (quantité indicative demandée) ainsi que les prix limites éventuellement associés sont consignés. Par ailleurs, les auteurs utilisent également une classification de la qualité d’un investisseur basée sur sa propension à être un actionnaire de long-terme. Cette classification, jugée relativement objective par les auteurs, a été effectuée conjointement par la banque étudiée avec quatre autres banques d’affaires.
Cette étude est très originale car c’est l’une des premières fois que des chercheurs ont eu accès à ce type d’informations non publiques. Il est vrai que H. Jones, un ancien banquier d’affaires, reconverti en professeur de finance a longtemps dirigé les activités d’émission d’actions et d’introduction en bourse d’une grande banque européenne.
Contrairement aux prédictions du modèle théorique de L. Benveniste et P. Spindt, J. Jenkinson et H. Jones ne trouvent pas que l’indication d’un prix limite par les investisseurs favorise une allocation supérieure d’actions à leur égard. La théorie des incitations à la révélation d’information par les investisseurs semble a priori invalidée par ces résultats. Par contre, les auteurs montrent que les investisseurs classifiés comme étant de long-terme sont davantage favorisés dans l’allocation des actions introduites en bourse, et ce d’autant plus que la demande est forte. Ils se voient attribuer un pourcentage de leur demande significativement supérieur à celui des autres investisseurs. Les banques d’affaires semblent donc favoriser les investisseurs de long-terme, ce qui correspond à un sentiment largement répandu parmi les praticiens.
Toutefois, il est difficile de totalement exclure l’hypothèse de la maximisation des profits par la banque d’affaires concernant ses activités annexes auprès de ces investisseurs. Il est en effet possible que cette classification soit biaisée. Ceci serait vrai, en particulier, si les autres banques d’affaires qui ont élaboré cette classification ont les mêmes clients les plus profitables, ou si toutes ces banques se sont entendues pour favoriser leurs clients les plus profitables à travers ce classement supposé objectif.
Il est intéressant d’analyser la décision de Google concernant son IPO à la lumière des résultats de cette étude. Rappelons que Google a prévu de s’introduire en bourse en levant 2,7 Md$ d’ici quelques mois. Google a obtenu de ses conseils financiers de ne pas utiliser la procédure habituelle de bookbuilding, mais d’organiser une enchère ouverte à tous, sans discriminations possible de la part de ses banques conseils. Plusieurs interprétations sont possibles pour expliquer ce choix, mais l’étude de Jenkinson et Jones suggère que i) Google n’est pas préoccupé par la sélection d’actionnaires de long-terme et ii) Google souhaite limiter la discrétion de ses banquiers conseils afin de limiter leurs profits générés par cette opération et les retombées de cette opération auprès des clients de ces banques.
Concernant le premier point, le besoin pour Google et ses fondateurs d’avoir des actionnaires de long terme n’est pas important dans la mesure où les fondateurs de l’entreprise conservent une majorité de contrôle, grâce à la création de plusieurs catégories d’actions dont certaines avec des droits de vote préférentiels qu’ils conserveront, alors que les actions à droits de vote limité font l’objet de l’émission. L’actionnariat de long terme n’est donc pas une préoccupation pour l’équipe dirigeante de Google, ou en tout cas, elle ne pense pas qu’il puisse être obtenu par la processus du livre d’ordres et de l’allocation discrétionnaires par les banques introductrices. En ce qui concerne le second point, Google limite le pouvoir discrétionnaire de ses banquiers introducteurs afin de ne pas leur laisser une rente trop importante pour une opération de cette envergure, à la fois en termes de commission, mais également en termes de sous-évaluation de la véritable valeur d’introduction de l’entreprise. Rappelons que cette sous-évaluation est supposée être utilisée par les banquiers pour récompenser leurs bons clients lorsqu’ils possèdent un pouvoir discrétionnaire d’allocation des actions sous-évaluées.
Il sera sans doute intéressant d’observer le comportement du cours de l’action Google le jour de l’introduction en bourse pour voir si la rentabilité initiale, et donc la sous-évaluation, aura été limitée par cette procédure.
(2) L. Benveniste et P. Spindt “ How Investment Bankers Determine the Offer Price
and Allocation of New Issues ”, Journal of Financial Economics, 2, 1989.
(3) J. Jenkinson et H. Jones « Bids and Allocations in European IPO Bookbuilding », Journal of Finance, à paraître en octobre 2004.
Q&R : Comment peut-on quitter les bourses américaines ?
Funeste erreur avec le recul ! La simple comparaison de la répartition des volumes de transactions en 2003 pour ces groupes européens montre finalement le peu d’intérêt de l’opération :
La liquidité appelant la liquidité, la globalisation aidant, les investisseurs vont là où se trouve le marché directeur. Et pour la quasi totalité des groupes européens, ils sont en Europe.
Comment faire marche arrière ? C’est malheureusement en l’état actuel presque mission impossible !
Certes les règles de retrait de la cote des bourses américaines ont été assouplies récemment : il suffit de fournir une décision du conseil d’administration puis de demander à la SEC l’interruption de l’enregistrement des titres.
Cependant, le retrait de la cote est une chose et la fin des obligations découlant des enregistrements passées auprès de la SEC en est une autre.
A ce niveau, de deux choses l’une : soit le nombre d’actionnaires résidant aux Etats-Unis est inférieur à 300 et dans ce cas là, l’entreprise n’a plus d’obligation à l’égard de la SEC. C’est ainsi que LVMH pu quitter le Nasdaq il y a deux ans.
Dans le cas où le nombre d’actionnaires résidant aux Etats-Unis est supérieur à 300, il existe bien une exception pour mettre fin aux obligations d’informations financières mais qui n’est accessible qu’à condition d’avoir de facto moins de 300 actionnaires résidents américains (sic) …
Faut-il pour autant désespérer ? Non car les autorités boursières américaines prennent conscience que la quasi impossibilité de se retirer du marché américain pour une société déjà cotée sur un autre marché pénalise les nouvelles introductions en bourse : Porsche, Daiwa, et Fuji Photo ont ainsi annulé leurs projets de cotation aux Etats-Unis.
Des associations de sociétés cotées européennes ont proposé que les sociétés cotées à New-York puissent mettre un terme à leurs obligations d’enregistrement auprès de la SEC deux ans après un appel public à l’épargne ou après une introduction en bourse si le volume d’échange aux Etats-Unis est inférieur à 5 % du volume total enregistré sur la valeur.
R. Pozen, professeur de droit à Harvard, suggère de son coté que dès lors qu’une offre équitable de retrait ait été faite en liquidité aux actionnaires américains, l’émetteur puisse quitter pour de bon le marché américain. Un expert indépendant comparerait alors le coût pour l’investisseur américain des transactions aux Etats-Unis et à l’étranger, évaluerait le niveau d’information requis sur la place d’origine de l’entreprise par rapport à celui requis aux Etats-Unis et enfin mesurerait le surcoût fiscal pour l’actionnaire américain d’une imposition de dividendes versés hors des Etats-Unis au lieu de l’être aux Etats-Unis comme avant le retrait. A cette aune, l’expert attesterait du caractère équitable de l’offre. Une fois celle-ci faite, refusée ou non par plus ou moins de 300 actionnaires résidents américains, l ’entreprise pourrait avoir mis fin à ses souffrances.
Yes, there is hope Virginia !