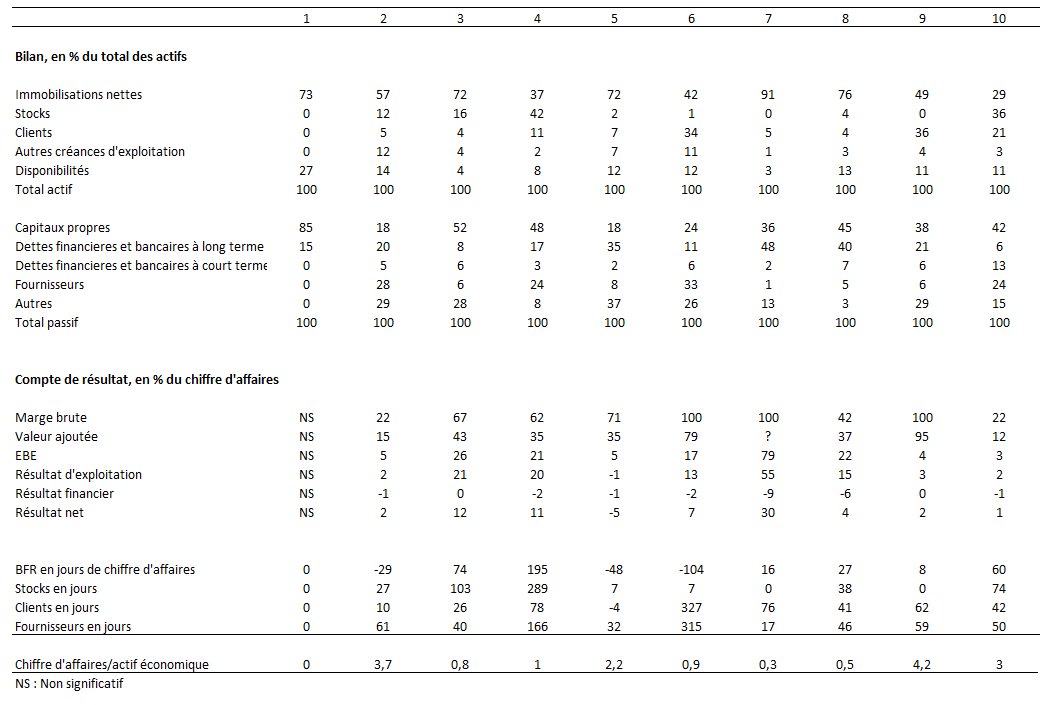La Lettre n°120 de Décembre 2013
Actualités : Réflexions sur les pratiques d'évaluation
Les professeurs Franck Bancel et Usha Mittoo ont interrogé environ 400 spécialistes européens de l’évaluation de société provenant d’un horizon assez large (banquiers d’affaires, gestionnaires de portefeuilles, gestionnaires de fortune, analystes financiers, directeurs financiers, experts en évaluation) sur leur pratique de l’évaluation d’entreprise.[1]
Dans les méthodes utilisées par les praticiens, il y a une prédominance très nette de l’actualisation des flux de trésorerie disponibles et des méthodes des comparables[2]. L’actualisation des dividendes, qui était la principale méthode jusqu’au milieu des années 1990, est en voie de disparition du fait de ses imperfections et de la généralisation des tableurs qui permettent de mener des actualisations de flux de trésorerie disponibles, normalement plus fiables. Elle ne disparaitra probablement pas totalement compte tenu de ses applications pertinentes dans le secteur financier. Une quinzaine d’années après lui avoir prédit un très grand avenir[3], il est vrai dans un contexte qui s’y prêtait (celui de la bulle TMT), la méthode des options réelles ne décolle toujours pas. Pour nous elle reste un cadre conceptuel intéressant qui permet de modéliser la flexibilité mais dont les applications pratiques risquent d’attendre encore longtemps[4].
On regrettera que 29 % des sondés utilisent encore des montants comptables, et non de valeurs financières, pour calculer le coût moyen pondéré du capital, ce qui est une erreur de logique puisque les taux de rentabilité requis sont des données de marché et que le concept de coût du capital n’a rien de comptable.[5] Mais on se réjouira que 71 % des sondés ne fassent pas cette erreur !
La vaste majorité des sondés utilise comme taux de l’argent sans risque celui des obligations d’Etat dont les dernières années écoulées ont démontré qu’elles n’étaient pas nécessairement sans risque de variations des cours compte tenu d’une solvabilité devenue, pour certains d’entre eux, relative. Nous préférons pour notre part utiliser des bons du Trésor à court terme d’un Etat noté AAA, ce qui dans la zone euro veut dire l’Allemagne.[6] On a alors vraiment conformément à la théorie financière un actif sans risque.
C’est sur les modalités de calcul du coefficient bêta que les pratiques diffèrent le plus et ce n’est guère étonnant car un évaluateur est rarement un saint : il a le plus souvent un objectif en tête et le coefficient bêta est un facteur d’ajustement important... Historique ou prospectif, calculé contre un indice étroit ou large, sur une durée courte ou longue, avec une fréquence journalière, hebdomadaire, voire mensuelle, calculé comme une moyenne ou une médiane de bêtas de sociétés comparables, avec ou sans impact fiscal (sans pour nous est la règle[7]), avec un bêta de la dette postulé nul ou calculé, etc…, le champ des possibles est très vaste et peu codifié.
Plus de deux tiers des évaluateurs prennent en compte une prime d’illiquidité ou de taille pour des entreprises plus petites. C’est toujours plus facile de faire accepter aux parties cette décote au niveau du taux d’actualisation qu’au niveau de la valeur finale. Dans un cas elle apparaît comme scientifique, dans l’autre elle semble relever du tripatouillage. Mais le résultat est le même et a le bon sens de son coté.
Que d’encre la valeur terminale n’a-t-elle pas fait couler et ne fera-t-elle pas couler ? 28 % des évaluateurs la calculent à partir d’un multiple, ce qui nous semble, disons les choses nettement, une hérésie. On est dans une méthode intrinsèque, restons y jusqu’au bout et laissons les multiples aux méthodes comparatives !
Seuls 18 % des évaluateurs ont recours à la technique du cash flow fade[8] qui permet de s’assurer que l’on actualise pas à l’infini des flux de trésorerie reposant sur l’hypothèse irréaliste d’une entreprise gagnant indéfiniment plus que son coût du capital. 18 %, c’est mieux qu’il y a 15 ans où quasiment personne n’y avait recours, mais cela reste encore très insuffisant. Ne pas avoir une réflexion en fin de période du plan d’affaires sur la rentabilité économique de l’entreprise par rapport à son coût du capital est pour nous la porte ouverte à tous les abus.
Il y a moins de progrès à faire quant à la valeur de la dette à prendre en compte qui, pour 43 % des évaluateurs, n’est pas son montant comptable. Cela doit correspondre peu ou prou à la proportion des cas où le sujet se pose vraiment : la solvabilité de l’entreprise a fortement varié depuis que sa dette a été émise et / ou les taux d’intérêt ont varié significativement depuis pour les dettes à taux fixe.
On laissera le mot de la fin à un sondé qui rappelle que la méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponibles avec tous ses détails donne l’impression de la précision alors que ce modèle peut être extrêmement sensible aux hypothèses retenues et donc pas du tout précis.
[1] L’étude peut être consultée en cliquant ici
[2] Pour plus de détails sur ces méthodes voir les chapitres 26 et 35 du Vernimmen 2014
[3] Nous nous rappelons d’une conférence de McKinsey en 1999 annonçant qu’elle remplacerait sous dix ans l’actualisation des flux de trésorerie disponibles. . .
[4] Pour plus de détails, voir le chapitre 34 du Vernimmen 2014
[5] Pour plus de détails, voir le chapitre 33 du Vernimmen 2014
[6] Pour plus de détails, voir la Lettre vernimmen.net n° 111 de décembre 2012
[7] Pour plus de détails, voir le chapitre 33 du Vernimmen 2014
[8] Pour plus de détails, voir le chapitre 35 du Vernimmen 2014
Tableau : Le taux de défaut des entreprises ayant émis des obligations cotées dans le monde depuis 1981
Source : Standard and Poor’s
Si la proportion d’entreprises ayant émis des obligations cotées et qui font défaut sur celles-ci est à peu près la même au pic de chaque crise (3 à 4 %), les montants absolus concernés progressent fortement : de 25 Md$ en 1991 à 120 M$ en 2001 et 628 Md$ en 2009. Soit 20 % en moyenne annuelle.
On y voit la conséquence de la croissance de l’économie en général, de la montée de la part des emprunts high yield (en particulier mais pas uniquement due aux opérations de LBO) et de l’augmentation de la part des dettes de marché au sein de l’endettement des entreprises.
Recherche : Le pouvoir des managers en interne : une source d'inefficacité ?
avec la collaboration de Simon Gueguen - Enseignant-chercheur à Paris Dauphine
La manière dont les grandes firmes multinationales allouent leur capital entre les différentes entités opérationnelles qui les constituent est désignée par l’expression « marchés de capitaux internes ». L’efficacité de ces mécanismes d’allocation fait l’objet de diverses théories que l’absence de données ne permet pas de confirmer ou d’infirmer. L’article que nous présentons ce mois-ci[1] est donc particulièrement intéressant : les auteurs ont obtenu l’accès à des données très détaillées concernant le marché de capitaux interne d’une firme multinationale. Ils montrent, sur cette étude de cas, que les managers des entités opérationnelles usent de leur influence pour tenter d’obtenir la plus grosse part du financement, et que ce jeu d’influence peut se faire au détriment de l’efficacité de l’entreprise.
Le fonctionnement des marchés de capitaux internes a été étudié du point de vue théorique par de très grands noms de la recherche en économie. Du côté des optimistes, on trouve par exemple Oliver Williamson (prix Nobel 2009). Dans ce type de modèle, les marchés de capitaux internes agrègent les flux de trésorerie générés par les différentes entités et les fonds sont réalloués aux entités en fonction de leurs opportunités d’investissement. Le mécanisme d’allocation est efficace et créateur de valeur. Du côté des pessimistes, on trouve par exemple Ronald Coase (prix Nobel 1991), selon qui le pouvoir des managers en interne est l’élément déterminant de l’allocation des fonds. Les marchés de capitaux internes sont alors destructeurs de valeur pour deux raisons :
-
le temps passé par les managers à user de leur influence pour obtenir les meilleurs financements représente un coût inutile pour l’entreprise ;
-
l’allocation des fonds ne se fait plus selon un critère de création de valeur.
Si les auteurs ne dévoilent pas l’identité de l’entreprise étudiée, nous savons qu’elle est constituée de 20 entités opérationnelles, réparties en cinq départements (représentant les secteurs d’activité) eux-mêmes sous l’autorité du siège central. Les départements n’ont pas de budget propre et ne constituent qu’un intermédiaire hiérarchique ; le choix du financement se fait au niveau des entités opérationnelles. L’entreprise ne présente pas de spécificité particulière dans ses données financières ; le levier financier est un peu plus faible et le taux de distribution des dividendes un peu plus élevé que la moyenne des entreprises du Dow Jones.
L’étude porte sur cinq années (2002 à 2006). Les auteurs comparent, pour chaque année et chaque entité opérationnelle, le budget prévisionnel d’investissements et les investissements effectivement réalisés. Ils montrent dans un premier temps que le budget prévisionnel surestime dans 73% des cas les investissements réalisés. Ceci a déjà été observé dans le passé, on parle de prudence budgétaire excessive (budgetary slack). L’idée principale de l’article est d’étudier ce qui se passe lorsque survient en cours d’année une entrée de cash non liée à la performance d’une entité ; typiquement, la vente par l’entreprise d’une participation significative jugée non stratégique. La manne (cash windfall) ainsi obtenue est pour partie (9% du total) réinvestie à travers les différentes entités opérationnelles. Les montants sont élevés : le total constitue une hausse de 62% des investissements de l’entreprise. Les auteurs montrent que l’augmentation des investissements dans les entités dirigées par des managers influents est 74% plus élevée que dans les autres entités[2].
La question suivante est celle de l’efficacité ou l’inefficacité de ce mécanisme. Il serait concevable que le pouvoir du manager soit un moyen de réduire les problèmes d’asymétries d’information dans l’allocation du capital ; dans ce cas, les investissements supplémentaires réalisés seraient créateurs de valeur. A l’inverse, il est possible que ce jeu d’influence vienne détourner les fonds des meilleurs investissements. Dans le cas étudié, le résultat est clair : le processus est inefficace. Les auteurs ont mesuré la performance ex post des investissements (à partir de 2006). Ils montrent que les entités opérationnelles qui ont reçu un financement supplémentaire grâce à l’influence de leurs managers affichent par la suite une moins bonne performance, que ce soit en termes de rentabilité, de profit économique (ou economic value added)[3], ou de productivité.
Les résultats de cet article ne peuvent bien entendu par être généralisés, car ils ne portent que sur une seule entreprise. Ils montrent toutefois que les jeux d’influence internes peuvent être destructeurs de valeur. Les conséquences managériales sont simples : il est utile de procéder à une rotation régulière des managers dans les différentes entités, et il est nécessaire d’établir des règles d’allocation du financement en cas d’entrée de cash qui soient fondées sur des critères d’efficacité économique.
[1] M.GLASER, F.LOPEZ-DE-SILANES et Z.SAUTNER (2013), Opening the black box: internal capital markets and managerial power, Journal of Finance, vol.68, n°4.
[2] L’article est très complet et les auteurs utilisent différents indices de mesure de l’influence des managers (leur temps passé dans l’entreprise, leurs connexions personnelles avec les grands dirigeants de l’entreprise, leur réseau social…) ;
[3] Pour une description de ce concept, se référer à Vernimmen 2014, page 637.
Q&R : Qui est qui ?
Afin que vous neurones ne s’endorment pas en ces temps festifs, nous soumettons à votre sagacité cette enquête policière digne des meilleurs analystes financiers comme des débutants. N’écrivons nous pas [1] que « ... l’analyste est un Myron Bolitar ou un Hercule Poirot moderne ...» Qui est qui ? vous invite à découvrir quels secteurs économiques se cachent derrière la série de chiffres qui suit.
On cherche :
-
Un distributeur généraliste,
-
Un groupe de luxe,
-
Une agence de publicité,
-
Un cimentier,
-
Un négociant de produits sidérurgiques,
-
Un groupe de travail temporaire,
-
Un opérateur de satellites,
-
Une compagnie aérienne
-
Un producteur de cognac
-
Une société holding.
Il y a deux façons de procéder pour résoudre cette énigme. Soit vous partez du tableau de chiffres en identifiant dans chaque ligne les chiffres les plus bas ou les plus élevés et devinez de qui il peut s’agir. Soit partant de la liste des entreprises, vous réfléchissez aux caractéristiques économiques et financières que chacune d’elle a, puis vous la repérez dans le tableau de chiffres. Cette seconde méthode nous paraît plus riche car elle conduit à réfléchir in abstracto aux caractéristiques financières d’une entreprise avant de l’étudier, ce qui permet de détecter plus facilement des anomalies.
Nous publierons les réponses dans le prochain numéro de la Lettre Vernimmen.net, mais les plus impatients d’entre vous peuvent les trouver sur le site vernimmen.net en cliquant ici.
[1] Au chapitre 9 du Vernimmen 2014
Autre : NOS LECTEURS ECRIVENT : Valorisation des entreprises et croissance de leurs résultats
par Francois Meunier
On dit souvent que les entreprises à forte croissance de leurs résultats ont des valorisations plus élevées que les entreprises à faible croissance. Ou encore, pour corriger de l’effet de taille, que leurs multiples de résultat dépendent positivement du taux de croissance, ceci valant qu’on retienne un multiple du résultat d’exploitation (P/EBIT) ou le classique multiple du bénéfice net (ou P/E). Ce billet montre que la relation est plus complexe qu’on le dit : une croissance des résultats peut conduire à faire baisser les multiples si l’investissement nécessaire à cette croissance mange une trop grande part des résultats.
* * *
Vernimmen (2014) indique (p. 510, §26.18) : « Toutes choses égales par ailleurs, de fortes perspectives de croissance du résultat d’exploitation se traduisent par un multiple du résultat d’exploitation élevé ; de faibles perspectives de croissance par un multiple du résultat d’exploitation faible. »
Pour appuyer ceci, l’ouvrage reporte le graphique d’une régression linéaire (source : Exane- PNP Paribas ; voir ci-dessous) du multiple du résultat d’exploitation sur la croissance de ce résultat. Il montre bien une relation croissante entre les deux agrégats. On observe grossièrement que cinq points de croissance en plus signifient en moyenne deux points de multiple en plus.
Mais une explication de ce lien est nécessaire. Partant du modèle simple de Gordon-Shapiro, si utile en évaluation d’entreprise, on écrit ainsi la relation entre la valeur d’une entreprise et le taux de croissance tendancielle de ses résultats (entre autres facteurs) :
 relation dans laquelle F est le flux net de trésorerie de l’année à venir (avant service de la dette), r le coût du capital et g le taux de croissance du résultat d’exploitation.
relation dans laquelle F est le flux net de trésorerie de l’année à venir (avant service de la dette), r le coût du capital et g le taux de croissance du résultat d’exploitation.
Le multiple de résultat d’exploitation ou encore Price to EBIT s’écrit alors, en désignant par B le résultat d’exploitation :
Comme on le sait, le multiple du résultat d’exploitation, dans ce cadre simplifié, est donc égal à une rente de montant F/B , qui est la part du flux net de trésorerie dans le résultat d’exploitation, actualisée comme précédemment au coût du capital corrigé de la croissance.
Ainsi, on est tenté de conclure que, naturellement, le multiple dépend positivement de la croissance[1].
Cette conclusion est fausse. C’est oublier que lorsque la croissance est plus forte, le ratio F/B ne reste pas constant. Au contraire, il se réduit, de sorte que l’effet sur le multiple de résultat est à ce stade incertain.
Il faut préciser ce qu’est le flux net de trésorerie. C’est le montant de résultat que les investisseurs, actionnaires et créanciers, peuvent « extraire » de l’entreprise après que celle-ci a assuré ses dépenses d’investissement pour maintenir son sentier de croissance. Plus la croissance est forte, plus les dépenses d’investissement sont élevées[2].
Comptablement :
F = B - investissement = B - gK formule dans laquelle K est la valeur du capital à son coût de remplacement, qu’on assimilera à la valeur comptable de l’entreprise. g K est bien le montant d’investissement (net d’amortissement) qui permet au capital de croître au rythme g.
Si donc la croissance exige des quantités d’investissement importantes, le multiple de résultat peut fort bien croître en raison de la hausse des résultats attendus, mais sur un montant de résultat amputé des dépenses d’investissement. A nouveau, l’effet est ambigu.
On sait que la valeur comptable de l’entreprise n’est en général pas égale à sa valeur de marché, de multiples facteurs intervenant, tels que des positions de monopole, des brevets et licences, des rendements d’échelle non constants, une avance dans l’innovation par rapport aux concurrents, des mauvaises représentations comptables notamment du capital immatériel, des barrières réglementaires, etc. Investir 10 M€ dans une entreprise va accroître la valeur comptable de l’entreprise de 10 M€, mais pourra accroître sa valeur boursière de 15 M€ en raison d’un phénomène de création de valeur tel que listé précédemment.
Appelant  le ratio rapportant la valeur de l’entreprise à sa valeur comptable (ou encore price-to-book ou q de Tobin), on peut donc réécrire ainsi la relation (1) :
le ratio rapportant la valeur de l’entreprise à sa valeur comptable (ou encore price-to-book ou q de Tobin), on peut donc réécrire ainsi la relation (1) :
Ou encore, après réarrangement des termes :
Le multiple est donc bien une fonction de la croissance, mais un peu moins simple que le donne à penser la relation de Gordon-Shapiro.
En particulier, si le price-to-book est structurellement égal à 1, – et donc en absence de pure création de valeur –, l’équation (2) se réduit simplement à :
 Le multiple ne dépend plus alors de la croissance ; il est l’inverse du taux de rendement ou coût du capital.
Le multiple ne dépend plus alors de la croissance ; il est l’inverse du taux de rendement ou coût du capital.
* * *
Pour fixer les idées empiriquement, on retient une croissance structurelle des résultats de 4%, un coût du capital de 8% et un price-to-book égal à son niveau structurel sur les bourses occidentales de 1,25X (de sorte que le correctif dans l’équation (2) vaut:  ). On montre alors que la variation du multiple en fonction du taux de croissance vaut 40[3]. On retrouve bien le fait, documenté dans le graphique mentionné plus haut, que 5 points de taux de croissance font 40 x 0,05 = 2 points de multiple[4].
). On montre alors que la variation du multiple en fonction du taux de croissance vaut 40[3]. On retrouve bien le fait, documenté dans le graphique mentionné plus haut, que 5 points de taux de croissance font 40 x 0,05 = 2 points de multiple[4].
En clair, le multiple des résultats, résultat net ou résultat d’exploitation, ne dépend de la croissance des résultats que pour autant que l’investissement nécessaire à obtenir cette croissance n’obère pas le niveau de ces résultats. Pour qu’il y en aille ainsi, il importe que l’entreprise soit en situation de création de valeur, c’est-à-dire que son price-to-book soit supérieur à 1. Pour une entreprise dont le price-to-book est structurellement inférieur à 1, un supplément de croissance revient à faire baisser ses multiples boursiers. Quand McDonald’s construit un n-ième restaurant dans une zone non saturée pour un coût de 5 M€ et une rentabilité annuelle de 1,5 M€, la valeur créée pour le groupe est de 12 M€, soit un price-to-book marginal de 2,4X. Croissance vaut alors hausse du multiple. Quand une banque européenne aujourd’hui lève 1 Md€ pour renforcer son capital et financer sa croissance, et que son price-to-book est de 0,8X, elle détruit, au nom de sa croissance ou de sa solvabilité, 200 M€, ce qui refroidit les ardeurs.
Il n’y a pas de surprise. On retrouve ce résultat de la microéconomie de l’entreprise selon lequel une entreprise qui connaît des rendements d’échelle constants dans un marché concurrentiel n’arrive pas à dégager de surprofit au-delà de la rémunération normale du capital. Le niveau de sa production, et donc sa croissance, est indéterminée et n’a pas d’impact sur sa valorisation en termes de ses résultats. Investir n’augmente la valeur de l’entreprise qu’à condition que cela permette une création de valeur.
[1] On note que cette relation perd son sens lorsque le taux de croissance des résultats est égal ou dépasse le coût du capital.
[2] La formule considère comme investissement la formation de capital fixe ainsi que la variation de capital circulant ou BFR. On omet aussi, sans conséquences, l’impôt dans le raisonnement.
[3] La variation du multiple en fonction du taux de croissance s’écrit en effet (en dérivant par rapport à g) :
[4] La relation linéaire est estimée sur base d’un échantillon de plusieurs entreprises à une date donnée. Il faudrait pour être précis estimer également cette relation sur des données temporelles. Mais l’échantillon « statique » est suffisamment large pour conforter cette relation à travers le temps.