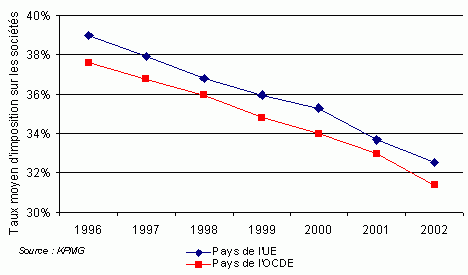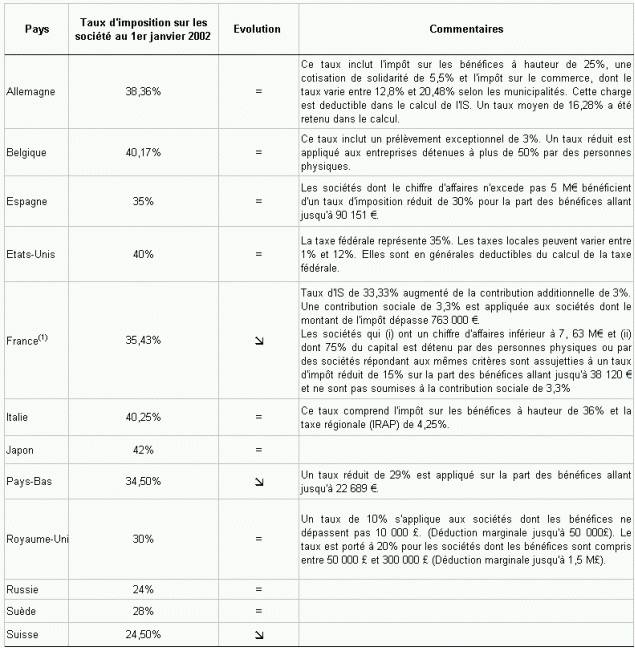La Lettre n°9 de Avril 2002
Actualités : Les règles anti-concentration européennes
Alors qu'entre 1991 et 1999, seulement 10 opérations de rapprochement avaient été bloquées par la Commission européenne à la concurrence, en 2 ans, les services de Mario Monti ont interdit 8 opérations, 5 en 2001 (Tetra Laval/Sidel, CVC/Lenzing, Schneider/Legrand en octobre 2001, GE/Honeywell en juillet 2001, SCA/Metsa Tissue en janvier 2001) et 3 en 2000 (MCIWorldcom/Sprint en juin 2000 et Volvo/Scania en mars 2000, AirTours/First Choice en septembre 1999). A ces vetos explicites, il convient d'ajouter les projets d'opérations abandonnés suite à des contacts préliminaires avec l'autorité bruxelloise qui n'auguraient pas d'avis favorable de la Commission : Telia/Telenor, Alcan/Pechniney, EMI/Time Warner par exemple.
Même s'il convient de relativiser le nombre de vetos de la Commission au regard du nombre d'opérations notifiées (5 vetos en 2001 sur 296 notifications), les décisions de Mario Monti étonnent le monde juridique et financier en ce qu'elles semblent rompre avec un passé plutôt complaisant à l'égard des grandes opérations de fusions et acquisitions. Le changement récent d'attitude de la Commission est fondé sur une approche plus stricte des opérations de rapprochement, même s'il peut en partie s'expliquer par le souci de son actuel commissaire d'asseoir la réputation de l'autorité anti-trust européenne comme une institution crédible et respectée et donc insensible aux pressions politiques (cf. pressions françaises et américaines inutiles pour Schneider et GE respectivement).
Les règles de la concurrence européenne
Le Règlement 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 définit la réglementation anti-concentration européenne. Ce texte fondateur soulignait l'idée que l'établissement du marché intérieur européen entraînerait une réorganisation transfrontalière majeure des entreprises et qu'il importait de créer des règles du jeu égales afin que de telles opérations ne portent pas un préjudice durable à la concurrence. En d'autres termes, il fallait que les mêmes obligations en matière de notification et les mêmes procédures et normes juridiques s'appliquent à toutes les concentrations ayant des effets transfrontaliers significatifs.
C'est la raison pour laquelle le Règlement a conféré à la Commission une compétence exclusive pour appréhender les opérations de concentration de dimension communautaire. Ce principe de « guichet unique » sert un double but. D'abord, dans l'esprit de la subsidiarité, il se fonde sur la constatation que le contrôle des concentrations au niveau communautaire se justifie eu égard à l'incapacité de tout État membre pris individuellement d'appréhender complètement la portée et les effets transfrontaliers de ce type d'opérations. De surcroît, le principe du guichet unique mis en place par le Règlement simplifie les procédures administratives, ce qui permet à la fois aux autorités de la concurrence et aux entreprises de minimiser les coûts du contrôle des concentrations.
La dimension Communautaire
Le champ d'application du Règlement s'applique « à toutes opérations de concentration de dimension communautaire », c'est à dire aux opérations relevant des critères suivants :
a) Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 Md€ et,
b) Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 M€, à moins que chacune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre
Devant le nombre d'opérations passant entre les mailles du filet communautaire car n'atteignant pas ces seuils de chiffre d'affaires, le champ d'application du Règlement a été complété en 1998 par un paragraphe supplémentaire (le fameux « Article 1ier, paragraphe 3 ») :
Une opération de concentration n'atteignant pas les seuils fixés plus haut a néanmoins une dimension communautaire lorsque :
a) Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 Md€,
b) dans au moins trois États membres, le chiffre d'affaires total réalisé par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 M€,
c) dans au moins trois États membres ainsi que définis au paragraphe précédent, le chiffre d'affaires total d'au moins deux des entreprises concernées est de plus de 25 M€ et,
d) le chiffre d'affaires total d'au moins deux entreprises concernées sur le territoire communautaire est de plus de 100 M€.
L'objectif visé par la Commission est clair : statuer sur les opérations affectant au moins trois États membres. Mais en 2000, seulement 20 opérations ont été notifiées à la Commission conformément à cet article, sur 75 notifications multiples à au moins trois États membres. La Commission s'interroge donc sur une réforme de cet article afin d'éviter les notifications multiples dont le nombre augmente fortement (ne serait-ce pas dû à l'intransigeance de la Commission que les entreprises souhaitent éviter ?)
Une procédure rapide
L'une des principales caractéristiques de la procédure européenne est qu'elle se déroule selon un calendrier très tendu (4 mois maximum selon la lettre du Règlement). La notification d'une opération de concentration doit ainsi intervenir dans un délai d'une semaine à compter de l'annonce de l'opération. La Commission publie alors la notification et lance la phase préliminaire d'analyse de l'opération qui dure 1 mois.
A l'issue de cette phase préliminaire, l'opération est soit acceptée (déclarée ne relevant pas du règlement ou ne soulevant pas de « doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun ») ou bien la procédure est lancée. Une première phase (phase I) de 3 semaines commence alors. Les entreprises concernées ont jusqu'au dernier jour de cette première phase pour proposer d'éventuels engagements afin de ne pas voir leur opération interdite. Si les concessions proposées par les entreprises sont jugées insuffisantes ou si la Commission souhaite procéder à de plus amples investigations, une seconde phase (phase II) est alors lancée. En 2001, la Commission a autorisé 13 opérations après cette première phase, sur un total de 23 autorisations données.
La différence fondamentale entre la phase II, qui peut durer jusqu'à 3 mois, et la phase I réside dans l'obligation pour les entreprises de proposer des engagements au plus tard le dernier jour de la phase II. En pratique, ces trois mois servent avant tout à négocier les engagements entre les entreprises et la Commission. Mais la pratique montre que c'est dans les derniers jours de ces trois mois que les entreprises et la Commission peuvent effectivement discuter des engagements pour obtenir son accord et que le temps est alors souvent trop court. Dès lors, il est prudent dès le niveau de la phase I de proposer à la Commission des mesures sérieuses pour avoir son accord à ce stade sans passer en phase II.
Une procédure dite simplifiée, d'une durée limitée à un mois, peut être suivie par la Commission lorsqu'elle concerne une opération sans impact négatif sur la concurrence (petites sociétés communes de moins de 100 M€ de chiffre d'affaires et d'actifs...). Cette procédure a été mise en place en septembre 2000. Entre cette date et avril 2001, 39% des notifications ont bénéficié de ce traitement qui a duré en moyenne 25 jours civils.
Enfin, gardons à l'esprit que selon le Règlement européen, une concentration ne peut être réalisée ni avant d'avoir été notifiée, ni avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché commun.
Cependant, dans le cas d'une OPA en France, le droit boursier ne prévoit pas que l'offre puisse être conditionnelle à une autorisation de ce type. Il y a donc incompatibilité de procédure entre le droit boursier français et les règles européennes de concurrence. Le règlement autorise deux voies possibles pour contourner cet obstacle :
- Soit prendre le risque de lancer l'opération sans avoir obtenu le feu vert de la Commission (cf. cas Schneider/ Legrand). Le Règlement stipule qu'une offre publique, qui a été préalablement notifiée dans le délai d'une semaine, est autorisée pour autant que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur dérogation octroyée par la Commission
- Soit notifier, et ne lancer l'opération qu'une fois que la Commission a donné son feu vert (cf. cas Arcelor/Usinor). Cette seconde alternative présente l'intérêt d'être moins risquée mais ne permet pas de verrouiller les termes de l'opération puisqu'entre la notification et la conclusion éventuelle de l'opération, les conditions de marché et les performances des sociétés concernées peuvent être significativement modifiées (cf. renégociation des parités Usinor/Arbed/Aceralia).
De la théorie à la pratique : pourquoi y-a-t-il plus d'interdictions ?
Il y a deux principes généraux qui régissent « le comportement » de la Commission à l'égard des opérations de concentration. D'une part, le premier principe de base de la Commission est que les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante entravant de manière significative une concurrence effective sont déclarées incompatibles avec les règles du marché commun. Ce principe est fondateur et sert de ligne directrice aux actions de la Commission. D'autre part, le principe de fonctionnement de la Commission est qu'elle est en perpétuel apprentissage. A cet égard il est important de garder à l'esprit que le Règlement initial de 1989 est régulièrement amélioré ou refondu. La Commission procède régulièrement à des tests de cohérence de ses critères d'analyse au regard des évolutions du marché. Deux principes presque contradictoires animent donc la Commission : le principe immuable (peut être pas pour longtemps) de position dominante et la volonté constante d'apprendre. C'est cette antinomie apparente qui pourrait être à l'origine du durcissement actuel de la Commission.
Sur les 8 vétos de la Commission prononcés ces deux dernières années, six ont été fondés sur une approche plus stricte des principes énoncés ci-dessus, et notamment :
- TetraLaval/Sidel : l'opération a été jugée néfaste à la concurrence au sein du marché commun en ce qu'elle aurait permis à la nouvelle entité de bénéficier de la position estimée dominante de TetraLaval sur le marché de l'emballage en carton pour pénétrer fortement le marché voisin de l'emballage en plastique. Ce cas révèle une interprétation relativement stricte d'une position dominante par constitution d'un conglomérat d'activités voisines. Le cas TretaLaval constitue à cet égard une répétition du véto GE/Honeywell.
- GE/Honeywell : la Commission a estimé que cette opération aurait permis à la nouvelle entité de vendre un mix des produits GE (moteurs d'avions) et Honeywell (systèmes d'avionique) à un prix décoté par rapport à des ventes séparées des deux produits, de bénéficier de la force de frappe financière de GE Capital, un des principaux acteurs de leasing aéronautique, pour imposer les produits GE/Honeywell et de rendre les produits des deux compagnies uniquement disponibles lorsque vendus ensemble.
Ces deux cas illustrent l'évolution récente de la perception par la Commission qu'une position dominante peut se créer ou se renforcer par le rapprochement d'activités voisines. Cette nouvelle théorie du portefeuille ou du conglomérat diffère de la perception classique de la dominance formée par concentration d'acteurs sur un même marché. Elle reste cependant un prolongement du principe selon lequel une position dominante est néfaste. Cependant, la dominance est mauvaise avant tout pour les concurrents et pas vraiment pour les clients (en tout cas à court terme) puisqu'elle leur permet, dans les cas de rapprochement d'activités voisines, d'acheter des produits groupés moins chers que s'ils étaient vendus séparément. Cette notion de position dominante est de plus en plus décriée par les acteurs économiques qui y voient un lobbying actifs des concurrents des entreprises se rapprochant, qui sont de plus en plus consultées par la Commission (le fameux « market testing ») au détriment des consommateurs. La Commission est en constant apprentissage vous ai-je dit ?
Le veto de la commission sur l'opération Volvo/Scania est à cet égard révélateur d'une volonté d'appliquer aussi la notion plus américaine d'atteinte à la concurrence (« substantial lessening of competition standard »). La jurisprudence communautaire avait tendance à fixer un seuil de part de marché à 40%, au-delà duquel une opération pouvait être jugée contraire aux intérêts du marché commun. La Commission a estimé que le rapprochement entre Volvo et Scania constituait une atteinte à la concurrence en démontrant, par recours important aux calculs économiques de parts de marchés, fait plutôt nouveau compte tenu des critères de notification (le chiffre d'affaires et pas la part de marché) que la nouvelle entité détiendrait plus de 35% du marché européen du poids lourd avec de fortes présences sur certains marchés (nordiques notamment).
Le livre vert
La Commission durcit le ton sur tous les fronts. Mais ses positions étonnent en ce qu'elles semblent plus fondées sur la protection des concurrents que sur la préservation des intérêts des consommateurs. De même, elle semble pourchasser toute opération susceptible d'augmenter l'efficacité des entreprises qui se rapprochent, or n'est ce pas le but des rapprochements ? Pour répondre à ces critiques, Mario Monti a lancé un grand débat sur la réforme de la réglementation communautaire dont les principaux éléments sont les suivants :
- Le critère de la position dominante est-il toujours pertinent ou doit-on basculer vers le critère de l'atteinte substantielle à la concurrence. Ce dernier critère plus large semble avoir été plus souple pour les fusions américaines,
- L'attitude de la Commission à l'égard des gains d'efficacité doit-elle être modifiée ?
- La rapidité de la procédure, jusqu'ici un plus indéniable du processus communautaire, ne rend-t-elle pas difficile de trouver des accords sur les engagements des entreprises ?
- La Commission doit-elle être notifiée pour des opérations qui concernent plus de 3 États membres, bref resserrer les mailles du filet et éviter les notifications multiples ?
Des observateurs avisés auront remarqué qu'il manque au moins deux sujets centraux de débat aux côtés de ces thèmes : la Commission peut-elle continuer à instruire les dossiers, négocier les conditions de son autorisation éventuelle avec les entreprises, et décider des les interdire ou de les autoriser. Être en définitive juge et partie. Deuxièmement, la Commission peut-elle continuer comme elle le fait de plus en plus à pratiquer des tests de marché auprès de concurrents qui ne songent qu'à faire capoter les opérations de rapprochement (le cas Schneider/Legrand est un exemple du pouvoir de Siemens parait-il ?).
Les propositions du « livre vert » sont actuellement en discussion. Au-delà des modifications qui seront apportées au Règlement fondateur, la Commission européenne aura réussi en 12 ans à ne plus être une préoccupation de dernière minute lors des grandes opérations de rapprochement. Tout le problème qu'il lui reste à résoudre est de savoir quelle image du marché commun elle défend : celle du producteur ou celle du consommateur. Jusqu'ici, dans un marché commun en création, la principale préoccupation de la commission a été de s'assurer que l'ensemble des entreprises du marché commun était traité sur un pied d'égalité et que l'accroissement de la taille des entreprises allait au rythme de l'ouverture des frontières économiques à l'intérieur de l'espace économique européen. C'est pour cette raison que la Commission s'est focalisée sur la notion de position dominante. Mais maintenant que le marché européen semble plus mature et que les champions nationaux sont de plus en plus en compétition, il est peut être temps de braquer le projecteur de la Commission sur l'intérêt du consommateur, comme c'est le cas aux États-Unis.
Tableau : Les taux d'imposition des bénéfices dans le monde
Recherche : Le carve out
Zouberi Taktak (*2) a étudié les 51 opérations de ce genre intervenues en Europe de 1985 à 2000. Le phénomène apparait comme très français : les deux tiers des opérations concernent des groupes hexagonaux, le solde se répartissant à peu près également entre les quatre autres grands pays européens. Sans surprise, les deux tiers de ces opérations sont intervenus entre 1998 et 2000, moment d'euphorie boursière propice aux introductions en bourse (*3).
Les motivations rencontrées sont de deux ordres :
- en période de bulle spéculative, un carve out permet de disposer d'un papier surévalué (les actions technologies, média, telecom en 1999 et 2000) permettant d'acheter en actions à une parité correcte des actifs eux aussi surévalués (France Télécom et Wanadoo, Alcatel et Alcatel Optronic, …) ;
- trouver des liquidités pour réduire l'endettement de la maison mère (France Telecom et Orange, Vivendi et Vivendi Environnement). Z. Taktak montre en effet que les groupes qui ont procédé à des carve out étaient significativement plus endettés que les groupes du même secteur qui n'ont pas procédé à cette opération.
On pourrait y ajouter la faculté d'intéresser financièrement (stock-options…) les dirigeants de la filiale à ses résultats et non à ceux d'une maison mère plus vaste où le résultat de leur efforts est souvent dilué.
3 Voir la lettre Vernimmen.net du février mars 2002 .
Q&R : A partir de quel moment peut-on dire que les survaleurs
créées par des acquisitions successives peuvent pénaliser la société
acquéreuse ? Peut-on dire que la dépréciation des survaleurs n'est pas
synonyme d'appauvrissement si les acquisitions ont été payées en actions
?
En effet, le fondement des survaleurs est l'anticipation d'une sur-rentabilité par rapport aux taux exigés qui trouve son explication dans une position de premier sur un marché (cf. internet), de rente de situation, de faculté à mettre en œuvre des synergies forte. Mais si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, c'est que les actifs ont été surpayés et que les anticipations ont été déçues. Que l'on évalue alors l'entreprise par l' actualisation de ses flux futurs de trésorerie ou par une méthode patrimoniale, la conclusion est la même : perte de valeur.
On entend souvent dire en ce moment que, si l'acquisition a été financée par remise d'actions, la dépréciation des survaleurs est de peu d'importance et n'affecte pas la valeur puisqu'il s'agit d'un non-flux.
Certes la dépréciation n'est pas un flux, mais il est d'abord faux de penser que seules les décisions qui modifient les flux affectent la valeur. Plafonner les droits de vote des actionnaires, donner 10 droits de vote par action à certaines catégories d'actions ….ne modifie pas les flux, mais réduit aussi sûr que 2 et 2 sont 4 la valeur des capitaux propres.
Déprécier une survaleur constatée sur une acquisition payée en actions, c'est reconnaître que ce qui a été acheté a été payé trop cher. Que l'action de l'acheteur ait été elle aussi surévaluée au même moment ni change rien. Si l'entreprise avait fait une augmentation de capital en numéraire plutôt qu'une acquisition surpayée, elle aurait alors profité d'un cours élevé pour le plus grand profit de ses actionnaires d'alors et aurait pu utiliser ce cash pour faire des acquisitions à des prix beaucoup plus raisonnables une fois l'euphorie passée. Ce fut exactement la stratégie de Bouygues qui leva 1,5 Md€ en mars 2000 à un cours double de celui d'aujourd'hui, refusa de participer aux enchères UMTS et vient simplement d'entamer son trésor de guerre pour racheter des intérêts minoritaires dans Bouygues Télécom à un prix qui n'a rien à voir avec ceux mentionnés en 2000. Son cours de bourse n'a baissé que de moitié contre au moins les deux tiers pour celui de ses rivales téléphoniques.
N'oublions pas en effet, que l'actionnaire de l'entreprise qui rémunère une acquisition par remise d'actions a été dilué. Il l'a accepté parce qu'il escomptait que la taille du gâteau croîtrait plus vite (30% par exemple) que le nombre de convives entre lesquels il est partagé (25% par exemple). Maintenant on lui annonce que la taille du gâteau ne s'accroît plus de 30% mais de simplement 10% parce que des actifs achetés se sont révélés valoir moins que prévu. Malheureusement pour lui, le nombre de convives ne se réduit pas pour autant. La taille de la part unitaire du gâteau s'est réduite de 12% (110/125-1). Il y a donc bien eu appauvrissement.
NOUVEAU SUR LE SITE VERNIMMEN.NET
La page des sites favoris a été entièrement remodelée pour être plus opérationnelle : les 108 sites répertoriés y sont classés par les questions que vous pouvez vous poser : où trouver un rapport annuel ? un communiqué de presse ? de la recherche en finance ? comment évaluer ses stock-options ? où trouver les réglementations comptables ? etc…