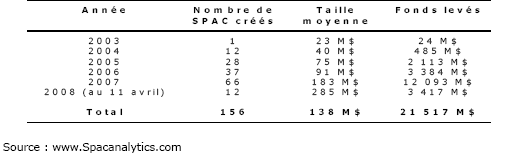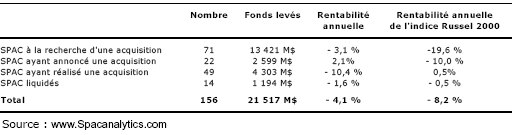La Lettre n°64 de Avril 2008
Actualités : La direction financière des entreprises en crise
Une entreprise doit considérer qu’elle fait face à une crise financière lorsqu’il est prévisible qu’à court terme elle ne puisse honorer son passif exigible. En termes simples la crise financière dont il sera ici question est une insuffisance grave de trésorerie.
La crise financière n’est pas la seule crise qui puisse émailler la vie d’une entreprise ; elle n’est pas toujours la plus grave. Un conflit social long, une rupture technologique, une perte de confiance durable des clients, un manque structurel de profitabilité, sont autant de crises qui peuvent condamner définitivement une entreprise alors qu’une crise de trésorerie liée à une augmentation du Besoin en Fonds de Roulement peut être rapidement résolue.
Par contre elle est la plus aigue de toutes les crises : une entreprise ne meurt pas directement d’un manque de rentabilité, elle meurt effectivement d’un manque de liquidité.
La gestion de la crise financière nécessite la maîtrise de trois actes de management : prévoir, décider d’une stratégie, communiquer.
I. Prévoir
Le facteur temps est une donnée primordiale dans une crise financière. Le management ne peut espérer pouvoir gérer efficacement la crise sans maîtriser ce facteur.
Ainsi doit-on à tout moment être capable de détecter les signes de tension financière. Il faut ensuite déterminer avec précisions combien de temps l’entreprise peut opérer avant de se trouver devant l’ «impasse» de trésorerie.
a) Savoir détecter les signes de tension financière.
Il convient ici de surveiller les bons indicateurs de cash. Les indicateurs de rentabilité, même s’ils peuvent indiquer une première tendance alarmante, ne sont pas appropriés pour anticiper les tensions de trésorerie.
Beaucoup d’entreprises, très riches en indicateurs de compte d’exploitation (ventes, rendement, efficience, productivité, contributions,…) surveillés par les experts du contrôle de gestion, n’ont, pour prévoir leur cash-flow, que des positions journalières ou des prévisions annuelles mal remises à jour.
Le reporting de l’entreprise doit comporter un Tableau de Financement avec une comparaison mensuelle entre réel et prévision. Cet outil décompose le cash-flow de la période en trois ensembles de flux :
• les flux liés à l’exploitation : Résultat et BFR
• les flux dits «hors exploitation» : Investissements, cessions, flux exceptionnels,…
• les flux de financements : intérêts d’emprunt décaissés, remboursements, nouveaux emprunts,…
L’analyse régulière du Tableau de Financement donne des indications précieuses de trois ordres :
• la marge de manœuvre de trésorerie : si l’entreprise est endettée, l’écart entre le cash-flow avant le service de la dette et le service de la dette ; si elle ne l’est pas, le niveau de cash-flow par rapport à son potentiel de découvert ;
• la sensibilité du cash-flow de l’entreprise aux ventes et au résultat (très forte dans le commerce de détail au BFR négatif et aux investissements faibles – moins forte dans l’industrie lourde où la volatilité des ventes serait faible et les investissements élevés) ;
• les facteurs clés de la liquidité et l’identification des zones à risque en analysant les écarts par rapport à la prévision.
Une bonne connaissance des leviers de la liquidité de l’entreprise permet, dès que la situation se tend, de les actionner sans délai.
b) Gérer le temps
Lorsque la situation de tension financière est diagnostiquée, il faut impérativement connaître avec précision le temps dont on dispose pour actionner ces leviers dont les effets salutaires prennent plus ou mois de temps avant de se produire.
L’utilisation d’un outil de prévision journalier ou hebdomadaire à horizon trois mois (ou «13 semaines») est une nécessité. Si elle n’existe pas déjà dans l’entreprise, construire cette prévision est le premier geste à accomplir.
Il s’agit là de faire un exercice d’un grand réalisme en recueillant l’information sur les encaissements et les décaissements prévisionnels dans toute l’entreprise au plus près des services qui génèrent ces flux.
Il s’agit en outre d’un outil qui sera mis à jour régulièrement au mieux à la semaine, sinon au mois.
Cet outil, dont la fiabilité doit être constamment améliorée, permet au management de garder la maîtrise du temps pendant la crise, ce qui lui permettra d’élaborer une stratégie de sortie de crise et d’améliorer l’efficacité de son action.
II. Décider d’une stratégie
Sortir avec succès d’une crise financière nécessite de réussir d’une part à optimiser la production de cash tout au long du cycle d’exploitation voire même à libérer du cash inutilement «gelé» et d’autre part à agir sur les financements.
L’action du management doit se concentrer en priorité sur la «libération» du cash. Il est illusoire, surtout dans des périodes de liquidité bancaire restreinte, de penser que la gestion de la crise puisse se résumer à une simple demande d’accroissement des lignes de crédit.
a) Pour améliorer le cash flow de l’entreprise, les dirigeants vont devoir agir sur les paramètres de l’exploitation comme sur les éléments hors exploitation.
i) L’action sur le cash-flow d’exploitation consiste à analyser et optimiser les composantes du Besoin en Fonds de Roulement. Il s’agira souvent de trouver des améliorations dans le cycle d’exploitation mais aussi de faire des arbitrages entre exigence de trésorerie et opportunités de CA ou de rentabilité.
Les leviers d’amélioration du BFR sont bien connus :
• réduction du temps qui s’écoule entre la prise de commande et l’encaissement de la somme due par les clients (politique d’acompte, surveillance du crédit consenti et subi,…) ;
• réduction du cycle de production, en particulier réduction du stockage (matières, en cours et produits finis) ;
• optimisation des conditions fournisseurs pour décaisser le plus tard possible les sommes engagées.
La priorité donnée au cash-flow induit des décisions qui ne seraient peut-être pas prises dans une entreprise financièrement solide : ainsi faut-il savoir renoncer à développer un marché trop risqué en termes de solvabilité ou trop cher en termes d’investissements commerciaux ; de même pour une politique d’achat axée sur des commandes massives pour obtenir des rabais quantitatif.
ii) L’entreprise en situation financière tendue ne doit engager que les investissements strictement nécessaires à sa survie : investissements capacitaires ou de productivité devront souvent attendre la sortie de crise.
De même le «pay back» des coût éventuels de restructuration engagés doit être surveillé.
On voit donc que le Directeur Financier d’une société en crise financière ne doit pas seulement être un «Monsieur Non» mais doit savoir identifier les améliorations à apporter tout au long du cycle de production pour «libérer» le cash. Cette aptitude à remettre en cause les fonctionnements va être également déterminante dans la recherche de moyens de financement.
b) Avant de vouloir entamer la renégociation des ses financements, l’entreprise se doit d’abord de vérifier que ses actifs ne recèlent pas des opportunités de libération de cash.
i) Le management d’une entreprise en crise aura décidé ce qui constitue le cœur de l’activité sur lequel le redressement devra se faire. Ainsi tous les actifs qui ne font pas partie du «cœur de métier» constituent des cessions potentielles.
Par ailleurs certains actifs qui sont au centre de la stratégie de l’entreprise peuvent constituer des sources de financement : un bien industriel cédé sous forme de «lease back» (voire donnée en garantie d’un «asset backed loan») ou un portefeuille de créances cédé à une société de factoring sont deux exemples classiques.
Une fois que le directeur financier a construit ses prévisions de trésorerie en y introduisant toutes les actions d’optimisation du cash d’exploitation comme du cash hors exploitation et en tirant de ses actifs tous les financements possibles, il saura quantifier le montant des besoins à financer et démontrer aux partenaires bancaires la capacité de remboursement dans le temps des sommes prêtées pour couvrir ces besoins.
ii) Une discussion sur le refinancement de l’entreprise peut alors être conduite sur des bases factuelles et rationnelles par une direction qui, grâce au travail décrit ci-dessus, aura conservé une crédibilité aux yeux de ses partenaires financiers.
La négociation peut se dérouler à l’amiable ou exiger un cadre juridique de nature à faciliter les discussions. Ces dernières sont toujours délicates car l’entreprise doit constamment arbitrer entre la résolution de la crise et le risque futur de perdre son indépendance (imposition de «covenants» exigeants, garanties données,…).
En France un dirigeant peut décider si sa situation l’exige d’avoir recours aux procédures de prévention des entreprises en difficulté, le mandat ad hoc ou la conciliation. Ces cadres juridiques ont des avantages indéniables: ils imposent un calendrier aux discussions, font intervenir un tiers «objectif» entre l’entreprise et ses créanciers financiers, apportent une sécurité juridique aux accords signés. Par contre ils génèrent des coûts et peuvent donner un coté «dramatique» et inquiétant aux difficultés de l’entreprise, si par mégarde l’existence de telles procédures (strictement confidentielles) vient à être connue du personnel, des clients ou des fournisseurs de l’entreprise.
Dans des cas plus graves, mais sans être pour autant en état de cessation de paiement, l’entreprise en France peut décider de gérer la crise financière dans le cadre d’une procédure de «sauvegarde» lui permettant d’obtenir un gel temporaire de son passif et de présenter aux créanciers un plan de redressement et d’apurement de ce passif.
Cette procédure étant publique, il convient donc de mesurer au préalable l’impact de son recours sur les ventes et les approvisionnements.
III. Communiquer en période de crise financière
Il s’agit là d’un des exercices les plus difficiles pour une direction financière, rarement préparée à communiquer autant, surtout dans les entreprises non cotées.
D’un côté le mutisme du management laisse le champ libre à la rumeur incontrôlable et à l’inverse la transparence totale serait irresponsable.
Partant de l’idée que la santé de l’entreprise est au cœur des intérêts de tous ses acteurs, il convient de distinguer la communication au sein de l’entreprise de celle à engager avec ses partenaires extérieurs.
a) La communication au sein de l’entreprise.
En plus des actionnaires dont la contribution sera le plus souvent recherchée lors des discussions de refinancement, deux groupes d’acteurs demandent une attention particulière dans ce domaine : les principaux responsables fonctionnels et opérationnels d’une part et les représentants du personnel d’autre part.
i) Dans une période de crise, le couple DG/Directeur Financier a besoin plus que jamais du support actif de toute l’équipe de direction.
Au minimum une information régulière de cette équipe lui permet de ne pas prendre de position à contre-courant de la stratégie menée et aussi d’être au courant des évolutions avant que la rumeur venant de l’extérieur s’en charge. En période tendue, il est important que l’information vienne de la hiérarchie.
Mais surtout le couple CEO/CFO ne peut à lui seul tout résoudre. Le recentrage éventuel de la stratégie, les arbitrages faits en faveur du cash et plus généralement le travail de «libération du cash» tout au long du cycle d’exploitation ne peuvent se faire sans la participation active des managers.
S’ils sont régulièrement informés, tous au même moment, sur l’évolution de la crise et la stratégie de sortie de crise mise en place, non seulement ils se sentiront associés aux efforts mais, se sentant responsables du destin de leur entreprise, ils deviendront des moteurs dans la résolution de la crise. D’une crise financière bien gérée, le management ressort plus fort et plus soudé.
ii) Le Comité d’Entreprise est également un acteur important dans la stratégie de communication pour au moins deux raisons :
• sa bonne information est un moyen de combattre là aussi les rumeurs qui ne manqueront pas de circuler au sein du personnel ;
• une bonne collaboration recherchée dès le début de la crise permet ensuite de faciliter la compréhension voire l’acceptation des mesures de réductions de coûts nécessaires (l’avis des CE est souvent légalement requis avant de prendre certaines décisions.
b) La communication avec les partenaires extérieurs
Parmi les nombreux partenaires de l’entreprise, banques, fournisseurs, clients, administrations locales, élus des collectivités territoriales, presse… il est intéressant de noter l’importance particulière que prennent les assureurs crédits en période de crise financière.
De plus en plus de fournisseurs, notamment les grandes sociétés, choisissent d’assurer leurs créances. A l’inverse du banquier, du client ou du fournisseur, il n’y a pas de relation commerciale directe entre l’entreprise en difficulté et l’établissement financier qui assure la créance des fournisseurs de cette entreprise, et donc peu de leviers pour freiner ou empêcher la réduction des encours assurés.
Rappelons ici que lorsque les assureurs crédits baissent les encours garantis des fournisseurs de l’entreprise en difficulté, ces derniers n’ont d’autres choix que de réduire les termes de paiement (et donc dégrader le BFR de l’entreprise et d’accélérer la crise) ou «d’auto-assurer» (ce qui est rare) les encours qui dépassent le plafond autorisé par l’assureur.
En outre une réduction brutale des encours a souvent pour effet d’inquiéter les fournisseurs qui parfois vont refuser de lancer certaines commandes ou privilégier d’autres clients, perturbant ainsi les chaînes de production.
Une information régulière et convaincante des analystes des sociétés d’assurance crédit est ainsi critique de même que l’anticipation de la réduction de leurs encours dans les prévisions de trésorerie, si cette réduction est jugée probable.
La crise représente un véritable défi pour le management car sa gestion financière absorbe la majeure partie de son temps à un moment où il doit plus que jamais mettre sous tension les opérations. Mais les entreprises peuvent se faire assister par des consultants sur le pilotage du processus et certains aspects du refinancement.
Pour éprouvante que soit cette période, et à condition d’avoir pu anticiper les évènements, peu d’expériences sont aussi riches pour une Direction d’entreprise que celle de réussir à surmonter une crise financière.
Régis RIVIERE
Senior Director - Alvarez and Marsal
Senior Director - Alvarez and Marsal
Alvarez and Marsal est un cabinet comptant plus de 1200 consultants dans le monde, leader dans le redressement et l’amélioration des performances des entreprises en situation tendue.
Tableau : Les PME depuis 10 ans
La Banque de France a publié une étude intéressante sur le financement des PME (1) qui montre :
• une réduction depuis 1996 de la part des PME indépendantes dans le total des PME (de 79 % à 51 %) au profit des PME membres de groupes ;
• que le BFR des PME indépendantes est beaucoup plus important que celui des grands groupes : 12 % au total du bilan contre 4 % ;
• que depuis 1996 la structure financière des PME s’est renforcée : la part des capitaux propres passant de 22 % à 26 % du total de bilan. Cette progression est particulièrement forte pour les PME indépendantes depuis 2001 grâce à une progression de la rentabilité financière, mesurée ici par le rapport capacité d’autofinancement / capitaux propres, qui passe de 8 % en 1995 à 13 % en 2006. De la même façon, le ratio dettes bancaires financières sur capitaux propres est passé de 102 % en 1995 à 71 % en 2006 et la capacité d’endettement sur l’endettement bancaire et financier est passé de 28 à 38 %.
Ceci est très rassurant dans un contexte économique qui pourrait se dégrader, mais où les entreprises petites ou grandes n’ont jamais réalisé des marges et des rentabilités aussi élevées, le tout avec un niveau d’endettement faible.
(1) Dans le bulletin de la Banque de France n° 165, pages 31 à 48.
Recherche : La politique des dividendes internes
Le choix de rapatrier ou non les dividendes des filiales constitue l’une des principales décisions de gestion des firmes multinationales. Nous nous intéressons ce mois-ci aux raisons pour lesquelles les multinationales peuvent réclamer de leurs filiales le paiement de dividendes. Trois chercheurs américains (1) ont étudié ce phénomène pour les entreprises multinationales installées aux Etats-Unis sur une période de 20 ans (entre 1982 et 2002). Leur article rappelle les explications théoriques du paiement de dividendes par les filiales et vérifie leur pertinence par des tests économétriques. Cette étude s’inscrit dans une littérature relativement abondante sur le sujet et confirme, pour l’essentiel, des résultats déjà établis (2).
Les critères de décision pour le rapatriement des dividendes des filiales peuvent être regroupés en trois catégories.
1. Les considérations fiscales
Le rapatriement des dividendes entraîne une imposition supplémentaire pour la firme multinationale. Selon la réglementation américaine, la société mère devra payer au fisc la différence entre le taux d’impôt américain et le taux dû par la filiale dans le pays où elle est implantée. Les tests économétriques confirment que les filiales situées dans des pays où les taux d’impôts sont faibles versent moins de dividendes à la société mère, afin d’éviter l’imposition importante qu’ils entraîneraient. Toutefois, les auteurs soulignent qu’il n’est pas rare de voir des sociétés mères rapatrier des dividendes et dans le même temps réalimenter en capital leurs filiales, alors même que ce comportement est fiscalement pénalisant. Ainsi, l’un des principaux résultats de cette étude est de montrer que la fiscalité n’est pas l’élément prépondérant dans le fonctionnement des marchés internes de capitaux au sein des groupes.
2. Les besoins de financement de la multinationale
La société mère peut souhaiter rapatrier davantage de dividendes lorsqu’elle dispose d’opportunités d’investissement sans pouvoir obtenir facilement de financement externe (par exemple parce qu’elle est déjà très endettée). Là encore, l’étude économétrique confirme que les sociétés endettées et disposant d’opportunités rapatrient davantage de dividendes. De plus, les considérations fiscales passent au second plan dans le cas des sociétés très endettées.
3. Le contrôle des dirigeants des filiales (problèmes d’agence)
Selon les auteurs, il s’agit là du principal critère de décision de rapatriement des dividendes. En effet, les considérations fiscales et les besoins de financement devraient entraîner des décisions de rapatriement variables d’une année sur l’autre, suivant les revenus et perspectives de la société mère. Or on constate au contraire une grande stabilité dans les taux de distribution (en moyenne et sur 20 ans, les filiales versent 40 cents chaque fois qu’elles gagnent un dollar supplémentaire). Le fait d’obliger les filiales à ce versement régulier est une manière de limiter les comportements opportunistes de leurs dirigeants. Cet argument est essentiel même pour comprendre les deux autres types de critère : il justifie les comportements fiscalement pénalisants et il explique que des multinationales rapatrient des dividendes lorsque elles-mêmes font face à un problème d’agence et doivent verser des dividendes à leurs actionnaires.
(1) Desay M.A., Foley C.F. et Hines J.R., 2007, Dividend Policy Inside the Multinational Firm, Financial Management, n°36-1
(2) Pour plus de détails sur la politique de dividende, voir le chapitre 42 du Vernimmen 2005.
Q&R : Qu'est-ce qu'un SPAC ?
C’est un Special Purpose Acquisition Company.
C’est-à-dire une coquille qui se fait coter en bourse en levant des capitaux propres auprès du public avec l’objectif de prendre le contrôle d’une société, non encore identifiée, cotée ou non, dans un délai maximum de 24 mois. A défaut, le SPAC est automatiquement liquidé et les investisseurs récupèrent au moins 98 % des fonds levés à son introduction en bourse. S’agit-il pour autant d’un chèque en blanc donné par les actionnaires au management du SPAC ? Non : une fois la cible identifiée et son acquisition négociée, le SPAC doit faire approuver l’opération par ses actionnaires à une majorité de 60 à 80 % et s’ils ne l’approuvent pas, le SPAC est alors automatiquement liquidé et ses actionnaires récupèrent le numéraire dont il avait été doté.
Depuis leur apparition aux Etats-Unis en 2003, 156 SPAC ont été cotés en bourse et ont levé 21,5 Md$, soit une moyenne de 138 M$ par SPAC.
L’élévation continue de la taille des SPAC est l’indicateur de leur succès, de même que leur arrivée en Angleterre (sur l’AIM), à Euronext Amsterdam (Pan-European Hotel Acquisition Company NV l’an passé qui a levé environ 100 M€) en Inde et en Chine, sans parler de grands noms de Wall Street qui ont lancé ou s’apprêtent à lancer un SPAC : R. Perelman, B. Wassertein, N. Peltz, J. Perella, etc ...
Matériellement, et afin de protéger les investisseurs, les bourses américaines ont imposé que les SPAC aient une capitalisation boursière minimum à la date de leur entrée en bourse de 250 M$ avec un flottant de 200 M$, que 90 % des fonds levés soient investis dans un trust qui ne libère les fonds que pour financer l’acquisition approuvée par les actionnaires ou liquider le SPAC, et enfin que l’investissement soit réalisé dans les 3 ans de l’introduction en bourse. En pratique, 98 à 100 % des fonds levés sont confiés au trust.
Le SPAC est porté en bourse par une équipe de gestion qui investit habituellement 3 à 5 % du montant de l’augmentation de capital, fonds placés dans le trust. Le management doit alors trouver une cible, négocier son acquisition et convaincre les actionnaires du SPAC d’approuver l’opération. Dans l’intervalle, ils ne touchent aucune rémunération, mais si tout va bien, ils obtiennent grâce à des warrants souscrits dès l’introduction en bourse 20 % du capital du SPAC en n’en ayant payé que 3 à 5 %. Que l’on nous permette de dire qu’à coté les gérants de fonds de private equity qui doivent « se contenter » de 20% de la plus value sont des petits bras ! Si par contre, tout va mal et que la liquidation du SPAC est prononcée, ses gérants ne reçoivent rien, perdent leur investissement initial et une partie de leur réputation. C’est ce que l’on appelle à Wall Street checks and balances.
Actionnaire d’un SPAC, qu’auriez-vous pu acheter ? American Apparel, des portes conteneurs de CMA – CGM, un gestionnaire de hedge funds (GLG Partners), Jamba Juice, des stades pour ceux qui auraient l’idée curieuse de s’intéresser financièrement au sport (1) ….
Après la réalisation de l’acquisition le SPAC reprend en général le nom de la cible acquise. Le management du SPAC est tenu de garder ses actions au moins 6 mois après l’acquisition avant de pouvoir les vendre. En général, il siège avec les dirigeants de la cible au conseil d’administration et a un rôle de conseil de ceux-ci.
Les SPAC permettent aux investisseurs qui n’ont accès ni aux fonds de private equity ni aux hedge funds d’y accéder dans des conditions de liquidité (cotation du SPAC) et de transparence (les SPAC sont soumis aux réglementations boursières classiques) meilleures. Le prix payé en est cependant élevé : 15 à 17 % de la valeur.
Pour l’instant, les rentabilités annuelles réalisées par les SPAC ne sont, en moyenne, pas exceptionnelles :
Les SPAC apportent des capitaux propres à des sociétés qui peuvent avoir du mal dans le contexte actuel à en trouver en bourse (la fusion avec un SPAC est l’équivalent d’une augmentation de capital), permettent à des entités non cotées d’accéder par fusion avec un SPAC à la cotation (même quand le marché des introductions est fermé), sans oublier la liquidité à un prix correct offerte aux entreprises décotées rachetées par un SPAC. C’est d’ailleurs l’un des rares segments de la finance qui a autant d’activité au premier trimestre 2008 qu’au premier trimestre 2007. Un autre indice de la vitalité des SPAC est la soixantaine de SPAC prêts à venir sur le marché new-yorkais et la baisse du pourcentage donné à l’équipe de gestion de 20% à environ 15 % sur les derniers SPAC.
Pour terminer sur un clin d’œil, l’innovation appelant l’innovation, une nouvelle technique s’est répandue à Wall Street, le SPAC mail. Vous achetez un paquet d’actions d’un SPAC qui a annoncé le principe d’une acquisition que vous menacez de faire dérailler en votant contre (ce qui implique la liquidation immédiate et la disparition des 20 % donnés au management du SPAC), à moins que certains menus avantages ne vous soient accordés juste avant le vote … Il faut bien que tout le monde mange!
Nous invitons ceux de nos lecteurs qui croiraient, cet article étant publié dans le numéro d’avril de la Lettre Vernimmen.net, que tout ceci n’est qu’une vaste plaisanterie, à consulter les sites www.spacinfo.com et www.spacanalytics.com et à se rendre le 5 juin 2008 au Hilton Hôtel de New-York pour la SPAC conférence 2008 !
(1) Pour plus de détails, voir la Lettre Vernimmen.net n° 56 de juillet 2006.