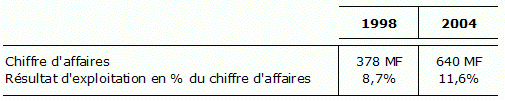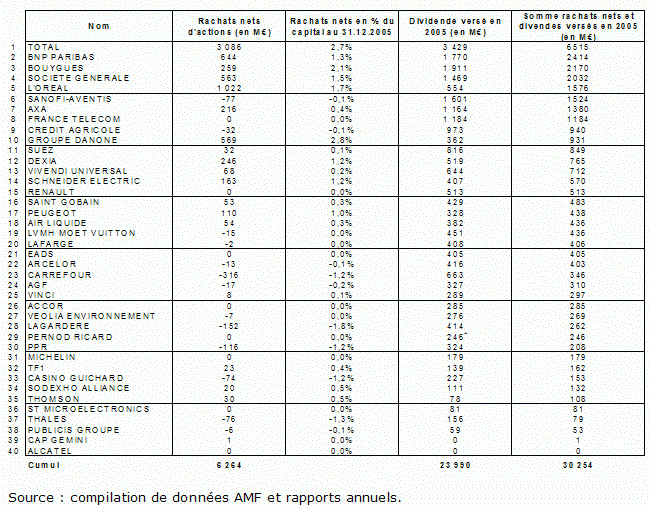La Lettre n°45 de Février 2006
Actualités : Les défis des LBO (seconde partie)
1. Un mode de gouvernance d’entreprise différent et plus efficace
Qu’est-ce qui explique que les sociétés sous LBO réussissent mieux que les autres à améliorer leurs performances economiques ? Une raison principale pour nous : leurs dirigeants ne pensent qu’à cela car la gouvernance d’entreprise sous LBO les incite fortement à ne penser qu’à cela !
Le mode de gouvernance mis en place par les fonds de LBO s’appuie à fond sur deux leviers ancestraux des comportements humains :
- le bâton, en raison de la contrainte que fait peser le poids de la dette de LBO à rembourser ; à défaut, c’est la renégociation des covenants des crédits, voire la faillite qui est toujours gênante sur un curriculum vitae ! Dès lors, une culture du cash se répand dans l’entreprise et conduit à examiner sous un œil neuf bon nombre de problématiques anciennes : réduction du BFR, optimisation des investissements, …
- la carotte, puisque les fonds de LBO demandent aux dirigeants d’investir à leurs cotés de l’ordre d’un an de salaire, et une bonne partie du patrimoine disponible d’un dirigeant qui repart dans un LBO secondaire.
C’est ce que les professionnels appellent « la mise sous tension ». Elle focalise l’attention des dirigeants sur les deux caractères essentiels de la réussite financière : la génération de cash et l’amélioration de la valeur. Le reporting souvent mensuel instaure un degré de contrôle par les actionnaires souvent inconnu des groupes cotés qui permet normalement de remédier beaucoup plus vite à des dérapages.
Bref les conflits d’agence (1) entre actionnaires et dirigeants sont fortement réduits par ce mode de gouvernance d’entreprise, plus efficacement que ne peut le faire une société cotée. Elle serait tenue pour un paria si elle présentait la structure financière d’un LBO. Il est par ailleurs probable qu’elle n’obtiendrait pas en assemblée l’accord de ses actionnaires pour mettre en place un intéressement de ses dirigeants aussi détonnant.
Le cocktail est très souvent efficace car le gain potentiel pour l’équipe dirigeante en 3 / 4 ans peut atteindre plusieurs millions d’euros, voire plusieurs dizaines de millions d’euros pour les LBO de grande taille.
En effet, l’équipe de dirigeants bénéficie alors de deux effets de levier : celui déjà mis en évidence plus haut, pari passu avec le fonds de LBO, et un second puisqu’elle bénéficie d’un intéressement à la performance du LBO sous forme de BSA ou d’options d’achat d’actions. Si certains objectifs de TRI sont atteints, cela peut se traduire par une restitution de 1 à 4 points de TRI du fonds de LBO à l’équipe dirigeante en fonction du TRI constaté et de l’année de sortie.
En reprenant notre petit exemple du début, un management qui investit environ 0,3 M€ en capitaux propres dans le LBO, peut multiplier la mise par 3,25 en 4 ans (1 M€) s’il améliore durablement les flux de trésorerie disponibles de 30 %. La multiplication est par 29 (8,7 M€) si l’équipe dirigeante récupère 2 points du TRI de l’investisseur et par 46 si elle a très bien négocié son intéressement (13,9 M€, 4 points de TRI).
Bref, même avec un mari ou une femme dépensiers, fortune est faite pour au moins deux générations ! Voici une puissante motivation.
S’il y a encore 5 ans, les managers étaient assez naïfs dans ce domaine, ils ont vite appris et se font aujourd’hui très souvent conseiller. En cas de performances excellentes, ils peuvent espérer gagner plus que les gestionnaires des fonds de LBO au titre de leur carried interest. D’une certaine façon, la morale est sauve !
Naturellement comme il n’y a pas que la finance dans la vie, bon nombre de dirigeants trouvent d’autres attraits aux LBO :
- une capacité à être entrepreneur, qu’il est souvent difficile à exercer dans les groupes ;
- des actionnaires engagés sur plusieurs années, apportant un regard neuf, avec qui il est possible de dialoguer et qui laissent beaucoup de marge de manœuvre dans le cadre d’un plan d’affaires défini et approuvé. La comparaison est cruelle avec certains actionnaires institutionnels des sociétés cotées, souvent versatiles et peu prompts à faire l’effort nécessaire pour comprendre une société.
Au total, il n’est pas surprenant qu’aujourd’hui l’ambition d’un jeune cadre dynamique de 35 – 40 ans ne soit plus tant de gravir la hiérarchie de son groupe que de participer, tôt ou tard, à un LBO.
Quand au même moment on songe que les sociétés cotées, ayant cédé sur ce point à la dictature des comptables, réduisent l’octroi de stock-options en raison de leur comptabilisation en charges en IFRS, on se dit que certaines d’entre elles peuvent avoir des soucis à se faire pour fidéliser leurs meilleurs éléments.
2. Quels sont les défis futurs des fonds de LBO ?
Pour notre part, nous voyons trois enjeux :
S’il n’y a pas de fatalité à ce qu’une entreprise reste sous LBO, il n’y a pas non plus de fatalité à ce qu’elle en sorte. Si le mode de gouvernance du LBO est efficace comme, nous le pensons, il est souhaitable qu’il puisse se prolonger tant qu’il n’est pas dévoyé. Or les fonds ont régulièrement besoin de céder leurs investissements pour donner de la liquidité à leurs investisseurs en se liquidant puisque, sauf exception, ils ne sont pas cotés en bourse et qu’ils ne versent pas de dividende. Ils sont donc obligés de vendre à des industriels ou en bourse, voire à d’autre fonds de LBO.
On parle alors de LBO secondaires, tertiaires, quaternaires. Est-ce pour autant l’indice d’une bulle ? Non, c’est simplement la pérennisation d’un mode de gouvernance qui a démontré son efficacité.
Les LBO successifs posent cependant le problème des dirigeants. Au bout de deux LBO réussis, un dirigeant a normalement fait fortune et son intérêt pour repartir dans une troisième « mise sous tension » a beaucoup faibli : il n’a plus faim ! D’où la nécessité de changer d’équipes dirigeantes et de réussir la greffe d’une nouvelle équipe : c’est le premier défi des fonds de LBO.
Frans Bonhomme, le leader français des tuyaux et raccords plastiques s’apprête à entamer son cinquième LBO depuis 1994 sous une équipe de direction nouvelle depuis 2003. Pour autant, ses performances d’exploitation continuent de s’améliorer :
Est-ce un cas atypique ? Oui, aujourd’hui ; mais demain il pourrait être plus fréquent si les fonds de LBO surmontent leur second défi.
Le second défi est de démontrer que les LBO sont capables de survivre à une crise économique sévère comme celle du début des années 1990 en Europe. Autrement dit, de démontrer que le système est viable en dehors des périodes de conjoncture économique moyennes ou bonnes comme nous les connaissons depuis 10 ans.
Aujourd’hui, le LBO est souvent perçu comme une martingale, un jeu où à tous les coups on gagne. Le risque est oublié. Il est vrai que lorsque l’on fait la liste des LBO connaissant des difficultés, les affaires concernées sont rares et de petites tailles : Serap, Photo Services, De Vecchi Editions, ...
C’est sans doute l’indice d’une bulle comme le sont les montages où les banques acceptent que les flux de trésorerie disponible ne couvre que le paiement des frais financiers non capitalisés, ou les managers qui commencent à négocier leur package d’intéressement avant de regarder sérieusement où sont les leviers d’amélioration opérationnelles.
Mais comment se comporte en cas de crise économique une société régulièrement vidée de ses réserves par des leverage recapitalization ou des LBO à répétition, avec des BFR et des marges tellement optimisées qu’ils ne peuvent plus qu’évoluer dans le mauvais sens ? Comment se comporte alors un management dont les espoirs de plus-values disparaissent brutalement, confronté à un actionnaire qui voudra découper l’entreprise et / ou la vendre à des industriels, mais surtout ne pas réinjecter des capitaux propres afin de donner du temps à l’entreprise pour remettre ses affaires en ordre ? Le mode de gouvernance du LBO ne devient-il pas alors le plus dangereux car conduisant à décourager les dirigeants qui comprennent très vite que pour eux « les carottes sont cuites » ? D’où un sentiment d’abattement, alors qu’il faudrait au contraire galvaniser les énergies.
Ce risque est naturellement renforcé par l’accélération de la rotation des actifs (des durées de détention par un même fonds de 18 à 24 mois ne sont plus rares) qui sont difficilement compatibles avec des stratégies industrielles destinées à asseoir la position stratégique de l’entreprise.
Bref, comme on juge la qualité d’un bateau à sa résistance à une tempête, la prochaine crise économique d’ampleur sera le véritable test de la pertinence sur une longue période des LBO comme un mode d’organisation efficace et donc pérenne.
Cette épreuve surmontée avec succès, un troisième défi attendra les fonds de LBO.
Si le modèle de gouvernance des LBO est plus efficace que celui des sociétés cotées, il n’y a pas de raison qu’il ne s’étende pas progressivement. Michael Jensen, avec son talent de visionnaire, avait prédit dès 1989 (2) le déclin de la société cotée au profit, en particulier des LBO, pour cette raison. Certes, tous les secteurs ne peuvent pas faire l’objet de LBO (la banque, l’assurance, la recherche pharmaceutique ou pétrolière, … s’y prêtent nettement moins, même si certains fonds LBO s’y essayent en période d’euphorie). Mais cela laisse néanmoins de nombreuses situations possibles, en particulier parmi les grands groupes eux-mêmes, et non plus simplement certaines de leurs divisions comme aujourd’hui.
Les fonds de LBO auraient alors besoin de plus d’endettement que les ratios prudentiels des banques pourraient rendre difficile à obtenir d’elles. La marchéisation de ce type d’endettement, déjà en route (obligations high yield, titrisation d’actifs, CDO, …) constitue une solution évidente. De la même façon, les fonds de LBO auraient alors besoin de plus capitaux propres. Aujourd’hui il y a plutôt pléthore de capitaux propres cherchant à s’investir dans les LBO. Mais dans 5 – 10 ans, la poursuite de l’augmentation de la taille des LBO pourrait se heurter à une contrainte de capitaux propres disponibles prêts à s’investir dans des investissements qui sont illiquides. Actuellement, il est souvent conseillé de ne pas dépasser 5 à 10 % d’un patrimoine investi dans des supports non cotés ou illiquides. Si cette contrainte n’était pas levée, la croissance des LBO pourrait trouver là une limite.
Dès lors, le troisième défi à terme des fonds de LBO serait de trouver une liquidité plus grande pour leurs investisseurs afin de les attirer en plus grand nombre ou pour de plus grands montants, par exemple par une cotation en bourse qui n’est pas sans poser de problèmes : risque de cotation avec décote comme celle qui a frappé un temps Wendel Investissement ; complexité de l’évaluation de ce type d’actions compte tenu de la dispersion sectorielle des actifs ; structure financière consolidée peu orthodoxe. Cette évolution se dessine aux Etats-Unis où Appolo et Carlyle ont levé des fonds en bourse.
On pourrait alors arriver à cette situation paradoxale où les fonds de LBO, qui, après avoir fait disparaître progressivement bon nombre des sociétés de la cote, la réanimeraient en s’y introduisant eux-mêmes afin de pouvoir donner une liquidité à leurs investisseurs et lever des fonds afin de continuer à racheter des sociétés cotées classiques. Cette évolution vers une ré-intermédiation forte, pour l’instant de type science-fiction même si on en voit les prémices, ne manquera pas de faire sourire notre lecteur. Elle serait simplement une nouvelle preuve de la capacité du capitalisme à évoluer et à s’adapter.
(2) Eclipse of the public corporation, Harvard Business Review, septembre – octobre 1989, pages 61 à 74.
Tableau : Rachats d'actions et versements de dividendes en 2005
En montant, la palme revient de nouveau à Total qui a dépassé les 3 Md€ de rachat net. En pourcentage du capital, Danone est le premier avec 2,8 % du capital racheté.
En matière de dividendes, les montants sont plus importants (environ 24 Md€) et surtout moins concentrés : les trois premiers groupes (le trio Total, Bouygues et BNP Paribas) versant 30 % des dividendes du CAC 40.
Par rapport à l’an passé, rachats d’actions et versements de dividendes sont en progression de 19 %, malgré la baisse d’un tiers des rachats d’actions net. Vinci, champion l’an passé des rachats d’actions (en % du capital), les a stoppé cette année, probablement en vue de l’acquisition du contrôle d’ASF, BNP Paribas les a réduits de 1 Md€, Carrefour et le Crédit Agricole n’y ont pas eu recours en 2005. Par contre, L’Oréal a franchi la barre du milliard d’euros, probablement parce que ses actionnaires le valent bien …
Coté dividendes, la progression est forte en masse (+ 50 % / 2004) tant à cause de la progression des dividendes unitaires, que des dividendes exceptionnels (Bouygues et Lagardère) et que de la reprise d’un dividende (Vivendi Universal, ST Microelectronics) ce qui ne laisse plus que Alcatel et Cap Gemini au rang des non pratiquants du dividende.
Pour plus de détails sur la politique des dividendes et de rachats d’actions, voir le chapitre 42 du Vernimmen.
Recherche : L'essaimage des groupes
Deux types de motivation sont proposés et testés par les auteurs. Le premier est symbolisé par l’exemple de l’entreprise de semi-conducteurs Fairchild, particulièrement innovante. Entre 1957 et 1976, le tiers des nouveaux entrants dans l’industrie des semi-conducteurs aux Etats-Unis comportait au moins un ancien de Fairchild parmi ses fondateurs (ce fut le cas notamment d’Intel). Les salariés de telles sociétés ont probablement une aversion au risque moindre que ceux de sociétés cotées moins innovantes, en raison des aléas de cette activité. Ajouté au fait qu’ils ont acquis une expérience particulière et sont intégrés dans des réseaux de fournisseurs, de clients et d’investisseurs, cela peut les rendre plus aptes et plus motivés pour la création d’entreprise.
L’autre explication proposée est celle de salariés qui décident de devenir entrepreneurs car ils ne trouvent pas dans leur entreprise le moyen de développer leurs idées. Cela peut être le cas essentiellement dans de grandes entreprises, matures et « bureaucratiques ». Les auteurs prennent l’exemple du constructeur informatique Xerox, qui avait mis en place un centre de recherche particulièrement performant, mais qui ne commercialisait pas par la suite les découvertes de ses chercheurs. Beaucoup d’entre eux ont déposé des brevets sur leurs inventions et sont partis créer leur propre entreprise. Les raisons pour lesquelles une entreprise comme Xerox n’exploiterait pas en interne de nouveaux brevets sont principalement la distance (notamment hiérarchique) entre les dirigeants et les créateurs, ainsi que la valorisation de l’entreprise qui serait négativement affectée par une trop grande diversification de l’activité.
Les données collectées par les auteurs sur les créations d’entreprises financées par capital-risque aux Etats-Unis entre 1986 et 1999 supportent davantage le modèle « Fairchild » que le modèle « Xerox ». Le premier élément notable est le fait que les entreprises de la Silicon Valley sont nettement plus susceptibles (+38%) d’engendrer de nouveaux entrepreneurs que l’ensemble de l’échantillon, après avoir tenu compte des autres caractéristiques des entreprises. Ceci va dans le sens des effets de réseau évoqués plus haut. De plus, les entreprises créées par ces salariés exercent relativement plus souvent des activités différentes de leur entreprise d’origine. Une justification sectorielle de cet effet est donc à écarter.
Dans le même sens, les régressions montrent que les entreprises innovantes, en particulier dans les secteurs privilégiés du capital-risque (informatique et santé), ont une plus forte tendance à voir leurs salariés devenir entrepreneurs, de même que les entreprises ayant été elles-mêmes financées par capital-risque.
(2) Entrepreneurial Spawning : Public Corporations and the Genesis of New Ventures, 1986-1999, P.A. Gompers, J. Lerner and D. Scharfstein, Journal of Finance (avril 2005).
Q&R : Pourquoi des entreprises quittent-elles la bourse ?
La volonté de delister peut suivre la prise de contrôle de la société. L’investisseur industriel qui acquiert le contrôle d’un groupe souhaitera généralement pouvoir mettre en œuvre des synergies avec ses propres actifs et la présence d’actionnaires minoritaires peut alors être gênante. Pour les investisseurs financiers, l’obtention de 95% du capital est nécessaire pour disposer de l’intégration fiscale entre la holding de prise de contrôle et la cible, à ce niveau là, la sortie de la cote devient relativement naturelle. Quelles que soient les circonstances de la prise de contrôle, notons qu’une offre publique venant d’être lancée, le processus de sortie de la cote est assez aisé.
Mais la question du delisting se pose également pour un actionnaire qui dispose depuis un certain temps du contrôle d’une société cotée. Le choix d’être coté ou non est alors un arbitrage entre les coûts liés au fait d’être coté (1) et les avantages de la cotation. Une société (ou son actionnaire) songera donc à un public to private, en premier lieu lorsque les raisons qui l’avaient poussée à se faire coter ont largement disparu. En particulier si :
- la société n’a plus de besoins d’investissement élevés et les actionnaires de contrôle peuvent pourvoir seuls aux éventuels besoins de capitaux propres de l’entreprise. L’entreprise n’a alors plus l’ambition de faire appel au marché, ni de payer des acquisitions en actions ;
- la bourse n’offre plus une liquidité suffisante aux actionnaires minoritaires (ce qui est souvent rapidement le cas pour les sociétés de taille réduite pour lesquelles la liquidité n’est réellement présente que lors de l’introduction en bourse). La cotation devient alors théorique, les investisseurs institutionnels se désintéressant du titre ;
- la société n’a plus besoin de la bourse pour accroître la notoriété de ses produits ou de ses services.
Le second type de motivation est de nature financière. Un actionnaire important, majoritaire ou non, pourra considérer que le cours de bourse ne reflète pas la valeur intrinsèque de la société. Transformant un problème en une opportunité, il pourra être intéressant pour lui de proposer aux minoritaires de sortir et de bénéficier ainsi d’une plus grande partie de la création de valeur future.
La sortie de la cote nécessite le lancement d’une offre publique. Le delisting est alors possible si l’actionnaire majoritaire dépasse un seuil, on parlera alors de retrait obligatoire ou squeeze-out. En France, le seuil est de 95% (2). Il s’agit en pratique de l’acquisition forcée des titres des actionnaires minoritaires restants. S’agissant d’une expropriation, le prix de l’opération est analysé de manière très attentive par l’Autorité de Marche (AMF), et nécessite une attestation d’équité de la part d’un expert indépendant.
Il ne faut cependant pas se leurrer, quelle qu’ait pu être l’évolution du cours de bourse de la société, les actionnaires minoritaires exigeront qu’un prix reflétant la valeur intrinsèque des actions soit offert. A défaut, ils n’apporteront pas leurs titres. Il n’est donc pas étonnant d’observer, alors même qu’il n’y a pas changement de contrôle, que les offres publiques visant au retrait de la cote d’une société sont réalisées avec une prime équivalente à celle payée pour une prise de contrôle (3).
Aux Etats-Unis et pour les sociétés qui y ont une seconde cotation, la sortie de la cote a lieu sans expropriation des actionnaires minoritaires. Ceux-ci restent alors actionnaires d’une société non-cotée qui est toujours soumise aux contraintes d’enregistrement de la SEC. Faire cesser ces contraintes est un véritable casse-tête (4), à un tel point que les sociétés hésitent maintenant avant de demander une cotation ou une seconde cotation outre Atlantique. C’est une des raisons pour lesquelles la SEC a le projet d’assouplir très largement les conditions de désenregistrement pour les sociétés déjà cotées en dehors des Etats-Unis.
(2) Nous renvoyons le lecteur à la page 939 de l’édition 2005 du Vernimmen pour les seuils dans les différents pays européens.
(3) Soit de 20 à 30 % en moyenne.
(4) Voir la lettre Vernimmen n°29, juin 2004.