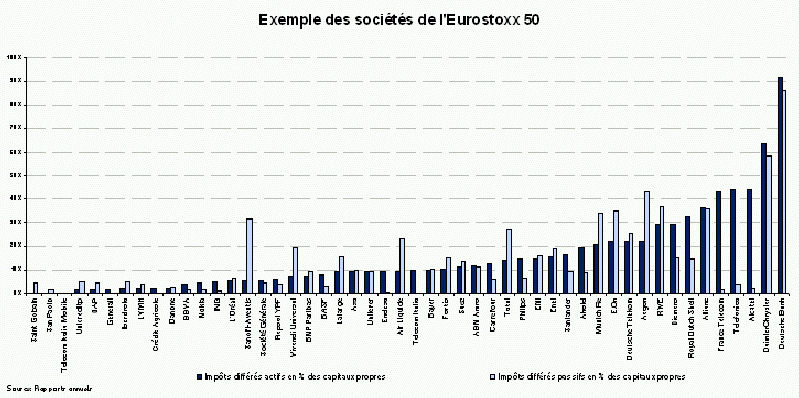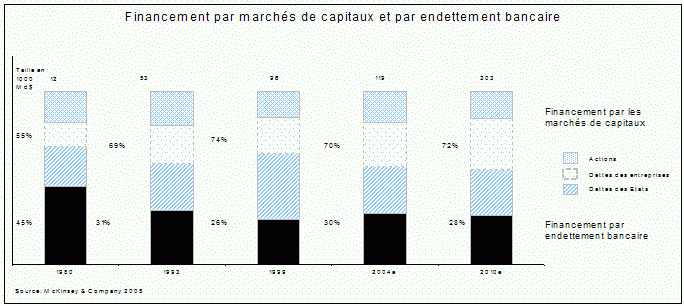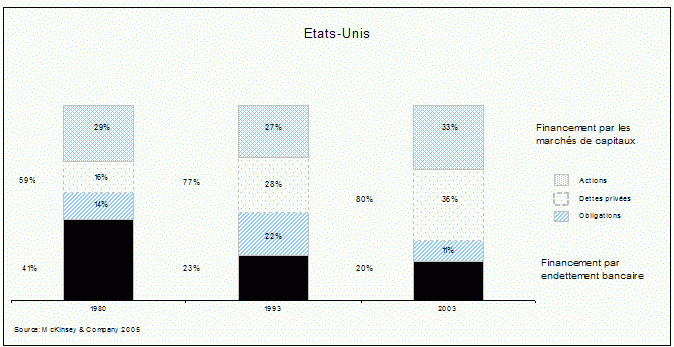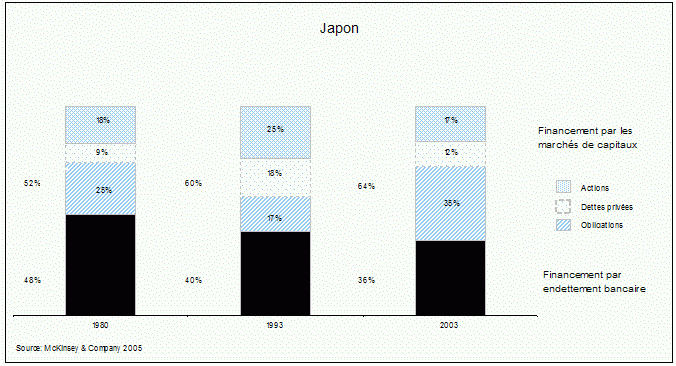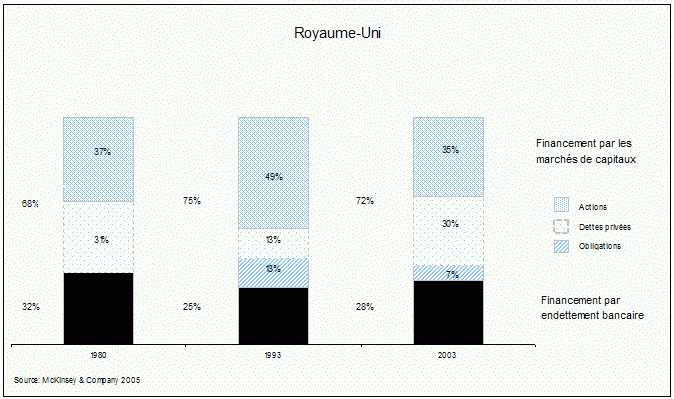La Lettre n°39 de Juin 2005
Actualités : Les impôts différés
1. Les impôts différés ne correspondent ni à un actif certain d’impôt dont le fisc serait redevable ni à une dette à son égard, mais à des écritures comptables sans nécessairement de contrepartie économique ou de flux.
2. Ils résultent d’écritures comptables déclenchées par une différence entre une valeur fiscale et une valeur comptables (au bilan) ou par une écart entre la comptabilité et la fiscalité (au compte de résultat). Leur contrepartie comptable est soit un poste de compte de résultat, soit les capitaux propres.
3. Si les impôts différés sont obligatoirement constatés en comptes consolidés, leur présence en comptes sociaux n’est pas systématique et dans l’immense majorité des cas, ils n’y sont pas constatés. Peut-on pour autant dire que les comptes sociaux sont faux ? Bien sûr que non !
4. Au final, les impôts différés sont souvent une pure construction intellectuelle, source de bien des confusions. Ainsi ils sont fréquemment assimilés par des analystes étourdis à des éléments du besoin en fonds de roulement comme un stock ou une dette fournisseur. Quelle erreur !
Malheureusement, leur importance a peu de chance de décroître à l’avenir. Déjà pour un tiers des entreprises européennes de l’Eurostoxx 50, ils représentent plus de 20 % des capitaux propres, et le pourcentage est similaire pour les entreprises du CAC 40.
Trois cas principaux causent leur comptabilisation :
- lors de pertes ;
- lorsque des provisions sont constatées comptablement sans être immédiatement fiscalement déductibles ;
- et lorsque des actifs sont réévalués par exemple suite à une acquisition (1).
1. Le cas simple des pertes
Un groupe réalise une perte comptable et fiscale, avant impôt, de 100. D’un point de vue fiscal, l’impôt dû est de zéro. D’un point de vue comptable, et dès lors que l’on pense que l’entreprise a de bonnes chances, à l’avenir, de réaliser des profits lui permettant d’utiliser ce report fiscal déficitaire, la perte de 100 sera réduite d’un crédit d’impôt de 34 (2). Elle s’établira donc comptablement à 66. Pour permettre l’équilibrage des documents comptables, un impôt différé actif sera créé à l’actif du bilan pour 34.
L’an prochain si notre groupe fait un profit comptable et fiscal de 100, son impôt à payer sera nul puisque le report fiscal déficitaire créé cette année sera utilisé pour compenser le résultat. D’un point de vue comptable, on constatera une charge d’impôt totalement théorique de 34 et l’on ramènera à 0 l’impôt différé actif constaté précédemment au bilan.
Cet exemple montre bien que l’impôt différé actif a été créé par réduction du montant de la perte comptable nette et donc en accroissant d’autant les capitaux propres. D’un point de vue financier, il n’a de valeur que pour autant que l’exploitation future soit capable de générer des profits suffisants. Mais en aucun cas il ne constitue un actif au sens classique du terme que l’on pourrait céder contre des liquidités. Il n’est surtout pas un élément du BFR car il ne résulte pas d’un décalage entre une facturation et un paiement. On le considerera comme un actif immobilisé; au pire, on l’extournera des capitaux propres si l’on a des vrais doutes sur la capacité benéficiaire future de l’entreprise.
2. Le cas des provisions non immédiatement fiscalement déductibles
En France, les provisions pour retraites, pour restructurations, pour risques environnementaux, … ne sont pas fiscalement déductibles au moment de leur comptabilisation. Ce n’est qu’au moment où la charge est constatée que celle-ci est fiscalement déductible. La règle comptable en comptes consolidés est différente puisqu’elle postule que la dotation à ces provisions est fiscalement déductible lors de leur comptabilisation. D’où un décalage entre la réalité des flux et le traitement comptable.
Reprenons notre groupe maintenant profitable à hauteur de 100 / an avant impôt. Cette année il doit passer une provision de 100 pour un risque qui pourrait intervenir dans 3 ans. Fiscalement, le résultat net est de 66 puisque la provision n’est pas fiscalement déductible et que l’impôt payé est de 34. D’un point de vue comptable, la provision de 100 étant une charge, le résultat net est de 0. L’impôt effectivement payé (34) figure au compte de résultat mais il est neutralisé par un produit d impôt différé de 34 qui, pour maintenir l’équilibre bilantiel, figure aussi à l’actif du bilan pour 34. Au total, l’impôt apparaît pour 0 au compte de résultat.
Dans 3 ans, toutes choses égales par ailleurs, le résultat net fiscal est de 0 puisque la charge est fiscalement déductible, l’impôt effectivement payé cette année est donc de 0. Comptablement la reprise de provisions neutralise la charge, le résultat avant impôt est donc de 100 – 100 + 100 = 100. L’impôt comptabilisé est de 34 qui se décompose en 0 d’impôt payé et 34, constaté par prélèvement sur l’impôt différé actif constaté au bilan 3 ans auparavant, qui est ainsi soldé.
L’impôt différé actif constaté au bilan pendant 3 ans a pour contrepartie des capitaux propres plus élevés de 34. Il correspond à un impôt déjà payé, mais est considéré comptablement comme une charge future. A la différence d’un stock de matières premières qui a été payé et qui est aussi une charge future, il n’a aucune valeur vénale.
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi nous qualifions, dans nos idées introductives, les impôts différés de «pure construction intellectuelle». Vous comprenez aussi la difficulté de tout analyste face à cette monstruosité d’un actif qui n’en est pas un malgré son nom et qui n’existe que pour nier une charge qui a bien été payée … mais que l’on a décidé arbitrairement en comptes consolidés de n’enregistrer que plus tard alors qu’en comptes sociaux elle a déjà été constatée.
Le traitement financier à lui réserver est simple : à porter en moins de la provision au passif (de sorte qu’elle apparaisse alors après impôt) ou en moins des capitaux propres pour extourner l’écriture initiale.
3. Le cas des réévaluations d’actifs
La réévaluation d’un actif lors de sa première consolidation ou ultérieurement (à l’occasion d’un test de dépréciation) a deux conséquences :
- la plus value fiscale en cas de revente de l’actif sera différente de la plus value comptable constatée en comptes consolidés ;
- la base d’amortissement sera différente, et génère donc des impôts différés.
Un groupe acquiert une nouvelle filiale qui possède un terrain inscrit au bilan à sa valeur d’acquisition initiale de 100. Ce terrain est réévalué dans le comptes consolidés pour 150.
On va alors constater un impôt différé passif de (150 – 100) x 34 % = 17 dans les comptes consolidés. A quoi correspond économiquement ce passif ? A la différence qui serait constatée dans les comptes consolidés entre l’impôt réellement payé le jour où ce terrain est cédé pour un prix de P : (P – 100) x 34 % et l’impôt qui serait comptablement constaté de (P – 150) x 34 %. La contrepartie bilantielle de cet impôt différé est une moindre réduction du goodwill d’acquisition qui ne diminue pas de 50 mais de (50 – 17). Est-ce une dette à l’égard du fisc ? Clairement non puisqu’il faudrait que le terrain soit vendu pour qu’une dette fiscale apparaisse et alors pour un montant de (P – 100) x 34 % et probablement pas de 17 ! Bref on continue dans l’abstraction intellectuelle qui est tout sauf limpide. Pour le financier, que faire de cet impôt différé passif ? Le déduire du goodwill.
Quant au cas de l’actif réévalué mais amortissable, nous nous permettons de vous renvoyer au chapitre 9 de la prochaine édition de Vernimmen qui le traite. Encore 3 mois de patience !
Si vous nous avez suivi jusqu’à présent, vous pouvez entrevoir un bouquet final constitué de la constatation initiale d’un impôt différé passif progressivement réduit sur la durée de vie résiduelle de l’actif par des impôts différés actifs dus à l’écart entre un amortissement fiscal calculé sur une base de 100 et des amortissements comptables calculés sur une base de 150.
Au total, la comptabilisation de l’impôt selon des règles différentes de celle de l’exigibilité fiscale fait naître des impôts différés actifs et passifs. Les avantages qu’ils peuvent apporter nous semblent largement inférieurs à la confusion dans les esprits qu’ils créent, en particulier au niveau du bilan. Une fois n’est pas coutume, nous préférons très nettement le traitement retenu dans les comptes sociaux, c’est-à-dire leur absence de comptabilisation. Gardons les choses simples.
(1) Pour plus de détails, voir la Lettre Vernimmen.net n° 24 de décembre 2003.
(2) Si le taux de l’impôt sur les sociétés est de 34 %.
Tableau : 119 000 000 000 000 de $
Dans une étude intéressante (1), McKinsey montre qu’au niveau mondial le passage d’une économie d’endettement à celui d’une économie de marché financier s’est achevé au début des années 1990.
Rappelons (2), que dans une économie d’endettement le marché financier est peu développé. Dès lors une faible part des besoins des entreprises est financée par émission de titres financiers. Une économie d’endettement est une économie dans laquelle prédomine le financement par crédit bancaire. Les entreprises sont donc fortement endettées auprès des banques qui se refinancent auprès de la Banque Centrale.
Dans une économie de marchés financiers (2), l’essentiel des besoins de financement est couvert par l’émission par les entreprises de titres financiers (actions, obligations, billets de trésorerie, …) souscrits par les investisseurs. Une économie de marchés financiers est caractérisée par l’appel direct à l’épargne. A l’inverse, une part très importante des placements des agents excédentaires se fait directement sur les marchés financiers par souscriptions ou achats d’actions, d’obligations, de billets de trésorerie, de certificats de dépôts, d’actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds commun de placement (FCP). L’intermédiation cède le pas à l’intermédiaire, les établissements financiers faisant évoluer leur rôle vers le placement des titres émis par les entreprises auprès des investisseurs.
En effet, la part des financements se stabilise autour de 30 % et celles des financement de marché autour de 70 %. Mais naturellement, ces chiffres globaux cachent des disparités régionales fortes puisqu’aux États-Unis la part des financements bancaires n’est plus que de 20 % contre 30 % dans la zone Euro et 36 % au Japon.
Ces graphiques ne sont que quelques un des graphiques nouveaux que comportera la nouvelle édition du Vernimmen qui sera disponible en septembre.
(2) Pour plus de détails, voir le chapitre 21 du Vernimmen.
Recherche : Pratique de la finance d'entreprise en Europe
Ces différences ont des répercussions importantes en termes de gouvernement d’entreprises et in fine sur le développement des marchés financiers de ces pays. Ces différences devraient également avoir des répercussions importantes sur les pratiques financières des entreprises en Europe et aux Etats-Unis. Une équipe néerlandaise (1) a étudié cette question en conduisant une enquête auprès d’un échantillon d’entreprises européennes pour venir compléter une étude américaine (2) que nous avions présenté dans un précédent numéro de La Lettre Vernimmen.net (3).
Les résultats qu’ils obtiennent sur un échantillon de 313 réponses de directeurs financiers d’entreprises anglaises, néerlandaises, allemandes et françaises sont conformes à l’idée que l’on se fait de la pratique de la finance en entreprise. Nous présentons leurs principaux résultats ci-dessous.
Les auteurs constatent que les entreprises européennes ayant répondu à leur enquête n’ont pas toutes les mêmes objectifs suivant le pays d’origine. Si les entreprises britanniques et néerlandaises déclarent que la valeur actionnariale est l’un de leurs critères de décision les plus importants, les entreprises françaises et allemandes sont beaucoup moins nombreuses à leur accorder cette importance.
Le critère de décision d’investissement favori des directeurs financiers des entreprises européennes sondées est majoritairement le critère du délai de récupération de l’investissement (pay-back) (4). Ce critère ne prend en compte ni la valeur temps des flux de trésorerie ni les cash flows postérieurs à la date de récupération de l’investissement. Aux Etats-Unis, ce critère de choix n’était que le troisième derrière le TRI (taux de rentabilité interne) et la VAN (valeur actuelle nette). La prédominance de ce critère de choix d’investissement en Europe est plus prononcée dans les petites entreprises et dans les entreprises dont les dirigeants sont plus âgés et n’ont pas eu de formation de type MBA, ainsi que dans les entreprises non cotées.
Parmi les entreprises utilisant des critères de VAN pour décider de leurs investissements, les entreprises européennes utilisent principalement le MEDAF (modèle d’évaluation des actifs financiers) pour calculer leur coût du capital, mais un peu moins souvent que leurs homologues américaines. Encore une fois, les entreprises de taille importante et celles cotées en bourse font davantage appel à cette méthode que les autres entreprises.
Par ailleurs, les facteurs de risques spécifiques aux projets d’investissement (risque de taux d’intérêt, de taux de change etc..) ne sont que rarement pris en compte par les entreprises européennes à l’instar de leurs homologues américaines. Seules les entreprises françaises et dans une moindre mesure les entreprises allemandes disent ajuster le taux d’actualisation des cash flows à la performance boursière récente et au risque de variation du prix des matières premières. Enfin, les entreprises européennes n’adaptent que peu le coût du capital requis d’un projet international à l’environnement géographique de ce projet contrairement à ce que la théorie et le bon sens recommandent (5).
Les auteurs étudient également les choix de structure du capital (ratio dette sur capitaux propres) des directeurs financiers des entreprises européennes. Ils étudient la pertinence des deux principales théories de la structure du choix de capital. La première théorie est la théorie du trade-off (6) qui postule que chaque entreprise a une structure de capital cible qui dépend des avantages fiscaux liés à la dette et des coûts de faillites. La seconde théorie du pecking-order (7), postule que les entreprises ont, du fait d’une asymétrie d’information entre les dirigeants et les marchés financiers, un ordre de préférence entre les différentes sources de capitaux pour financer leurs projets d’investissement. Les ressources internes sont préférées à la dette, qui est elle-même préférée aux capitaux propres.
Les entreprises européennes, et parmi elles surtout les entreprises françaises et britanniques, semblent être légèrement moins nombreuses que leurs homologues américaines à se fixer une structure du capital optimale à atteindre. De plus, les critères généralement attribués à la fixation d’une structure de capital cible (avantages fiscaux de la dette, coûts de faillite) ne semblent pas influencer de manière aussi tangible qu’aux États-Unis la détermination de la structure de capital optimale. Les résultats obtenus ne soutiennent que faiblement la théorie du trade-off en Europe.
La théorie du pecking order semble être rejetée en Europe tout comme d’ailleurs aux États-Unis dans l’étude américaine. Le comportement des directeurs financiers européens laisse apparaître une préférence pour les sources internes de financement relativement à la dette et aux capitaux propres.
La motivation profonde de ce comportement n’est pas liée aux asymétries d’information entre les dirigeants et les marchés financiers, mais à la volonté de garder une flexibilité permettant de financer de manière autonome les investissements. Cela ne devrait pas beaucoup surprendre nos lecteurs qui savent que l’argument de choix d’une structure financière motivé par des considérations fiscales ne nous est jamais apparu très convainquant.
Enfonçant un peu plus de portes ouvertes, les auteurs montrent que plus les entreprises sont de taille importante, plus elles sont concernées par la création de valeur pour leurs actionnaires et plus elles vont utiliser des méthodes sophistiquées pour décider de leurs projets d’investissements.
(2) Graham, J.R. Campbell, Harvey. 2001. “The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence From the Field”, Journal of Financial Economics, pages 187 à 243.
(3) N° 2 de juillet 2001.
(4) Voir chapitre 40 section 4 du Vernimmen.
(5) Voir le chapitre 41 du Vernimmen.
(6) Voir le chapitre 38 du Vernimmen.
(7) Voir le chapitre 47 du Vernimmen.
Q&R : Comment choisir entre dividendes, rachats d'actions et réduction du capital ?
Cinq critères principaux permettent de choisir l’instrument le mieux adapté à l’objectif recherché :
1/ La flexibilité
Il est difficile de modifier brutalement et de façon importante le niveau d’un dividende. Cela appelle des questions sur l’évolution du modèle de l’entreprise et crée des attentes de la part des investisseurs quant au maintien à l’avenir de ce nouveau niveau de dividende. Dès lors les modifications du dividende sont le plus souvent lentes à mettre en place et ne produisent des effets sur la structure financière de l’entreprise qu’au bout de plusieurs années.
A l’inverse, la réduction de capital et le dividende exceptionnel sont des opérations qui peuvent être ponctuelles, sans aucune attente de récurrence de la part de l’actionnaire. Elles sont donc particulièrement bien adaptées pour rendre aux investisseurs le produit de cession d’un actif important (le réseau de distribution d’Enel en 2004 par exemple) ou modifier la structure financière (Bouygues en 2005).
2/ Le signal
Toute décision financière pouvant être perçue comme un signal par l’investisseur, l’entreprise devra réfléchir à la perception par le marché du choix de l’outil.
Dans ce domaine le plus neutre est le dividende exceptionnel. Il est, par construction, ponctuel, il n’implique aucun jugement implicite sur la valeur de l’action dont il est indépendant. Enfin il bénéficie à tous les actionnaires.
A l’inverse, une modification du dividende ou une réduction de capital sont clairement perçus comme des signaux. Dans le premier cas sur le niveau futur des profits. Dans le second sur le niveau de la valeur de l’action puisqu’une entreprise n’achètera pas une partie de ses actions si ses dirigeants considèrent que l’entreprise est actuellement sur-évaluée.
3 / L’impact sur l’actionnariat
Le dividende et le dividende exceptionnel n’ont pas d’impact sur l’actionnariat car ils ne modifient pas le nombre d’actions de l’entreprise. En revanche la réduction de capital et les rachats au fil de l’eau affectent naturellement la composition de l’actionnariat puisque certains actionnaires peuvent très bien décider de ne pas participer à des réductions de capital ou ne pas céder de titres sur le marché pendant que l’entreprise procède à des rachats d’actions. Leur part dans le capital s’accroît. C’est ainsi que les rachats d’actions auxquels le groupe Peugeot a procédé très régulièrement depuis 1999 pour un montant total de 2 580 M€ a permis à la famille éponyme de porter sa participation de 22,7% à 29,2 %. Une hausse du dividende, difficile dans un secteur aux résultats aussi cycliques que l’automobile, ou un dividende exceptionnel, n’auraient naturellement pas modifié l’actionnariat.
4/ L’impact sur les stock-options des dirigeants
La réduction de capital par rachat au-dessus de la valeur entraîne un ajustement prévu par la loi du prix d’exercice des stock-options qui rend l’opération neutre pour le détenteur de stock-options.
En revanche, la loi française n’a rien prévu en cas de dividendes, de rachats au fil de l’eau ou de dividende exceptionnel. Comme le dividende exceptionnel peut réduire fortement la valeur de l’action, le non ajustement automatique du prix d’exercice des stock-options explique que cet outil soit donc très peu prisé des dirigeants ….
La forte baisse jusqu’au début des années 2000 du nombre de sociétés américaines versant un dividende (de 66% en 1978, à 21% en 1999) (1) s’explique en partie par le remplacement des dividendes par des rachats d’actions, probablement sous l’influence des dirigeants détenteurs de stock-options. En effet le versement d’un dividende fait mécaniquement baisser le cours de l’action du montant du dividende et donc abaisse d’autant l’espérance de gain sur les stock-options dont le prix d’exercice reste fixe. Le rachat d’actions n’a pas cet effet négatif sur la valeur des stock-options et laisse même croire aux naïfs qu’il fera monter le cours de l’action (puisque l’on en rachète !). On oublie alors que l’actionnaire peut avoir besoin de liquidités et que, privé de dividendes, il devra vendre des actions pour en obtenir.
5/La fiscalité
Elle est naturellement un élément à prendre en compte puisqu’elle peut être différente selon la technique retenue pour rendre des fonds aux actionnaires.
Pour les personnes physiques imposées dans les tranches les plus élevées de l’impôt sur le revenu, la fiscalité française la plus douce est celle de la plus-value (27% contre 35% pour le dividende), ce qui peut les conduire à céder des titres sur le marché plutôt que de participer à une réduction de capital.
Pour les personnes morales bénéficiant du régime mère-fille, la réduction du taux d’imposition des plus-values (2) rend quasiment indolores toutes ces opérations et les met sur un pied d’égalité de ce point de vue.
Aux États-Unis la fiscalité des dividendes pour les personnes physiques a été considérablement adoucie en 2003, passant d’une imposition au taux marginal de l’impôt sur le revenu à une imposition à 15%. Ceci a redonné tout son attrait au dividende au détriment des rachats d’actions qui avaient en 1999 dépassé en montant pour la première fois les dividendes.
Ces paragraphes font partie des nombreux développements nouveaux qui figurent dans la nouvelle édition du Vernimmen disponible en septembre 2005.
(2) 15,72 % en 2003, 8,26 % en 2006 et 1,72 % au-delà.