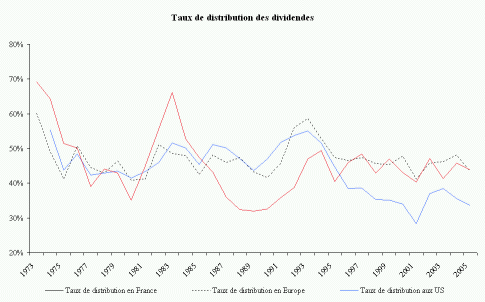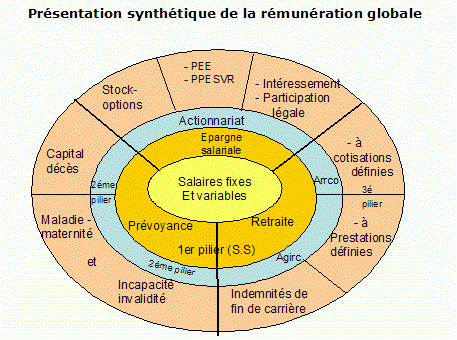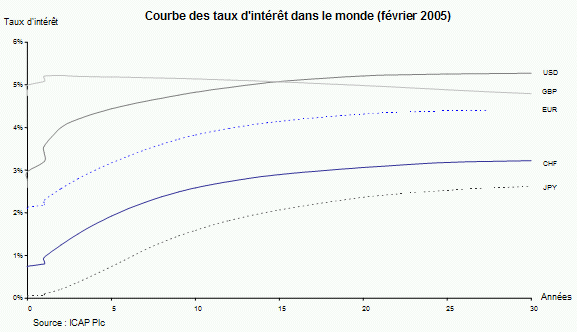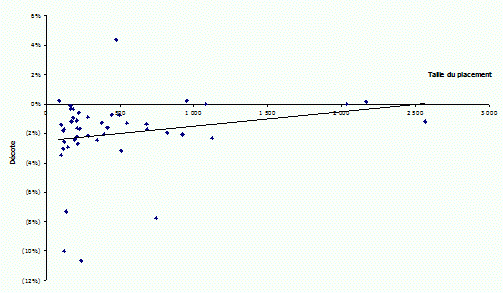La Lettre n°37 de Mars-Avril 2005
Actualités : Quel niveau de dividende verser en 2005 ?
1- Faut-il d’abord avoir une politique de dividende ?
Oui sans aucun doute ! Dans ce domaine, il n’y a rien de pire que de ne pas avoir une politique réfléchie de dividende, c’est-à-dire d’en verser un dont les variations chaque année soient totalement erratiques, déconcertant l’investisseur. De la même façon, il faut éviter d’avoir une politique non crédible, par exemple en fixant un niveau de dividende très élevé par rapport à la génération de trésorerie de l’entreprise et aux investissements requis. La seule question que se posent alors les investisseurs est de savoir quand le dividende sera abaissé, ce qui n’est pas excellent pour la tenue du cours… comme la banque britannique Lloyd-TSB expérimente à ses dépens depuis 2002.
2- Pourquoi verser un dividende ?
- D’abord parce qu’en ce moment les actionnaires le demandent et que c’est à la mode. Il fut un temps pas si lointain (novembre 1998) où Telefonica supprimait son dividende et son cours s’envolait de 9%. De nos jours, la même annonce aurait plutôt l’effet inverse tant il est clair que les entreprises qui versent un bon niveau de dividendes sont valorisées en bourse sur la base de multiples plus élevés que les autres (1).
- Ensuite parce que c’est un moyen pour les actionnaires de réduire la marge de manœuvre des dirigeants en limitant les liquidités dont ils disposent. C'est la purge des médecins de Molière ! On pourra regretter ce manque de confiance des investisseurs envers les dirigeants des sociétés dont ils ont choisi d’être actionnaires. On le comprend compte tenu de certains excès enregistrés au tournant du millénaire, du désendettement général et de l’importance actuelle des flux de trésorerie dégagés. On retrouve la théorie de l’agence (2).
- C’est enfin un signal crédible et perçu comme tel sur la marche de l’entreprise à l’horizon de 2-3 ans. On imagine mal en effet un dirigeant responsable proposer d’augmenter le dividende par action si c’est pour l’abaisser l’année suivante en raison d’une dégradation des résultats ou de besoins de restructuration. Bref augmenter le dividende, c’est manifester de la part des dirigeants une confiance dans l’avenir fondée sur des informations qu'ils détiennent et qui ne sont pas nécessairement dans le public. On retrouve la théorie du signal (3).
3- Quel niveau fixer ?
Dans ce domaine la logique financière est froide. Une fois atteint un niveau de structure financière qui correspond à l’objectif des dirigeants et des actionnaires compte tenu de leur appétence pour le risque, l’entreprise doit rendre à ses actionnaires tout euro qui ne trouve pas à s’investir dans des projets rapportant au moins le coût du capital compte tenu de leurs risques.
Rendre des fonds à l’actionnaire peut prendre trois formes :
- le dividende, mais dont les variations sont mûrement réfléchies compte tenu de leurs conséquences ; c’est donc un peu comme un superpétrolier dont la tendance ne s’infléchit que progressivement ;
- le dividende exceptionnel, qui est exceptionnel comme son nom l’indique ! Donc il n’a pas de vocation à la récurrence. Il est utilisé suite à la cession d’une branche d’activité qui gonfle les liquidités de l’entreprise (Legris en 2001, Enel en 2004) ou de l'accumulation au cours du temps de très bons résultats (Bouygues en 2005) ;
- le rachat d’actions, dont la mise en œuvre est très souple même si elle est très encadrée par les régulateurs boursiers. Modifiant le nombre d’actions, il a naturellement un impact sur le BPA et la géographie du capital. Il n’a de sens financier que lorsque les cours apparaissent bas.
En conclusion, vous trouverez ci-dessous le graphique des taux de distribution de dividendes en France, en Europe et aux Etats-Unis depuis 1973. Bonne méditation ! (4) .
(2) Pour plus d’éléments sur la théorie de l’agence, voir le chapitre 35 du Vernimmen.
(3) Pour plus d’éléments sur la théorie du signal, voir le chapitre 35 du Vernimmen.
(4) Pour la compléter, vous pouvez consulter le chapitre 44 du Vernimmen.
Actualités : Qu’est-ce que la gouvernance sociale ? Par Gérard Valin (1)
Concept émergent depuis peu d’années dans les pays à économie avancée, la Gouvernance Sociale se définit comme l’ensemble des modalités de pilotage et de contrôle des avantages sociaux (EPR/épargne, prévoyance, retraite) consentis par les entreprises à leurs salariés et dirigeants.
La Gouvernance Sociale résulte de la confluence de deux tendances fortes apparues au tournant du XXIème siècle : la Gouvernance d’Entreprise et le Développement Durable.
- Dans sa forme actuelle, la Gouvernance d’Entreprise générée au gré de nombreux rapports, en Europe (Cadbury, Greenbury, Hampel pour la Grande-Bretagne, Viénot, AFG ASFI et Bouton pour la France), a désormais son point d’équilibre « à l’occidentale ». Il s’agit, pour l’essentiel, d’un exercice nouveau du pouvoir actionnarial renforcé grâce à la spécialisation des instances représentatives. Ainsi, les conseils d’administration (ou de surveillance) connaissent, dans la plupart des cas, trois catégories de comités spécialisés :
- le comité d’audit, chargé du pilotage et du contrôle des comptes, en liaison avec les auditeurs internes et externes,
- le comité des rémunérations, chargé de la fixation et du contrôle des rémunérations globales des dirigeants sociaux,
- les comités des risques, chargés de la stratégie globale.Chacun de ces trois comités fonctionne dans un contexte où tout conflit d’intérêt devrait être éliminé. C’est ainsi qu’est apparue la nécessité d’élire des administrateurs « indépendants ». A l’usage, les évolutions ainsi générées n’ont pas apporté tous les bénéfices attendus si l’on en juge par les multiples scandales financiers et comptables de la décennie écoulée. Néanmoins, les autorités de marché favorisent la Gouvernance d’Entreprise en précisant notamment les critères d’indépendance souhaitables. Ainsi, la question se pose-t-elle de savoir à l’égard de qui et de quoi les administrateurs sont réellement indépendants. Il ne s’agit plus, en effet, seulement d’administrateurs non salariés, ou libres de tout engagement à l’égard des actionnaires principaux, mais surtout d’administrateurs compétents, connaissant à la fois les techniques concernées (finance, comptabilité, rémunération), ainsi que les risques des activités exercées. Certains ont pu faire observer que les meilleurs administrateurs indépendants seraient d’anciens représentants de la concurrence directe puisque, d’entrée de jeu, les conflits d’intérêt et les compétences des métiers ne seraient plus source de problème …
Paradoxalement, les salariés ne semblent jouer aucun rôle dans la Gouvernance d’Entreprise, au moment même où les fonds de pension d’origine anglo-saxonne détiennent 30 à 40 % de la capitalisation boursière mondiale. Ces mêmes fonds de pension doivent d’ailleurs faire face à des exigences de rendement des actifs sous gestion devant compenser le coût d’une démographie « vieillissante ». C’est ainsi que ces fonds de pension sont devenus les principaux zélateurs des ambitions de Développement Durable.
- L’éclatement de la bulle boursière des années 1995 – 2000, principalement alimenté par l’ « exubérance irrationnelle » critiquée par le Pr. R. Shiller, a ouvert les yeux de la communauté financière. Au lieu d’extrapoler des croissances de chiffre d’affaires et de bénéfices à deux chiffres, notamment dans le domaine des NTIC, les tenants du Développement Durable font valoir l’intérêt d’une croissance profitable à l’ensemble des parties prenantes, à savoir les actionnaires, les salariés et les sociétés civiles, sur la base d’un ratio performance / risques globalement acceptables ! Ces ambitions ainsi déclarées ne se réduisent pas à une approche nationale, mais englobent les questions générales d’environnement conduisant à des perspectives transnationales. Le Développement Durable s’est notamment traduit par la mise en place de véhicules d’investissements socialement responsables « ISR », de plus en plus favorisés par les investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension. Aujourd’hui, les concepts de développement durable sont en voie d’implantation, notamment en France, grâce à la loi NRE du 15 mai 2001 (article 116, devenu article 225-112-1 du Code du Commerce). Ainsi, toute société cotée doit établir un rapport annuel « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences environnementales et sociales de son activité ». Les sociétés multinationales ou transnationales font référence aux critères du GRI (Global Reporting Initiatives) émanant du Global Compact de l’ONU. Néanmoins, la quantification nécessaire aux besoins de l’analyse financière reste généralement insuffisante, en l’état actuel des publications annuelles des entreprises.
Les trois concepts de base de la gouvernance sociale :
Dans ce contexte, la combinaison de la Gouvernance d’Entreprise et du Développement Durable a abouti à l’émergence de la Gouvernance Sociale au sein des entreprises. Celle-ci repose sur trois concepts de base :
- D’une part, dirigeants d’entreprises et salariés sont conscients qu’ils sont liés à long terme par le pilotage optimal d’une rémunération globale qui se compose, pour chaque catégorie de salariés, de :
- salaires fixes ou variables à règlement immédiat (financement exclusif employeur),
- des rémunérations de substitution de type prévoyance en cas de maladie, accident du travail, décès (financement partagé employeur-salarié),
- des rémunérations différées de type retraite, stock-options ou épargne salariale (financement partagé employeur- salarié).La connaissance et l’adoption durable de cette vision globale des rémunérations, par catégories de bénéficiaires,constitue le point de départ de toute gouvernance sociale raisonnablement structurée à long terme.
- D’autre part, le bon pilotage de cette rémunération globale s’appuie sur la reconnaissance des coûts partagés entre l’entreprise et le salarié, chacun assumant une part de financement. Par ailleurs, les valeurs acquises par les rémunérations différées de type retraite ou stock-options résulteront d’évolutions boursières (actions, obligations) ou immobilières endogènes (titres de l’entreprise) ou exogènes, sur la base de risques plus ou moins bien diversifiés.
- Enfin, la mise en conformité des objectifs de revalorisation de la rémunération différée est tributaire des nouveaux modes de gestion passif – actif, caractérisés par la prise en compte de contraintes minimales de rendement à long terme. Ceci est particulièrement vrai pour tous les systèmes de retraite à prestations définies. Ceux-ci garantissent, en effet, un niveau minimal de prestations de retraite en fonction des derniers salaires et de la carrière dans l’entreprise. Ces systèmes (dits en defined benefits) conduisent à d’importants passifs sociaux à la charge des entreprises employeurs.
Sur un autre registre, les stock-options aboutissent également à des passifs conditionnels supportés par les entreprises, et à des charges annuelles, selon la derniere formulation des normes IFRS.
Les trois pratiques issues de la Gouvernance Sociale :
La Gouvernance Sociale, construite autour de ces trois concepts, aboutit à trois conséquences pratiques majeures en matière de retraite par exemple :
- Les entreprises sont astreintes, face aux normes comptables internationales (IAS 19, FASB 87), à enregistrer tout ou partie des engagements sociaux sous forme de passif conditionnel et, dans certaines circonstances, de charges annuelles. Il faut savoir qu’aujourd’hui, l’impact comptable sur les résultats annuels a été volontairement limité (principe du corridor), ce qui ne veut pas dire que les incidences en terme de parité ou d’évaluation des actions doivent être négligées, par exemple en cas d’OPA, fusion ou rapprochement, en général.
- Le comité des rémunérations ne limite plus son périmètre d’intervention aux seuls mandataires sociaux, mais à tous ceux qui bénéficient de rémunérations différées et, en particulier, les hauts potentiels. Les stratégies d’allocations de stock-options ou de retraite à prestations définies conduisent, par ailleurs, certaines d’entre elles à mettre en place les principes généraux de rémunérations transnationales sur des bases élargies. De ce point de vue, la connaissance des normes comptables internationales (Stock-options : IFRS 2, FAS 125) est indispensable.
Ces évolutions majeures ne passent pas inaperçues en termes de contrôle du pouvoir au sein des entreprises elles-mêmes, de sorte que les autorités de contrôle de type SEC, AMF, FSA, « planchent » aujourd’hui sur des réformes d’une grande ampleur concernant le pilotage des fonds de pension eux-mêmes. C’est donc le rôle des « trustees » ou organes dirigeants des fonds de pension qui se trouve lui-même mis en cause, comme on l’a vu récemment au sein du conseil du fonds américain Calpers. Le point de vue politique n’est pas absent du débat puisque Calpers, qui gère les retraites des fonctionnaires californiens, a adopté une approche démocrate face à un Gouverneur résolument Républicain.
Vers une réconciliation globale des approches économiques et sociales par la gouvernance transnationale ?
Bien malin celui qui jouerait les devins dans cet affrontement entre les tenants d’avantages sociaux soumis à un pilotage à base démocratique élargie et les partisans d’une société libérale moins encadrée par les représentants des parties prenantes.
D’un point de vue actuariel et technique, et quels que soient les modes de gestion retenus (répartition ou capitalisation), la seule hypothèse raisonnable repose sur l’extension progressive des avantages sociaux auprès de populations plus jeunes, c’est-à-dire principalement actives dans les pays émergents (Amérique du Sud, Chine, Inde, …).
De ce point de vue, les entreprises transnationales sont aujourd’hui les mieux placées pour organiser cette diffusion des avantages sociaux gérés à long terme, selon une Gouvernance Sociale équilibrée. Ce processus de mutualisation transnationale des avantages sociaux est certainement l’un des plus grands espoirs du XXIème siècle (2) , grace aux perspectives économiques et sociales qu’il autorise. Par l’enrichissement des populations concernées et leur accès au statut de classe moyenne, il promeut une diffusion effective du pouvoir d’achat sur un plan global. De façon paradoxale, c’est sans doute cet appauvrissement relatif des économies occidentales par rapport aux économies émergentes qui sauvera leur propre système de retraite. Le rééquilibrage des coûts de production, la diffusion des avantages sociaux, ainsi que les propensions à consommer et, progressivement, à épargner, s’effectueront suivant une évolution globalisée…dont il reste à réguler le rythme optimal.
Les représentants des diverses parties prenantes de la gouvernance sociale sont ainsi appelés à s’adapter à ce nouveau contexte. Les évolutions souhaitables concernent notamment leur représentativité effective, leurs modes de communication et de négociation, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux moyens de pression,dans un monde multiculturel, conflictuel et hypermédiatisé.
Tableau : Les courbes de taux d’intérêt
Si les courbes de taux d’intérêt sont toujours pentues (taux longs supérieurs aux taux court terme) indiquant une anticipation de hausse des taux courts, leur inclinaison est devenue faible puisque les taux qui ont monté étaient les taux courts alors que les taux longs se sont réduits.
Malgré la légère et récente hausse des taux courts les entreprises bénéficient plutôt aujourd’hui d’une baisse du coût de leur endettement compte tenu de la baisse des marges (qui se rajoutent au taux sans risque pour un emprunteur). Outre une amélioration globale du risque des entreprises, la situation d’excédent de capitaux propres et donc les capacités de prêts non saturés de la plupart des banques européennes sont les principales raisons de cette sympathique évolution des marges.
La seule exception est le Royaume-Uni où la courbe des taux est plate : l’argent à 1 jour coûte aussi cher que l’argent à 30 ans : 4,80 % contre 2,1 % à 4,4 % pour l’euro. Cette situation n’est pas durable puisque le risque n’est pas rémunéré. Il est clair que c’est la conséquence d’un resserrement précoce des taux par la Banque d’Angleterre pour lutter contre l’inflation.
S’il est un pays où ce sujet ne semble pas être à l’ordre du jour, c’est bien le Japon : l’argent à 1 jour coût 0,04 % (sic) et à 30 ans 2,60 %.
Recherche : Le financement des PME américaines
Ainsi, aux Etats-Unis, où une administration (Small Business Administration : SBA) s’occupe spécifiquement du soutien à ces entreprises, on estime que ces PME représentent près de 50% de la production totale et des emplois et, surtout, sont responsables de 75% des créations d’emplois.
Trois chercheurs français (2) étudient le financement des petites et moyennes entreprises américaines et fournissent une description plus précise des formes que prennent ces entreprises dans la plus grande des économies mondiales. Nous allons voir que l’image que l’on se fait du capitalisme américain, fondée sur la séparation du pouvoir entre actionnaires et dirigeants et sur la prééminence des apporteurs de fonds externes, semble infondée en ce qui concerne les PME.
Les trois axes principaux autour desquels s’articulent cette étude sont i) la structure de financement ii) la détention du capital et iii) l’endettement d’un échantillon représentatif de PME. Les principaux résultats obtenus dans cette étude peuvent être résumés rapidement dans la mesure où les auteurs se contentent de dresser un panorama de la situation récente sur un échantillon représentatif de 729 entreprises américaines ayant entre 20 et 500 salariés. Leurs données sont récoltées sur la base d’une étude réalisée par la SBA en 1998.
Les PME américaines sont principalement familiales (à 70%) et financées pour moitié par capitaux propres, à hauteur de 30% par de la dette financière et pour le solde par des dettes d’exploitation. Cette structure de financement ne varie pas avec la taille des entreprises. Par contre, l’âge de l’entreprise vient sensiblement affecter cette structure de financement : les entreprises les plus jeunes sont moins capitalisées que les entreprises les plus vieilles (3). Plusieurs interprétations sont possibles. D’une part, les PME ont tendance à se désendetter au maximum, donc les entreprises les plus vieilles, qui ont aussi généré des cash flows depuis plus longtemps, vont être moins endettées. D’autre part, les entreprises les plus jeunes sont celles qui ont la plus forte croissance (ce que semble suggérer la taille de leur bilan) qu’elles doivent financer en recourant à de la dette. Ces interprétations sont cohérentes avec une préférence pour l’autofinancement de la part des PME.
Contrairement aux idées reçues, les PME américaines ayant réalisé des augmentations de capital ont, dans l’immense majorité des cas (93%), eu recours à l’apport des propriétaires/actionnaires en place. Le reste des apports est assuré par des business angels, mais jamais, dans cet échantillon, par des capitaux risqueurs ou les marchés financiers, ce qui indique le poids marginal de ces intermédiaires financiers à l’échelle de l’économie des PME de 20 à 500 salariés. Il semble donc que les PME américaines ne soient pas si différentes de leurs homologues européennes que ce que l’on pouvait imaginer.
En ce qui concerne l’endettement des PME américaines, là aussi, contrairement aux idées reçues, on constate que les financements désintermédiés (emprunts obligataires) jouent un rôle tout à fait négligeables. Dans cet échantillon, aucune entreprise n’y a recours. Pour l’essentiel, les PME américaines utilisent le crédit fournisseur et le crédit bancaire à travers les lignes de crédit en ne faisant appel qu’à une, voire deux institutions financières. Le relationnel bancaire joue ainsi un rôle prépondérant ainsi que le confirment les PME qui ont répondu aux questions de cette enquête. La relation à long terme entre une banque et une entreprise est importante dans la mesure où il existe un risque financier accru pour les PME, et une asymétrie d’information importante entre les apporteurs de fonds et les actionnaires/dirigeants, asymétrie qui peut être diminuée par le développement d’une telle relation sur la durée.
D’autre part, les PME américaines font appel aux crédits fournisseurs comme substitut à un emprunt bancaire, lorsqu’elles font face à un rationnement du crédit. En effet, si les entreprises ne paient pas leurs fournisseurs avec retard, cette forme de crédit représente un crédit gratuit. Par contre, en cas de retard, ce financement devient plus onéreux qu’un financement bancaire. Or les auteurs constatent que plus de la moitié des entreprises paient leurs fournisseurs avec retard, entraînant des charges financières très élevées (de l’ordre de 30% en taux annuel).
Il semble donc que l’image que l’on se fait des PME américaines, largement influencée par les « success stories » des petites PME en forte croissance devenues de grandes entreprises multinationales, n’est pas en accord avec les faits. Toutefois, cette étude, si elle dresse un portrait plus fidèle des PME américaines, ne permet pas aux chercheurs de mieux comprendre ce qui détermine les choix de financement de ces entreprises.
(2) Pascal Alphonse, Jacqueline Ducret et Eric Séverin « Le financement des petites et moyennes entreprises : une présentation du cas américain », Banque & Marchés, n°71, juillet-août 2004.
(3) 35% du passif pour les entreprises de moins de 2 ans et 54% pour les entreprises de plus de 20 ans.
Q&R : Comment reclasser un bloc d’actions d’une société cotée en bourse ?
Le vendeur peut alors demander à une (ou plusieurs) banque de placer ces actions. Deux solutions sont alors envisageables :
1/ “Book building” et “accelerated book building”
La cession d’un bloc sur le marché (block trade en anglais) est réalisée grâce à la constitution d’un livre d’ordres (1). Cependant, le block trade est une opération plus «simple» que l’augmentation de capital : elle nécessite un effort de communication moindre. La constitution du livre d’ordres est réalisée plus rapidement ; le management est nettement moins impliqué, voire pas du tout : en pratique, l’opération peut ne durer que quelques heures.
Lorsque les opérations sont plus importantes et impliquent une réorientation stratégique (sortie de l’actionnaire de contrôle, ...), un véritable effort de marketing peut s’avérer nécessaire impliquant le management.
2/ Prise ferme (Bought deal) et opérations avec back-stop
Lorsque le cédant s’engage dans une opération de book building ou d’accelerated book building, il n’a a priori aucune garantie que l’opération sera menée à son terme. De plus, il ignore le prix auquel il va céder son bloc. Pour remédier à cette situation, il peut demander à une banque d’acquérir les titres, charge à elle de les replacer auprès d’investisseurs : il s’agit de la technique de la prise ferme (bought deal en franglais).
La banque prend alors un risque important et n’acceptera théoriquement d’acheter les titres qu’avec une décote par rapport au cours de bourse.
Le bought deal offre l’avantage pour l’actionnaire cédant d’être certain de sa cession et du montant qu’il va obtenir au moment de prendre sa décision de vendre. Cependant, cette technique présente quelques inconvénients :
- le prix obtenu in fine fait apparaître une décote plus importante en moyenne que dans un accelerated book building,
- la performance du titre peut souffrir de l’opération. En effet, la banque qui a acquis des titres voudra s’en défaire aussi rapidement que possible, quitte à faire chuter le cours.
Le marché des blocs est devenu si compétitif pour les banques que les entreprises bénéficient maintenant du beurre et de l’argent du beurre : il y a constitution d’un livre d’ordres mais pour lesquelles le (ou les) établissement placeur garantit un prix minimum pour le placement (back stop). Si ce prix ne permet pas de céder l’intégralité des titres à l’issue de l’opération, la banque doit se substituer aux investisseurs manquants et donc acheter les titres à ce prix.
On peut constater que les banques sont de plus en plus agressives sur ce type d’opérations poursuivant plus un objectif de part de marché et de credentials (c’est à dire d’opérations de référence à présenter à leurs futurs clients) que de profitabilité. Ainsi le graphique ci-dessous (blocs de plus de 100 M€ placés depuis début 2003) fait apparaître que plus les blocs sont importants, plus la décote est faible, on se serait attendu à l’inverse !
On a pu observer des opérations de prise ferme par des banques à un cours supérieur au cours de référence ; l’opération fait alors apparaître une prime et non une décote. Cela a par exemple été le cas pour la cession du bloc d’actions Thomson par l’Etat français. Cette décision extrêmement risquée est prise par les banques interrogées après la fermeture des marchés, notamment en observant l’évolution du marché américain alors que les marché européens sont fermés du fait du décalage horaire.
Fin 2004, début 2005 un certain nombre d’opération d’envergure se sont soldées par des pertes importantes pour les grandes banques de la place : reclassement de titre TeliaSonera par l’Etat finnois, de titre Atos Origin par Philips...