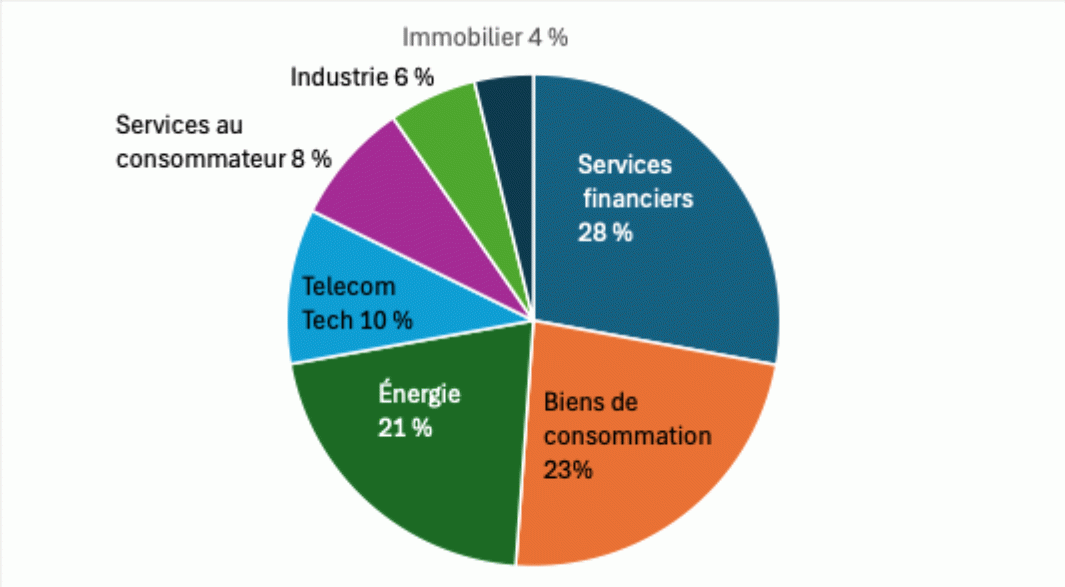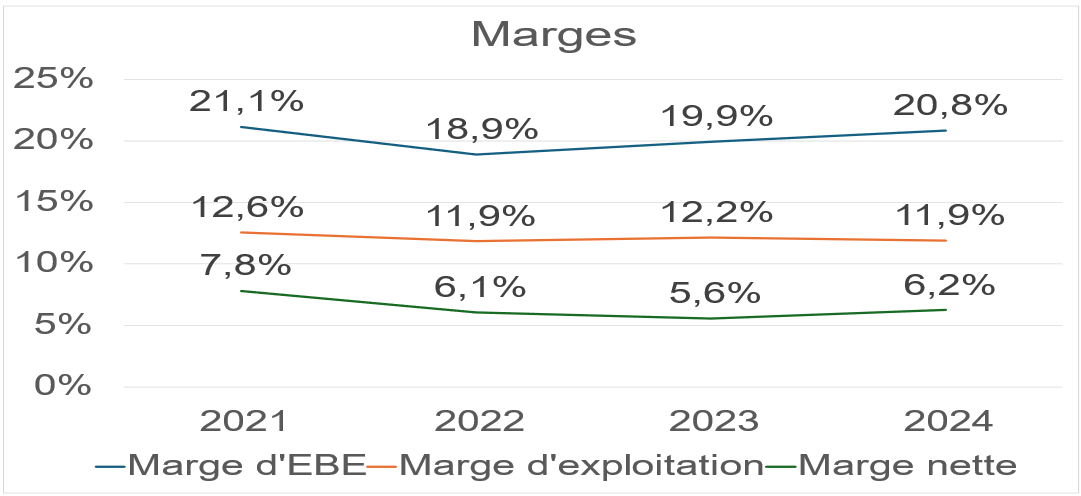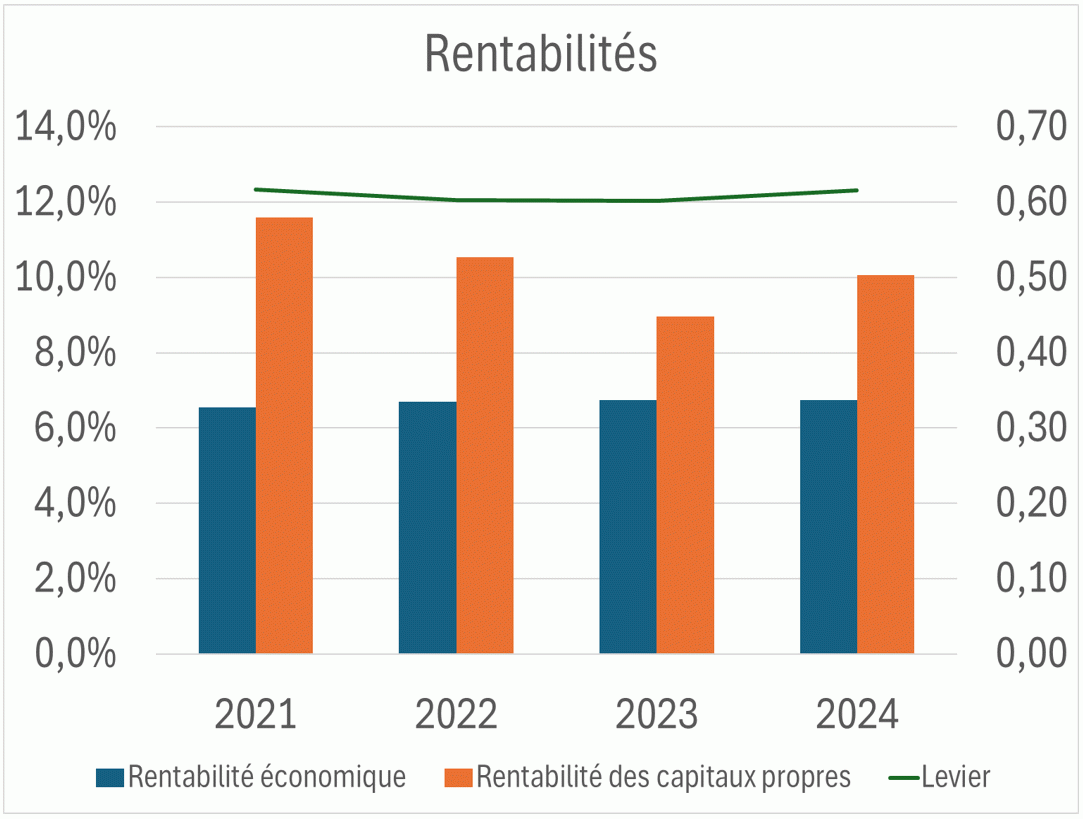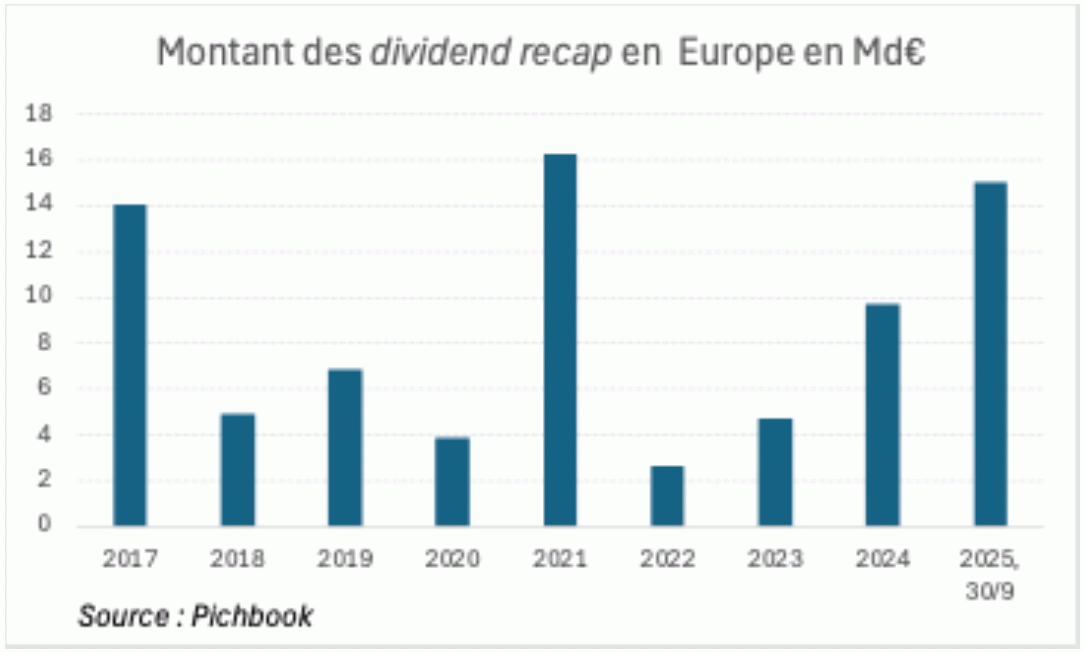La Lettre n°231 de Novembre 2025
Actualités : L'analyse financière des groupes espagnols cotés
Au 31 décembre 2024, les Bourses espagnoles (Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao) regroupaient 277 groupes cotés capitalisant 787 Md€, ainsi réparties sectoriellement :
Le degré de concentration est particulièrement fort avec les 3 premières capitalisations boursières qui font 39 % de la capitalisation boursière totale (Inditex, Iberdrola, Santander), chiffre qui passe à 52 % pour les 5 premières, à 69 % pour les 10 premières et à 83 % pour les 20 premières. Cette situation explique que les services financiers et les biens de consommation à eux seuls fassent plus de la moitié des secteurs représentés, en valeur, sur les bourses espagnoles.
Pour mener à bien notre analyse financière d’Espagne SA (nom que nous avons donné à l’agglomération des comptes des sociétés espagnoles cotées), nous avons retiré des 277 entreprises cotées celles des secteurs financier et immobilier, ainsi que celles pour lesquelles les informations financières étaient incomplètes pour les 4 années que nous passons en revue. Nous avons ainsi une centaine de sociétés représentant les 2/3 de la capitalisation boursière, et 89 % des capitalisations boursières hors les secteurs financier et immobilier.
Nous avons bien sûr suivi le plan type d’une analyse financière en 4 parties présenté dans le Vernimmen[1] : la création de richesse . . . nécessite des investissements. . . qui doivent être financés. . . et être suffisamment rentables.
La création de richesse…
La somme des chiffres d’affaires 2024 des groupes de l’échantillon est de 448 Md€ (à comparer à un PIB de 1 490 Md€). Tout comme pour les capitalisations boursières, les chiffres d’affaires sont très concentrés puisque les 10 plus grosses entreprises représentent 70 % du chiffre d’affaires total. Elles sont actives pour l’essentiel dans des secteurs traditionnels : le pétrole avec Repsol, les services publics, l’ingénierie et le BTP avec Iberdrola, ACS, Endesa, et Naturgy, la logistique (Logista), les télécoms (Telefonica, Cellnex), et le textile (Inditex, plus connu sous sa principale marque Zara).
La croissance sur la période 2020-2024, partant du point bas de 2020, est de 43 %, plus de deux fois supérieure à la croissance du PIB espagnol sur la période (20%). Cependant si la croissance a été très forte en 2021 et 2022 (17% et 25%), elle est devenue négative en 2023 (- 5 %) avant de se reprendre en 2024 (2 %). Le poids important de l’énergie dans l’économie espagnole explique une partie significative de ces variations :
Espagne SA (nom que nous avons donné à l’agrégation des entreprises…) affiche une marge d’EBE d’environ 20 % et une marge d’exploitation d’environ 12 %, toutes deux relativement stables sur la période :
Le taux d’impôt sur les sociétés, entre 26 % et 32 %, pour un taux standard de 25 % en Espagne n’a rien d’anormal.
La marge nette s’érode d’un point et demi sur la période sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt.
… nécessite des investissements ….
Espagne SA investit entre 2020 et 2024 156 Md€, soit 112 % des dotations aux amortissement, ce qui est cohérent avec le profil de croissance de l’activité.
Le besoin en fonds de roulement est négatif à - 10 jours de chiffre d’affaires. Ceci pourrait paraître étonnant, étant donné que la plupart des groupes constituant Espagne SA sont des groupes industriels. On retrouve en réalité ici le fait que les grandes entreprises ont un pouvoir de négociation très fort vis-à-vis de leurs clients et leurs fournisseurs, dont elles n’hésitent pas à user.
Ainsi, les clients paient en moyenne à 45 jours, alors que nous estimons que les fournisseurs sont payés en moyenne à au moins 60-70 jours[2]. Au point que le poste fournisseurs au bilan d’Espagne SA dépasse le poste clients chaque année (80 Md€ contre 66 Md€ en 2024), alors que naturellement Espagne SA facture plus à ses clients qu’elle n’est facturée par ses fournisseurs.
… qui doivent être financés….
Le BFR étant faiblement négatif, ses variations influent donc peu sur les flux de trésorerie d’exploitation qui dépassent largement, sur la période, les investissements, qui sont donc autofinancés.
Le surplus est versé en dividendes et rachats d’actions. Espagne SA verse ainsi environ 50 % de son résultat en dividendes, ce qui est cohérent avec la moyenne européenne et avec la dynamique de l’échantillon : sociétés dans des secteurs traditionnels en croissance raisonnable.
L’endettement bancaire et financier net croît légèrement entre 2021 et 2024 (de 153 Md€ à 171Md€). Mais le ratio endettement net / EBE décroît grâce à la croissance de l’EBE sur la période. À 1,8 en 2024, il n’a rien d’inquiétant, même si Espagne SA est légèrement plus endettée que ses pairs européens par rapport à l’EBE (1,5 x pour le S&P Europe 350) ou à la valeur des capitaux propres (32 % contre 15 %).
…. et être suffisamment rentables.
La rentabilité économique après impôt est à un niveau médiocre et stable de 2020 à 2024 à environ 6,5 %, alors que le coût du capital des grands groupes européens cotés est de l’ordre de 8 %.
Grâce à un effet de levier assez important (le levier est de 0,6), Espagne SA génère une rentabilité des capitaux propres moyenne marginalement supérieure à 10 % :
Mais les investisseurs en actions espagnoles ont globalement la foi chevillée au corps, puisqu’ils valorisent ces actions à quasiment deux fois le montant des capitaux propres comptables, anticipant donc que les rentabilités économiques, dans un avenir pas trop lointain, dépassent le coût moyen pondéré du capital.
Le multiple d’EBE est relativement modeste (7,5x) et stable reflétant le caractère traditionnel des sociétés constituant l’échantillon.
On terminera en notant que les effectifs d’Espagne SA se sont accrus sur la période de 87 000 emplois pour un total de 1,3 M personnes.
Pour conclure, l’analyse des principaux groupes espagnols non financiers cotés dresse le portrait d’un tissu économique concentré, solide, mais peu performant sur le plan de la rentabilité. Les cours actuels anticipent un redressement net sur ce point, dans une économie marquée par un poids fort des secteurs traditionnels.
[1] Au chapitre 9.
[2] Difficile d’être plus précis avec une présentation du compte de résultat par destination.
Tableau : Les dividend recap
Un dividend recap, abrégé de dividend recapitalisation, consiste pour une entreprise sous LBO, après plusieurs années de désendettement à verser un dividende à ses actionnaires financé par un nouvel endettement, s’ajoutant à l’endettement résiduel et qui représente, le plus souvent, un à deux fois l’EBE.
C’est un outil utilisé lorsque les conditions d’une sortie par cession ou introduction en Bourse ne sont pas réunies, ou à un prix jugé insuffisant par les dirigeants du fonds de LBO. Quitte à repartir pour plusieurs semestres de détention, et en attendant la liquidation du fonds, autant réendetter l’entreprise qui avait retrouvé une capacité d’endettement, afin de maximiser le TRI de l’investissement, mais aussi son risque cela va sans dire.
Ainsi Froneri dont nous avions parlé dans la rubrique commentaires de La Lettre Vernimmen d’octobre[1], a procédé à un dividend recap de 4,4 Md€, sous forme d’un dividende exceptionnel financé par une émission de dettes obligataires à haut rendement (4,75 % en € et 6 % en $ à échéance 2032). Cette opération ne contribue pas peu au montant de cette année qui a toutes ses chances de s’inscrire à un nouveau plus haut tant au niveau européen comme dans le graphique ci-après :
qu’au niveau mondial. On l’aura compris, un tel record n’est que le reflet de la situation actuelle d’encalminage des fonds de LBO à laquelle nous avons consacré l’avant-propos du Vernimmen 2026.
Recherche : IPOs : au-delà des idées reçues, un effet positif sur la rentabilité
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
L’effet mesuré des introductions en bourse (IPOs) sur la rentabilité économique des entreprises est généralement négatif dans la littérature existante. De nombreuses études, notamment dans les années 1990[1], arrivent à ce constat, et les mesures plus récentes ne l’ont guère contredit. L’interprétation courante est que le coût total de l’introduction en bourse, souvent estimé à environ 5 %[2] de la valeur des capitaux propres, dépasserait les bénéfices tirés de l’opération. L’article que nous présentons[3] remet en cause cette lecture. Il exploite des données européennes comprenant à la fois des IPOs menées à terme et des IPOs abandonnées. Une fois les caractéristiques des entreprises prises en compte, le fait de finaliser une IPO apparaît associé à une amélioration de la rentabilité économique.
L’article s’intéresse à l’effet de l’IPO sur la rentabilité comptable des entreprises. L’indicateur retenu est l’OROA (Operating Return On Assets), défini comme le résultat opérationnel avant impôts divisé par le total du bilan. Les praticiens pourront être surpris de cet indicateur que personne n’utilise de ce côté-ci de l’Atlantique ; avouons que sur ce point les académiques ont un sérieux train de retard.
L’intuition des auteurs vient du constat suivant : non seulement les entreprises introduites voient leur rentabilité baisser dans les deux années qui suivent l’opération, mais celles dont l’IPO a été abandonnée connaissent la même tendance. La baisse de rentabilité fréquemment observée n’est donc pas la conséquence de l’IPO elle-même, mais reflète probablement un biais de sélection lié aux entreprises qui choisissent de se lancer dans le processus. L’article ne cherche pas à en identifier précisément l’origine, mais une hypothèse plausible est que les dirigeants engagent une IPO lorsque, anticipant un affaiblissement futur de la rentabilité, ils craignent que la fenêtre de marché ne se referme.
L’échantillon comprend 3 467 tentatives d’IPO (dont 430 abandons) en Europe entre 1997 et 2017, dans 16 pays, dont le Royaume-Uni et la Norvège. Les auteurs ne se contentent pas de comparer directement IPOs finalisées et abandonnées. Pour neutraliser les effets de sélection, ils utilisent une variable extérieure aux entreprises mais influençant la probabilité de finalisation : la performance du marché boursier dans les 30 jours qui précèdent la date prévue d’introduction. Lorsque cette performance est positive, la probabilité de mener l’opération à terme augmente sensiblement (7 points de pourcentage, sur un taux de réussite moyen de 87%). En s’appuyant sur cette variation exogène et sur les caractéristiques propres aux entreprises, il est possible d’isoler la part de l’évolution de rentabilité réellement imputable à la finalisation de l’IPO.
Le résultat principal est le suivant : les entreprises dont l’IPO est menée à terme présentent, dans les deux années qui suivent, une rentabilité économique sensiblement supérieure à celle des entreprises qui ont abandonné leur introduction. L’écart estimé atteint environ 23 points de pourcentage. Ce chiffre peut paraître très élevé, mais il doit être interprété avec prudence. L’OROA est extrêmement volatil dans cet échantillon composé majoritairement de petites entreprises en forte croissance, et l’écart mesuré reflète la divergence entre deux trajectoires opposées : hausse relative pour les IPO finalisées et baisse marquée pour celles qui échouent. Finalement, pour les entreprises engagées dans une IPO, la réalisation de l’opération s’accompagne d’une rentabilité plus élevée, en dépit des idées reçues.
Les auteurs s’intéressent ensuite aux facteurs expliquant cet écart. Une première explication renvoie à la protection des actionnaires minoritaires. L’admission en bourse impose des règles plus strictes en matière de gouvernance, ce qui peut limiter l’extraction de bénéfices privés par les actionnaires majoritaires et améliorer la rentabilité mesurée. Dans l’échantillon, l’effet positif est effectivement plus marqué au Royaume-Uni, pays où cette protection est réputée plus forte.
Une autre explication tient à l’allègement des contraintes de financement. Deux effets opposés peuvent théoriquement se produire : financer davantage de projets, y compris ceux au rendement plus faible, peut réduire la rentabilité comptable moyenne ; mais l’accès à des ressources plus importantes permet aussi d’engager des projets très rentables mais jusqu’ici hors de portée. Les données suggèrent que c’est ce dernier effet qui domine : après l’IPO, les entreprises ouvrent davantage de filiales et se développent plus à l’international.
Enfin, les auteurs constatent que l’IPO s’accompagne souvent d’une réorientation stratégique : moindre investissement en recherche fondamentale, davantage de dépenses commerciales, et un turnover accru des dirigeants, notamment des directeurs généraux et financiers.
Par un traitement rigoureux de leur échantillon, les auteurs montrent que l’IPO est en réalité favorable à la rentabilité économique des entreprises concernées. Ils réhabilitent en quelque sorte les introductions en bourse, tant pour l’allègement des contraintes financières de l’entreprise que pour la discipline qu’elles imposent aux majoritaires.
[1] Par exemple B.JAIN et O.KINI (1994), The post-issue operating performance of IPO firms, Journal of Finance, vol.49, pages 1699 à 1726
[2] C’est le résultat trouvé dans l’article sur les SPACs que nous avons présenté dans la Lettre Vernimmen n°215
[3] B.LARRAIN; G.M. PHILLIPS, G.SERTSIOS et F.URZUA (2025), The Effects of Going Public on Firm Profitability and Strategy, Review of Financial Studies, vol.38-8, pages 2467 à 2514
Q&R : Qu'est-ce qu'un coop agreement ?
C‘est l’abrégé de cooperation agreement qui, dans le contexte d’une restructuration d’une entreprise surendettée, voit des détenteurs de dettes obligataires ou bancaires signer un accord par lequel ils s’engagent à ne pas accepter individuellement une proposition de restructuration de la dette par l’entreprise endettée (ou ses actionnaires) si les autres signataires de ce coop agreement n’en bénéficient pas aussi pari passu.
Si ces accords entre créanciers ont une portée défensive pour protéger leurs membres de discriminations dans la restructuration du passif, ils peuvent aussi avoir une portée offensive. En effet les membres peuvent tenter de négocier un accord de restructuration qui leur bénéficiera plus qu’à d’autres créanciers. Comme quoi la crainte de subir de mauvais traitements n’inhibe pas certains, prêts à les appliquer à d’autres, au moins au pays du Far West qui les a vus naître.
Ce qui fait qu’il y a souvent trois niveaux de créanciers en présence d’un coop agreement : ceux qui l’ont signé au départ, ceux qui l’ont rejoint ultérieurement, et puis ceux qui n’en font pas partie. Trois niveaux avec des taux de perte de valeur croissant sur les créances en cas d’accord obtenu entre l’emprunteur et le coop agreement. Il est en effet clair qu’une fois que les membres initiaux d’un coop agreement ont réussi à réunir entre eux une majorité de la dette, leur incitation à accueillir dans leur groupe des créanciers supplémentaires décroît rapidement.
L’intérêt des créanciers de structurer ou de rejoindre uncoop agreement est d’autant plus fort qu’il n’y a pas d’obligation pour l’un de ses membres de participer à une restructuration, si l’accord obtenu par le coop agreement ne lui convient pas.
En réaction à cette évolution, les contrats de dettes essaient d’introduire des clauses interdisant aux prêteurs de former ou rejoindre un coop agreement.
Aux États-Unis, Optimum Communications, l’ex Altice USA, 26 Md$ de dettes nominales et 1 Md$ de capitalisation boursière, fait en ce moment un procès à ses prêteurs, dont la plus grande part a formé un coop agreement, les accusant de former un cartel illégal, l’empêchant de négocier des échanges de dettes ou des refinancements avec certains seulement de ses prêteurs. Il est vrai que Patrick Drahi n’a jamais eu froid aux yeux, et que la restructuration de la dette d’Altice France a donné lieu à la création d’un des premiers coop agreements français.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. Aucun de nous deux n’est actionnaire des sociétés mentionnées. Voici nos derniers billets.
Quand la cour administrative d’appel donne des cours de finance à l’administration fiscale : 1er épisode (18 octobre)
Pour justifier un redressement d’environ 300 M€ à la SEITA, l’administration fiscale avait calculé un coût du capital en retenant une moyenne à deux ans des taux d’intérêt sans risque, et une prime de risque historique calculée sur une moyenne 1987-2012.
En première instance, le tribunal lui avait donné raison. Mais en appel, SEITA a obtenu gain de cause.
En effet la cour administrative d’appel de Paris, qui avait lu son Vernimmen, a rappelé que dans la formule du MEDAF permettant d’estimer le coût des capitaux propres d’une entreprise, ou son coût du capital, il fallait être cohérent.
La formule pose que le taux de rentabilité exigé est égal à : rf + ß x (E(rm) – rf). On ajoute ainsi au taux de l’argent sans risque (rf) une prime de risque (E(rm) – rf), pondérée par le béta de l’action pour déterminer le coût des capitaux propres, ou par le béta de l’actif économique (béta déléveragé en franglais) pour obtenir le coût du capital dans l’approche directe. Il va sans dire que le rf du début de la formule est le même que le rf à la fin de la formule dans la prime de risque du marché action !
Toutefois, il y a toutes les chances que l’on retienne deux valeurs différentes pour le même rf dans la formule, si l’on prend pour taux de l’argent sans risque une moyenne de taux d’intérêt sur deux ans,
et que la prime de risque retenue est calculée comme une moyenne des primes de risque du marché action sur 25 ans. Ce qui est fâcheux ; mais qui au cas particulier permettait à l’administration fiscale de retenir un taux d’actualisation plus faible que celui utilisé par la SEITA, aboutissant donc à une valeur de l’actif plus forte que celle retenue par la SEITA, d’où le redressement notifié.
C’est bien pour cela que depuis des années, la quasi-totalité des évaluateurs raisonnent avec des primes de risques prospectives, et non des primes de risques historiques calculées sur des périodes plus ou moins longues. La prime de risque prospective correspond à la prime observée sur la base des cours actuels et des perspectives futures de flux de trésorerie des actifs.
Si la prime de risque est très souvent mentionnée, l’espérance de rentabilité du marché (le E(rm) dans la formule) est en fait un critère plus opérationnel en matière d’évaluation. En effet, il permet de calculer la prime de risque avec :
- soit un taux de l’argent sans risque à court terme comme cela est notre préconisation,
- soit avec un taux à long terme (OAT à 10 ans), comme l’habitude a pu en être prise, mais à tort. En effet les variations de cours d’une OAT à long terme montrent bien que celle-ci n’est pas sans risque, ce qui est fâcheux pour un taux sans risque ! Et c’est pourtant ce qui est requis pour aboutir à la formule du MEDAF (l’écart-type des rentabilités de l’actif sans risque doit être nul).
On s’affranchit ainsi du choix fait en ce domaine par celui qui a calculé et publié la prime de risque, et on évite l’erreur que la cour a reproché à l’administration fiscale.
Quand la cour administrative d’appel donne des cours de finance à l’administration fiscale : épisode 2 (25 octobre)
Dans le billet précédent, on a vu comment la cour administrative d’appel de Paris a corrigé l’administration fiscale qui prétendait, pour calculer le coût du capital d’une entreprise, utiliser un taux de l’argent sans risque calculé sur 2 ans et une prime de risque historique calculée sur 25 ans.
1. L’administration fiscale, pour justifier son recours à une prime historique, avait argué que cette dernière était pertinente puisque Imperial Brands Seita était un actionnaire de long terme ; alors que si elle avait été un actionnaire de court terme, une prime prospective aurait été pertinente.
Le rapporteur ne s’est pas laissé démonter par cet argument spécieux et sui generis à l’administration fiscale, contraire à ce que le Guide de l’évaluation de l’administration fiscale indique : « En tout état de cause, il n’existe pas de valeur fiscale ni de méthodes administratives d’évaluation sui generis : la valeur de marché ne peut être dégagée que par l’observation de ce dernier et en recourant aux méthodes utilisées par ses acteurs. ».
Le rapporteur a en effet souligné : « Si j’achète du LVMH pour abonder un PEA en vue de financer ma retraite dans 20 ans, ou si je l’achète pour boursicoter dans l’espoir de me payer à court terme un voyage en Namibie, le prix du titre sera exactement le même. » C’est frappé au coin du bon sens.
Et pour achever de disqualifier la prime de risque historique, le rapporteur reprend un des arguments du Vernimmen. Lorsque les marchés baissent parce que les investisseurs exigent des taux de rentabilité plus élevés, la prime de risque historique, moyenne des rentabilités annuelles du marchés en surplus du taux sans risque, baisse de ce fait, alors même que les taux de rentabilité demandés par les investisseurs s’élèvent, ce qui est paradoxal.
2. Sur un autre point, l’administration fiscale avait considéré que toute la trésorerie active devait être prise en compte dans le passage de la valeur de l’actif économique à celle des capitaux propres. Ce que SEITA a contesté puisqu’une partie de cette trésorerie est le fruit de droits d’accise (la SEITA fabrique des cigarettes) qu’elle doit reverser à … l’administration fiscale.
Le rapporteur a donné raison à la SEITA, car la contrepartie en trésorerie d’un BFR négatif n’est pas automatiquement un actif permanent de l’entreprise, et donc un élément de sa valeur (cf. la Lettre Vernimmen de septembre dernier). On imagine d’ailleurs comme aurait réagi l’administration fiscale si la SEITA lui avait dit ne pas pouvoir lui reverser les droits d’accise collectés, les ayant utilisés, par exemple, pour verser un dividende à son actionnaire !
3. Comme la SEITA avait probablement versé le montant du redressement, l’État lui remboursera la somme majorée d’intérêts qui creuseront d’autant le déficit budgétaire. Il est des cas où l’administration fiscale devrait solliciter l’avis d’experts en évaluation avant de se lancer dans des procédures dont les fondements s’avèrent hasardeux.
Eiffage absorbera-t-il Getlink ? (1er novembre)
Eiffage, groupe de BTP et de concessions, monte régulièrement au capital de Getlink qui opère le tunnel sous la Manche. La semaine dernière, l’acquisition d’un quatrième bloc depuis 2018 a porté sa participation à 29,9 % des droits de vote et à 27,7 % du capital.
Les règles d’OPA font que si Eiffage détenait plus de 30 % des droits de vote ou du capital de Getlink, il devrait lancer une OPA obligatoire.
À l’occasion de ce dernier achat (7,1% du capital pour 692M€), Eiffage a précisé qu’il : « envisage de renforcer sa participation en fonction des conditions de marché mais n’envisage pas de déposer d’offre publique sur le solde du capital. ». Cette déclaration lie Eiffage pour 6 mois, après lesquels il sera libre de lancer une offre sur Getlink s’il le souhaite.
La structure du groupe Eiffage laisse penser qu’il le fera à un moment donné et qu’il ne se contentera pas d’une position minoritaire à 29,9 %.
44 % de l’EBE du groupe Eiffage (5 Md€ en 2025) provient de sa filiale Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) dont la concession s’achève fin 2035. Au-delà, l’État pourra reprendre en direct l’exploitation comme avant 2006, ou accorder une nouvelle concession dans des conditions nécessairement moins favorables qu’en 2006. À l’horizon 10 ans, Eiffage est donc quasi certain de perdre cette source de résultats, ou de la voir se tarir très significativement.
Le cash-flow généré actuellement par APRR sert en partie à renforcer les autres activités d’Eiffage, afin d’avoir de nouvelles sources de revenus pour remplacer celles d’APRR après 2035. Il a ainsi couvert les 2,5 Md€ investis depuis 2018 dans Getlink qui présente un grand avantage par rapport à APRR : sa concession court jusqu’en 2085.
Toutefois cet avantage n’est pas sans inconvénient. Avoir 25 % de sa capitalisation boursière (de 10,5 Md€) bloqué dans une affaire que l’on ne contrôle pas, et qui représente environ la même taille que soi, est une situation peu banale pour un groupe coté, et historiquement transitoire.
En effet, les investisseurs intéressés à une exposition au trafic transmanche préfèrent investir dans Getlink directement, plutôt que dans un Eiffage détenteur de 30% de Getlink mais aussi d’autres actifs ; sauf si la décote sur la valorisation d’Eiffage est suffisamment importante pour les tenter (elle est actuellement de 30 % sur la somme des parties, contre 20 % pour Vinci). Une fois Getlink filiale à 100%, l’investisseur devra acquérir des actions Eiffage pour être exposé à Getlink, ce qui sera probablement un facteur de réduction de la décote.
Si le rapprochement prenait la forme d’une OPE ou d’une fusion, Eiffage gagnerait probablement son ticket d’entrée au CAC40 avec un flottant de plus de 14 Md€, soit plus que les capitalisations boursières des 8 derniers du CAC40. Mais la part des salariés, premier actionnaire d’Eiffage qui ont historiquement protégé le groupe contre un raid hostile, chuterait de 20% à 12%. L’ajout d’une branche cash à une OPE limiterait cette dilution du contrôle.
Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ; ou les dividendes de Telefónica et Ayvens (8 novembre)
Telefónica, l’opérateur téléphonique qui capitalise en Bourse 21 Md€ pour 41 Md€ de ventes, a annoncé le 3 novembre une division par deux de son dividende. Son cours de Bourse à vendredi soir est en retrait de 16 %.
À l’instar de l’idiot qui regarde le doigt quand le sage montre la lune, le naïf pourra croire que la baisse du cours de Telefónica est due à cette division par deux du dividende. C’est ne voir que la conséquence et non la cause. La cause première du recul du cours de Telefónica est la révision en forte baisse, lors de cette annonce, du flux de trésorerie disponible pour 2026 de 3 Md€ à un peu moins de 2 Md€.
Or la valeur d’une action résulte de l’actualisation des flux de trésorerie qu’elle génère. Moins de flux de trésorerie disponible, moins de valeur. D’où la baisse du cours.
Moins de flux de trésorerie disponible veut nécessairement dire, à dividendes constants, une moindre capacité à rembourser les dettes. Or quand vous avez 30 Md€ de dettes bancaires et financières nettes comme Telefónica, et que vous distribuez 1,9 Md€ de dividendes par an sur un flux de trésorerie disponible de 3 Md€, vous peinez à payer vos frais financiers avec le solde.
Inévitablement, si votre flux de trésorerie disponible est réduit d’un tiers, le dividende doit être coupé pour pourvoir payer les frais financiers autrement qu’en s’endettant à cet effet. Le nouveau dirigeant de Telefónica l’a parfaitement compris ; et il ne faut pas s’en étonner. Il fut dans une vie antérieure professeur de finance.
* * *
A contrario de la situation de Telefónica, Ayvens annonce deux jours avant un dividende exceptionnel de 340 M€ et un rachat d’actions de 360 M€. En 5 jours, son cours bondit de près de 9 %. Le versement de dividende/rachat d’actions permettrait-il donc de faire monter la valeur des capitaux propres ? Oui dira l’idiot qui regarde le doigt sans voir la lune.
Le sage lui rappellera que, si Ayvens est un groupe de location longue durée d’automobiles et de gestion de flotte capitalisant 9 Md€, c’est aussi une compagnie financière holding réglementée par la BCE. Ayvens est donc soumis à des contraintes de ratios prudentiels comme une banque. Ainsi son ratio CET1 (le ratio de ses capitaux propres sur ses engagements moyens pondérés), doit être au moins égal à 9,36 %. Pour se laisser de la marge, Ayvens s’est fixé un ratio cible de 12 %. Fin septembre 2025, ce dernier était de 13,5 %. Avec la restitution aux actionnaires de 700 M€, le ratio CET1 de Ayvens sera toujours au-dessus de l’objectif à 12,8 %.
Deux raisons principales expliquent donc la hausse du cours d’Ayvens :
1. Les résultats des 9 premiers mois de 2025 sont supérieurs aux attentes ;
2. Thésauriser des capitaux propres au-delà de ce qui est raisonnablement requis conduit à une destruction de valeur, car ces capitaux propres excédentaires sont placés sur le marché monétaire et rapportent nettement moins (2 %) que ce qui est requis par les actionnaires (de l’ordre de 8 à 9 %). De ce simple fait, ils sont valorisés avec une substantielle décote. Dès lors qu’ils leur sont rendus, la décote disparait, ce qui fait bondir le cours.