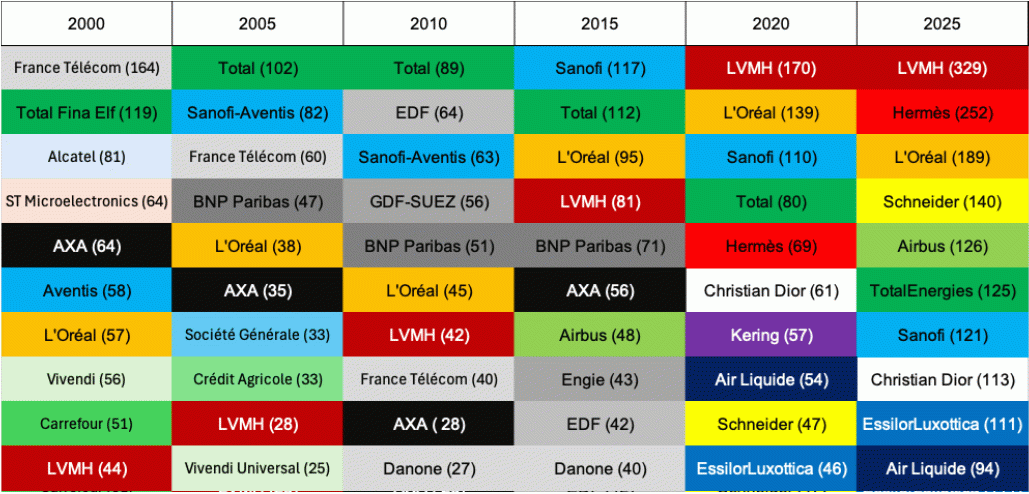La Lettre n°229 de Septembre 2025
Actualités : Le Vernimmen 2026 est disponible
Comme chaque année le Vernimmen s'ouvre par un texte introductif d’actualité, intitulé : Les fonds de LBO immobilisés par la hausse des taux d’intérêt ou par leur propre dynamique ?, où nous analysons les raisons de l’encalminage des fonds de LBO dont les levées sont au plus bas depuis 10 ans ; avec des investisseurs institutionnels qui ne sont prêts à investir dans de nouveaux fonds de LBO que le tiers des sommes que leurs promoteurs espèrent.
Nous vous laissons découvrir ce texte.
Naturellement, nous avons fait notre travail habituel de mise à jour pour vous offrir un outil de travail au quotidien aussi précis, fiable et exhaustif et pertinent que possible, intégrant :
- les nouvelles dispositions financières (covenant ESG des prêts bancaires par exemple), boursières, juridiques, comptables (loi omnibus) et fiscales (taxe sur les rachats d’actions, et contribution exceptionnelle à l’IS) ;
- l'ensemble des statistiques et graphiques actualisés présentant les données les plus récentes à juin 2025 (plus de 100 tableaux et graphiques) ;
- les derniers travaux de recherche ayant des applications pratiques comme la prime carbone.
Cette année, nous avons complété les développements consacrés aux captives d’assurance et de réassurance, aux augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, aux fonds de dettes, etc., tout en élaguant ce qui devait l’être afin que le Vernimmen ne prenne pas de la graisse !
Comme tout classique, le Vernimmen vous offre des socles de savoir forgés par la pratique et enrichis par des réflexions conceptuelles, lesquelles ne vous laissent jamais désarmés face à un problème ou une situation financière :
- le plan type d'une analyse financière et d'une analyse boursière ;
- les outils de mesure de la création de valeur ;
- les techniques de placements des actions, des obligations, des crédits syndiqués ;
- etc.
Pour vous aider à mieux utiliser « votre Vernimmen », chaque chapitre se clôt par un résumé, des exercices (187 en tout) et des questions corrigées (819).
Nous avons utilisé le rabat de couverture pour présenter dans un lexique français-anglais-américain les principaux termes de la finance, ainsi qu'une antisèche (« le Vernimmen » résumé en une page !).
Tant en annexe que dans le corps du texte, de très nombreux graphiques et tableaux vous donnent des éléments de référence et de comparaison, ainsi les principaux paramètres financiers des 20 premières capitalisations boursières des 14 principaux pays ou zones géographiques. Afin de vous aider à aller au-delà, si besoin, chaque chapitre est doté d'une bibliographie avec des conseils d'orientation vers des papiers de recherche fondamentale ou des articles de presse ou des livres. Enfin, l'index comprend près de 2 000 entrées.
Tant la version en ligne que la version iPad du Vernimmen vous offrent en plus :
- les podcasts de nos cours à HEC Paris (sur le LBO, les fusions-acquisitions, l'augmentation de capital, la structuration de la dette, etc.) ;
- la totalité (pour la version en ligne) ou la quasi totalité (pour la version iPad) des archives de la Lettre Vernimmen depuis son premier numéro de juin 2001 (soit 1800 pages environ),
- un glossaire de plus de 2 800 termes de la finance,
- les deux chapitres bonus consacrés à l'histoire de l'analyse financière et à la micro-économie financière.
Si vous disposez d'un iPad et souhaitez y intégrer le Vernimmen 2026 enrichi, cliquez ici.
Pour vous procurer l'édition papier du Vernimmen 2026, cliquez ici.
Naturellement les abonnés à la version électronique en ligne du Vernimmen (www.vernimmenenligne.net) disposent de la nouvelle édition 2026 depuis la mi-août. Si vous souhaitez les rejoindre, cliquez ici.
Pour écouter les auteurs présenter le Vernimmen, c'est ici.
Et voici comment les lecteurs du Vernimmen l’ont défini lors d’un sondage mené auprès de 200 d’entre eux en février 2025 :
Nous vous souhaitons autant de plaisir à utiliser votre nouveau Vernimmen 2026 que nous en avons eu durant ces 700 heures nécessaires pour le créer !
Actualités : Comment un directeur financier juge-t-il la dette publique
Par François Meunier
Ancien dirigeant d'une compagnie d'assurance, professeur affilié à ENSAE-IPP.
Les questions que rencontre le directeur financier sont-elles de même ordre que celles que connait son quasi-confrère, le ministre des Finances ? Beaucoup disent non, avec l’argument que l’État n’est pas une entité comme une entreprise. En particulier, un État, en principe, ne meurt jamais, ce qui change le regard des prêteurs à son endroit.
Mais le parallèle mérite d’être examiné. Pour cela, faisons du directeur financier une sorte de Candide portant son regard sur le financement de l’État.
Classiquement, le directeur financier a trois soucis : la rentabilité de l’entreprise, sa solvabilité et sa liquidité. L’entreprise est dite solvable si la valeur financière de ses actifs permet en toute circonstance le remboursement de la dette à sa valeur de marché. C’est une notion qui dépend en partie de la rentabilité. En effet, la valeur des actifs n’est autre que la valeur actualisée de ce qu’ils vont rapporter en flux de caisse dans le futur. Il suffit donc que le rendement des actifs reste supérieur au coût de la dette pour que l’entreprise dispose d’une solvabilité assurée et même d’une marge pour s’endetter.
Notre Candide peut donc en toute sagesse énoncer une première règle commune à la finance d’entreprise et aux finances publiques : si le rendement des dépenses publiques reste supérieur au coût de la dette, l’État ne connaît jamais de problème d’endettement. Pour le dire autrement, les problèmes d’endettement excessifs sont toujours et partout, pour l’entreprise comme pour l’État, des problèmes de dépenses inappropriées, disons non « rentables » pour prendre un vocabulaire financier.
Le « rendement » de la dépense publique est non marchand
Car bien sûr, les choses se compliquent. Le rendement de la dépense publique n’est pas pécuniaire, du moins immédiatement, il est en grande partie social. On saura peut-être mesurer la rentabilité d’un pont ou d’une voie ferrée, et beaucoup de gens disent que l’État ne devrait financer par dette que des dépenses d’infrastructure. Mais c’est plus difficile voire impossible pour l’éducation des jeunes, la sécurité publique ou pour une justice efficace, autant de dépenses qui participent aussi de ce rendement, quel que soit leur mode de financement.
À ce titre, le directeur financier est dans une position plus commode que son confrère ministre des finances. L’entreprise évolue dans un univers de marché, avec des prix, des coûts et des résultats mesurables en monnaie. La décision de dépense publique s’appuie rarement sur le calcul financier, elle est de l’ordre du politique. C’est pour cela qu’il faut des institutions et des principes d’évaluation qui permettent au corps politique de juger de l’opportunité de la dépense, avant et après cette dépense. De telles institutions sont à l’évidence en défaut en France.
Pour autant, ce serait une illusion de penser que le calcul financier est le seul critère d’investissement au sein d’une entreprise. Tout projet risqué requiert de la politique, si possible dans le bon sens du mot, à savoir d’arbitrages raisonnés entre des intérêts pas toujours convergents.
Quoi qu’il en soit, notre Candide peut formuler un premier diagnostic sur la situation budgétaire de la France : notre pays a accumulé tant et plus de dettes parce que les choix faits sur la durée en matière de dépenses publiques n’ont pas été les bons en moyenne. Ils ne se sont pas traduits par une hausse du revenu national, c’est-à-dire de la croissance, permettant de contenir le niveau de dette par rapport au PIB. Si l’on prétend résoudre chaque problème que rencontre le pays en recourant à la dépense publique, il est probable, faute de réflexion sur le retour de la somme engagée, que les nouvelles dépenses ne seront pas de bonnes dépenses, au sens d’être capables de rendre à la collectivité les fonds qui y sont mis. En France, ce n’est pas qu’on s’endette trop, c’est qu’on dépense mal.
On a parlé de solvabilité alors qu’on entend souvent en matière de finances publiques le terme de soutenabilité. Les notions sont très proches. Solvable pour l’État signifie que son potentiel de collecte d’impôts lui permettra toujours de rembourser la dette. C’est le cas si les dépenses publiques « rapportent » plus que le coût de la dette, car alors l’État pourra toujours « rouler » sa dette, c’est-à-dire rembourser la dette présente par des levées de dette futures. Dit en jargon technique, la dette est soutenable si le coût de la dette r reste inférieur à la croissance g de l’économie et donc, approximativement, à la croissance des recettes fiscales : r < g. Avec un aménagement, cette règle vaut tout autant pour une entreprise.
L’État n’a pas d’actionnaires
Le directeur financier s’astreint pour sa part à une discipline plus sévère que son collègue des Finances. Rentable pour lui cela ne veut pas dire avoir un rendement des actifs supérieur au seul coût de la dette, mais supérieur au coût total du capital, dette et capitaux propres. Car il faut rémunérer aussi l’actionnaire et celui-ci, prise de risque oblige, est payé plus cher pour son apport de fonds. À défaut, il sera réticent à financer l’investissement et préférera qu’on lui retourne l’argent sous forme de dividendes ou de rachat d’actions[1].
La vision de la solvabilité devient donc plus restrictive : l’entreprise est solvable si, en cas de mauvais coup ou de mauvaise conjoncture, elle reste capable de lever des fonds auprès d’actionnaires convaincus que l’entreprise est saine et donc leur placement rentable.
L’État pour sa part n’a pas d’actionnaires au sens propre, si ce n’est peut-être, en étirant le sens des mots, les citoyens qui le contrôlent. Sans actionnaires ni capitaux propres à rémunérer, la barre pour lui en matière de rentabilité, c’est le seul taux d'intérêt de la dette. C’est pour cette raison que le taux d'actualisation qu’il utilise pour ses calculs d’opportunité de certains projets publics est aujourd’hui en France de 3,2%[2], bien inférieur au coût du capital sur les marchés financiers.
Mais la différence est moindre qu’il n’y paraît. Le directeur général de l’entreprise préfère envoyer son directeur financier négocier un financement supplémentaire auprès d’une banque plutôt que d’avoir à plaider une augmentation de capital devant une assemblée d’actionnaires. Pareillement, un gouvernement n’aime jamais trop pour sa popularité recourir à l’impôt pour boucler son budget. S’il reste une différence, c’est qu’un actionnaire peut refuser d’apporter ses fonds, tandis que le contribuable ne le peut pas si ce n’est par révolte fiscale dont l’histoire laisse de nombreux témoignages, ou plus sagement par le droit de vote dont il dispose à l’égal de l’actionnaire.
De là, le dilemme des finances publiques : il est très facile de lever de la dette publique tant que la solvabilité n’est pas menacée et l’on a vu qu’il est difficile de la mesurer. Cette facilité à la dette devient une faiblesse : sans véritable contrainte de financement, on se laisse aller à mal dépenser. Se financer par impôt pour l’État ou par levée de capital pour l’entreprise impose une discipline plus forte dans l’usage des fonds.
Et bien sûr le recours à la dette n’est pas sans limites. Si les marchés financiers s’aperçoivent qu’il n’y a plus de marge de manœuvre en matière de levée d’impôt, ils commenceront à exiger une rémunération plus élevée pour prêter. Puis, plus du tout ensuite. L’État se trouve alors en crise de trésorerie. Comment paie-t-il ses dépenses ?
Une moindre contrainte de liquidité
Cela nous conduit à la troisième préoccupation du directeur financier, s’assurer de disposer d’une bonne liquidité, c’est-à-dire d’une capacité toujours présente d’honorer les engagements de paiements qui se présentent.
Si l’entreprise est solvable, une tension de liquidité n’est pas vraiment un problème car elle trouvera toujours la ligne de liquidité qui lui fait passer le cap[3]. Mais si la solvabilité est menacée, l’État et l’entreprise ne sont plus à égalité. On a déjà vu que le gouvernement, par l’impôt, peut prendre ses risques et forcer ses « actionnaires » à remettre au pot. Mais surtout, l’État bénéficie d’un prêt en dernier ressort qui manque à l’entreprise. Il suffit pour cela qu’il contrôle, en tant que souverain, l’émission d’une autre classe de dette, de préférence une dette qui ne porte pas intérêt et qu’on ne peut refuser de lui prêter. Cette dette porte un nom, c’est la monnaie, qu’il obtient en se tournant vers sa banque centrale.
Celle-ci est indépendante par convention institutionnelle et répugne à financer monétairement le Trésor public. Gardienne de l’inflation, elle sait le lien entre un excès de monnaie en circulation et l’inflation, même si ce lien est loin d’être mécanique. Mais l’histoire montre qu’en cas de crise de financement de l’État, il est rare qu’elle ne vienne pas à son secours.
L’inflation n’est rien d’autre qu’un défaut, financièrement : 10% d’inflation pendant trois ans, cela rogne le pouvoir d’achat des créances sur l’État de 30%. C’est comme si les créanciers avaient dû subir une décote, un haircut, de 30% lors d’une restructuration. Évidemment, l’inflation permet que cette décote soit subreptice, tandis qu’un défaut sur la dette publique est un événement financier et politique majeur. Notons que le directeur financier profite aussi de cette dilution de la dette publique par l’inflation puisqu’il voit ses propres dettes se déprécier en relation à son chiffre d’affaires ou à ses profits si ceux-ci évoluent à peu près comme l’inflation.
Cette possibilité de disposer d’un option de sauvegarde par monétisation des dépenses publiques ne vaut que si la dette est émise dans la monnaie du pays. Être endetté dans une autre monnaie met l’État dans la position de l’entreprise pour qui la dette est une contrainte en dur. Les pays moins avancés le savent : faute d’une épargne locale abondante, faute aussi de reconnaissance internationale de leur devise, ils doivent s’endetter à l’extérieur et dans une devise tierce.
Les pays de zone euro s’endettent aussi, mais en euros, une monnaie sur laquelle ils ont partiellement abandonné leur souveraineté. Par traité, la BCE n’a pas autorisation à être prêteur en dernier ressort d’un État membre de l’union monétaire, ce que la Grèce a appris à ses dépens. Cette prohibition a pu dans les faits être partiellement levée lorsqu’on s’est aperçu du caractère systémique de la crise de l’euro en 2011 (le whatever it takes de Mario Draghi), mais elle demeure. Voilà ce qui doit alerter les gestionnaires de l’État français sauf à jouer du « too big to fail ».
Financer par impôt ou dette ?
L’essentiel pour l’entreprise, comme on l’a vu, est la qualité de ses actifs, constitués par ses dépenses du passé, en travail et en investissement. Le mode de financement de ces actifs, dette ou capitaux propres, vient au second plan. Il y a même un résultat fondamental en finance d’entreprise, appelé théorème de Modigliani-Miller, qui dit que, sous certaines conditions, il est indifférent pour l’entreprise et ses parties prenantes que ces actifs soient financés par l’un ou par l’autre.
Aurait-on la même chose pour l’État ? Financer par impôt ou par endettement, ce serait pareil ? Certains économistes, très minoritaires, le pensent (résultat de Ricardo-Barro, le Modigliani-Miller des finances publiques). Selon eux, les agents privés qui souscrivent à la dette et sont contents ainsi d’échapper à l’impôt savent que la dette levée devra un jour être remboursée de leur poche. Ils ajustent alors leur comportement de dépenses comme si les fonds levés par l’État l’avaient été par impôt pour se tenir prêts à débourser le moment venu. Cela ne marche pas, bien sûr. Si l’on permet à Candide d’échapper à l’impôt, ce n’est pas pour autant qu’il mettra de côté l’argent qu’on ne lui a pas pris. Cette sorte de myopie du secteur privé rend efficace une relance budgétaire. Les revenus que l’État distribue sont dépensés, provoquent indirectement d’autres revenus et, miracle, lui reviennent en partie sous forme d’impôts. L’entreprise n’a pas cette chance de voir l’argent de ses dépenses revenir automatiquement dans ses caisses, encore qu’on disait autrefois de Ford qu’il payait bien ses ouvriers parce qu’ainsi il leur vendait des voitures.
Donc impôt et dette, comme modes de financement de l’État, ont des effets sensiblement différents. S’il fallait s’en convaincre davantage, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont touchées. Les intérêts sur les obligations publiques vont uniquement aux ménages qui disposent de l’épargne suffisante pour les acheter, tandis que les impôts touchent riches et pauvres, si l’on n’oublie pas le caractère généralisé des impôts indirects.
Faut-il garantir des comptes publics à l’équilibre ?
La France n’a pas enregistré une seule fois depuis 1973 un budget en excédent. Est-ce viable ? L’entreprise pourrait-elle se permettre d’afficher constamment des pertes et ne jamais par conséquent verser de dividendes à l’actionnaire ?
Candide connaît la comptabilité et sait que le solde budgétaire de l’État est un solde de caisse, analogue à un flux de trésorerie d’exploitation, tandis que le résultat net de l’entreprise ne prend, via l’amortissement, qu’une partie des dépenses d’investissement et de besoin en fonds de roulement. La comparaison ne tient que si elle est faite sur la base des mêmes termes.
La bonne question est : une entreprise peut-elle de façon récurrente être en situation de flux de caisse négatif ? La réponse est bien sûr positive tant que l’entreprise investit pour nourrir une forte croissance, sous réserve qu’elle respecte la contrainte de solvabilité. C’est ainsi que les startups lèvent des fonds pendant un temps très long. En comptabilité publique, elles seraient toujours en déficit. Par conséquent, un État peut afficher sur la durée un déficit public s’il peut, par ses dépenses, favoriser une croissance du PIB, et donc de ses impôts, supérieure au coût de sa dette. Supposons que le PIB et les dépenses publiques croissent toujours nominalement de 4% et que l’État souhaite maintenir sa dette publique à disons 50% du PIB. Il devra continuellement s’endetter et être négatif en flux de trésorerie. Mais ce ne sera possible sur la durée qu’à condition que le coût de sa dette reste inférieur à 4%.
On voit bien le risque de dérive que cette belle conclusion implique. Car 52 ans depuis 1973, ça fait un temps très long. La mauvaise dépense n’est jamais loin si le robinet est si facilement ouvert.
Mais Candide est choqué quand il voit certains États, l’Allemagne en particulier, voter une loi constitutionnelle interdisant le déficit public (sauf aléas conjoncturels). Car d’une part on s’oblige à une croissance faible et à thésauriser des excédents commerciaux, attitude malthusienne qui a pesé sur toute l’économie européenne depuis en réalité la mise en place de l’euro ; de l’autre, on montre le faible respect qu’on a pour la démocratie représentative puisqu’on s’attache à la ligoter au mât et lui interdire le libre exercice de sa fonction de contrôle budgétaire. La responsabilité budgétaire ne s’apprend que dans l’exercice libre de la responsabilité. L’Allemagne a piteusement été obligée de détricoter cette loi sous le récent gouvernement Merz, quand l’opinion publique a pris conscience du retard abyssal en dépenses militaires et d’infrastructure que ce zèle avait entraîné.
Il est enfin des dépenses publiques qui répondent à un objectif de régulation conjoncturelle. Candide a entendu parler de Keynes. Il est des situations de crise où la politique budgétaire est sollicitée en mettant du pouvoir d’achat aux mains du secteur privé. Cela permet de relancer l’activité par les dépenses de consommation et d’investissement. Le souci de rentabilité devient second mais, à y réfléchir, n’est pas tout à fait absent puisqu’il s’agit d’éviter que l’économie s’enfonce dans le sous-emploi. L’État joue ici une fonction assurantielle dont l’intervention doit rester ponctuelle car un assureur qui paierait toujours des indemnités sans lever de primes perdrait vite tout crédit. Sur la durée, le critère de rentabilité (sociale) est le seul qui vaille. Une bonne dépense publique, comme une bonne dépense d’entreprise, est une dépense « qui rapporte ».
L’État s’endette-t-il sur le dos des générations futures ?
Dernière question, cher Candide : en matière de dette publique, on entend souvent que la génération présente en profite, mais que ce sont ses enfants qui la payent. Les parents boivent, les enfants trinquent pour dire les choses ainsi. Qu’en pensez-vous ?
C’est un sophisme à écarter. Non, la dette publique ne vole pas les générations futures.
D'abord, si l'État emprunte, c'est que quelqu'un lui prête. Une personne de la génération présente sort de l'argent de sa poche pour financer l’État, de la même façon qu’elle sort de sa poche si l’État recourt à l’impôt. Dans les deux cas, la génération présente, ou une partie des gens en son sein, s’abstient de consommer, de boire en quelque sorte.
Celui qui a prêté sera heureux plus tard d'être remboursé, lui en personne s’il s’agit de son fonds de retraite, ou ses enfants. La dette publique, comme toute dette, fait voyager l'épargne dans le temps, au profit (ou pas, c’est la question) de nos enfants. La génération future rembourse bien sûr l’emprunt, mais en réalité rembourse celui dont le parent a prêté à l’État, c’est-à-dire quelqu’un de la même génération. Fin du sophisme.
La seule question vraiment importante, pour revenir à notre début, c’est la façon dont les fonds sont dépensés. S’il s’agit d’une bonne dépense, alors non seulement nos enfants seront remboursés, mais ils vivront mieux. Dans le cas inverse, ils nous maudiront. Et nous rappellerons qu’il n’y a qu’une seule dette qui ne soit pas le voyage d’une épargne dans le temps, c’est la dette climatique. Là, ils vont trinquer.
[1] Les actionnaires rencontrent parfois des difficultés à ce que l’entreprise leur distribue davantage de dividendes si, mécontents de la rentabilité, ils veulent retirer leur argent. Cela peut aller contre l’intérêt social de l’entreprise qui a primauté. Le droit commercial met donc des contraintes.
[2] Voir Ni, Jincheng et Joël Maurice, Révision du taux d’actualisation, France Stratégie, 23 novembre 2021.
[3] Ce n’est pas vrai pour une banque qui, en cas d’illiquidité, risque de devenir insolvable car tous ses clients prennent le large. C’est la raison qui fait qu’il y a ce prêteur en dernier ressort qu’est la banque centrale. Ce n’est pas vrai non plus en cas de crise financière, car alors les marchés financiers s’assèchent et les banques répugnent à prêter. L’entreprise solvable mais illiquide risque le défaut de paiement.
Tableau : Les 10 premières capitalisations boursières françaises depuis 2000
Nous avons exploité les données que nous publions chaque année en annexe du Vernimmen, présentant les 20 premières capitalisations boursières de 14 pays ou zones géographiques, avec leurs chiffres principaux pour produire le tableau suivant :
Il illustre combien il est difficile de rester au top. En effet, sur 6 observations de 5 ans en 5 ans, il y a 24 groupes qui ont au moins une fois été dans le top 10 des 10 premières capitalisations boursières françaises, restant donc en moyenne 10 ans. Seuls 4 groupes ont été présents systématiquement : L’Oréal, LVMH, Sanofi et TotalEnergies.
En 25 ans la capitalisation boursière requise pour être le premier, ou le dixième, a doublé, alors que le CAC 40 n’a augmenté que de 30 %. Aux États-Unis, c’est une multiplication par 7 pour le premier (et par 3 pour le dixième). En Allemagne, la multiplication n’est que 1,5 ; en Italie c’est la stagnation et au Royaume-Uni, c’est un recul du tiers que l’on observe.
Recherche : La valeur de la réputation des banques dans le pilotage des émissions d'actions
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
S’il est un actif incorporel dont la valeur est reconnue par les professionnels de la finance, c’est bien la réputation. Lors de l’annonce de son retrait prochain de la direction de Berkshire Hathaway, Warren Buffet expliquait qu’une perte d’argent était moins grave qu’une perte de réputation.
Dans le cas des banques, la réputation devient cruciale chaque fois que les asymétries d’information déterminent le comportement des acteurs. C’est le cas notamment dans leur activité de pilotage des émissions d’actions, qu’il s’agisse d’introductions en bourse (Initial Public Offerings, IPOs) ou d’augmentations de capital d’entreprises cotées (Secondary Equity Offerings, SEOs)[1]. Les investisseurs achètent plus facilement les titres proposés par les banques qui ont gagné leur confiance et qui proposent par exemple une couverture analytique de qualité après l’émission. La réputation de la banque a donc de la valeur pour l’entreprise émettrice, et les banques les plus réputées jouent un rôle de certificateur implicite de la qualité des titres émis.
Pour autant, les banques réputées bénéficient-elles d’un avantage concurrentiel qu’elles peuvent refacturer aux émetteurs ? C’est à cette question que l’article que nous présentons aujourd’hui[2] cherche à répondre.
Le paradoxe vient du fait que les taux de commissions [3] sont concentrés autour de 7% pour les IPOs et 4 % pour les SEOs aux Etats-Unis[4]. Non seulement on observe peu de variation dans les taux pratiqués, mais certaines études vont jusqu’à suggérer des taux de commissions très légèrement plus faibles lorsque la réputation de la banque est meilleure. À première vue, les efforts des banques pour développer leur réputation ne semblent pas rémunérés sur cette activité. Toutefois, comme souvent en finance, tout dépend de la mesure retenue.
L’erreur de raisonnement consiste à ne regarder que le taux de commission, exprimé en pourcentage, pour mesurer la rémunération de la banque. Ce qui compte est bien la rémunération en dollars (ou en euros) ! Si la réputation permet de réduire les asymétries d’information et donc de placer les titres à un prix plus élevé, un même taux de 7 % du total procure une rémunération totale supérieure. Il s’agit donc de vérifier si une meilleure réputation permet d’obtenir une meilleure rémunération en dollars, toutes choses égales par ailleurs.
Les difficultés techniques sont nombreuses. D’abord, il faut tenir compte du fait que le pilotage d’une certaine émission par une certaine banque dépend à la fois des préférences de l’émetteur pour certaines banques et des banques pour certains émetteurs. Il résulte de ce marché que les entreprises les plus grandes et/ou les plus réputées tendent à confier leurs émissions aux banques elles-mêmes les plus réputées. Les auteurs ont utilisé une estimation économétrique en deux étapes, la première consistant à mesurer les facteurs permettant l’association entre banques et émetteurs, et la seconde à mesurer la rémunération des banques en neutralisant l’impact de la procédure d’association et en tenant compte des caractéristiques de l’émission (taille, risque, conditions de marché). En procédant ainsi, les résultats sont clairs : il existe une relation positive forte entre réputation[5] et revenus perçus par la banque lors des émissions.
Cette relation est « monotone » au sens mathématique du terme, c’est-à-dire que chaque amélioration de la réputation se traduit par davantage de revenus. L’échantillon analysé inclut de manière quasi-exhaustive les IPOs et SEOs sur le marché américain entre 1980 et 2010 (6378 IPOs et 9164 SEOs). Sur cet énorme échantillon, une amélioration d’un écart-type de la réputation correspond à un gain supplémentaire de 300 000 dollars pour une IPO (à comparer à un gain total moyen de 5,2 millions de dollars) et 410 000 dollars pour une SEO (5,6 millions de dollars). L’effet est plus spectaculaire si l’on compare les revenus du top 20% en réputation (premier quintile) avec ceux des banques situées dans les 20% les moins réputées. L’écart en faveur du premier quintile est de 1,15 million de dollars pour une IPO et de 1,23 million de dollars pour une SEO. La réputation se paie, et elle se paie cher.
Dans la suite de l’article, les auteurs montrent que ces revenus supplémentaires ne sont pas au détriment des émetteurs. Lorsqu’ils choisissent une banque réputée pour piloter l’opération, ces derniers bénéficient de syndicats bancaires plus grands, d’une meilleure couverture par les analystes financiers, et finalement d’un meilleur placement de leurs titres.
Les résultats de l’étude sont conformes aux théories des asymétries d’information (la réputation a une valeur) et aux intuitions des praticiens. Par l’application de méthodes économétriques complexes à un large échantillon, les auteurs montrent que la réputation est fortement rémunérée dans le pilotage des émissions d’actions, alors qu’une observation naïve des taux de commissions pouvait laisser supposer le contraire.
[1] Thèmes couverts au chapitre 27 du Vernimmen.
[2] C.S.FERNANDO, V.A.GATCHEV, A.D.MAY et W.L.MEGGINSON (2025), The value of reputation: evidence from equity underwriting, Journal of Applied Corporate Finance
[3] Correspondant à l’écart entre le prix de vente aux investisseurs et le prix reversé à l’émetteur, sur lesquels les banques se rémunèrent, divisé par le prix de vente aux investisseurs.
[4] Les taux de commissions sont nettement plus faibles en Europe du fait d’un plus grand nombre d’acteurs et du concurrence plus forte.
[5] Les auteurs mesurent la réputation soit par la part de marché de la banque, soit par sa position habituelle dans les syndicats de placement (chef de file, participant important ou participant périphérique). Leurs résultats sont similaires dans les deux cas.
Q&R : Puis-je distribuer les liquidités contreparties d'un BFR négatif ?
A cette question simple, nous allons faire une réponse de Normand : cela dépend de l’activité de l’entreprise.
Si les clients ont payé en avance un abonnement ou versé des acomptes sur des prestations (un voyage à venir chez Voyageurs du Monde ou un abonnement chez Canal+ par exemple), ou des produits (comme un catamaran chez Outremer, ou le mensuel Philosophie Magazine[1]) que l’entreprise aura besoin de fabriquer ou d’acquérir à l’extérieur ; alors il est peu sage d’utiliser cette trésorerie qui vous a été avancée par vos clients pour verser un dividende ou faire des rachats d’actions. En effet, vous en aurez besoin pour réaliser le produit ou le service contrepartie des avances de vos clients.
Certes on peut penser que, le temps passant, de nouveaux clients, encore plus nombreux, verseront de nouvelles avances ou de nouveaux paiements sur des produits ou services à livrer, permettant de financer les dépenses nécessaires à la satisfaction des clients précédant. Mais c’est alors entrer dans une fuite en avant, ou une pyramide de Ponzi au niveau de l’entreprise qui peut se terminer très mal.
Si maintenant les fonds avancés par les clients correspondent à la mise à disposition pendant une certaine période de temps d’un produit ou d’un service qui a été mis en place (comme les abonnements à des services de contrôle d’accès et d’interphonie Intratone), et qui ne nécessitent pas dans le futur de nouvelles dépenses, mis à part le cas échéant une mise à jour ou un entretien légers, alors la situation est différente. En effet, la contrepartie de ces avances est la mise à disposition d’un produit ou d’un service pour lesquels les dépenses induites pour l’entreprise sont négligeables, lui donnant alors une grande latitude pour utiliser ces fonds, y compris pour les distribuer.
[1] Dont nous sommes actionnaires.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. Aucun de nous deux n’est actionnaire des sociétés mentionnées. Voici nos derniers billets.
Décote de taille et décote d’illiquidité sont comme blanc bonnet et bonnet blanc (8 septembre 2025)
L’entreprise Eduniversal, cotée sur Euronext Access (l’ancien Marché Libre dont Euronext a voulu améliorer la réputation en lui donnant son nom), fait 4,6M€ de ventes et 1,1M€ de résultat net courant avec une équipe de 17 personnes autour de son activité de classement des écoles de commerce.
Le 6 août, elle a lancé son offre publique de retrait, validée par Euronext.
Le dirigeant et fondateur d'Eduniversal, qui détient 90% des actions, a choisi un expert-comptable pour faire l’évaluation de son entreprise, chiffrée à 3,1M€. Ce travail contient plusieurs déficiences qui ont laissé Euronext de marbre, si tant est que ses services ont lu cette évaluation :
1/ Un coût du capital de 19,5% !
Pour une entreprise au bêta de 1 et un coût moyen du capital dans l’économie autour de 8 %, on ne peut que bondir face à 19,5% ! L’expert atteint ce chiffre proprement inouï en ajoutant une prime de taille de 10%. Il ne parle pas de prime de liquidité, car cela serait incongru dans une offre de retrait qui offre justement une liquidité aux actionnaires. Mais la prime de taille pour les petites entreprises n’est-elle pas autre chose qu’une prime de liquidité qui cache son nom ? En effet, une entreprise de petite taille sera nécessairement peu liquide. Mais cette prime dite « de taille » est bien utile pour justifier le prix de l’offre, qui sinon aurait dû être près de 4 fois supérieur avec un coût du capital de 8%, ou 2 fois supérieur si l’on avait pris 12%.
2/ Une omission de la trésorerie dans le DCF
Si l’expert pense bien à ajouter la trésorerie dans la méthode des multiples d’EBE, il l’oublie dans la méthode DCF (!), minorant ainsi de 11% cette valeur.
3/ Des comptes obsolètes
L’évaluation repose sur les comptes certifiés dont les derniers datent du 30/9/23 et des comptes au 30/9/24 dits « prévisionnels », non certifiés ! alors que les comptes 2025 dorénavant clôturés au 31 mars, sont disponibles depuis fin juin 2025 (transmis à l’administration fiscale dans les 3 mois).
Tout évaluateur s’appuie sur des comptes historiques certifiés récents. Un expert, qui n’est pas indépendant que de nom, aurait exigé de travailler sur ces comptes disponibles depuis fin juin 2025, quitte à retarder de plusieurs semaines le lancement de ce retrait, plutôt que de travailler sur des comptes au 30/9/24 dits « prévisionnels », non certifiés. À qui fera-t-on croire qu’il y avait urgence absolue à lancer ce retrait de cote un 6 août, sauf si bien sûr les comptes au 31/3/25 sont meilleurs que le « prévisionnel » au 30/9/24 ?
Conclusion
Il ne suffit malheureusement pas d’appeler le Marché Libre Euronext Access pour que des pratiques honteuses disparaissent, comme le retrait de cote avant l’été de MAB (dont un des co-auteurs du Vernimmen est actionnaire) l’illustrait. Il faudrait pour cela qu’a minima Euronext y consacre du temps et utilise ses pouvoirs. Le retrait de cote d'Eduniversal lancé le 6/8 avec l’accord d'Euronext l’illustre malheureusement une nouvelle fois.
AXA s'endette moins cher que la République française (17 septembre 2025)
Environ 70 grands groupes européens, dont Axa, s’endettent moins cher que l’État français depuis plusieurs semaines, du fait de la hausse du taux d’intérêt auquel s’endette l’État français, elle-même causée par notre incapacité collective à réduire le déficit budgétaire à un niveau qui assure la soutenabilité de la dette de notre nation.
Ainsi vendredi, l’obligation de l’assureur à échéance octobre 2030 rapportait 2,74% contre 2,75% pour l’obligation de l’État français d’échéance similaire. Et pourtant, l’État est avantagé par une prime de liquidité que les investisseurs consentent pour rémunérer l’excellente liquidité de cette OAT dont l’encours est de 59 Md€. La liquidité de l’obligation d’AXA est bien plus faible avec un encours de seulement 850 M€, et d’une habitude des acquéreurs de ces obligations de les garder le plus souvent jusqu’à leur échéance (buy and hold). Sans cette prime de liquidité dont bénéficie l’État français du fait d’une très bonne gestion par France Trésor du marché de la dette française, celui-ci s’endetterait à 2,90% environ.
La comparaison de cet emprunt d’AXA avec celui d’échéance similaire d’Allianz montre que les taux d’emprunts des 2 groupes continuent d’être similaires (2,72% pour Allianz), alors même qu’AXA a un rating marginalement inférieur (AA-, soit celui de la République française, contre AA pour Allianz, avec la République allemande à AAA). AXA n’est donc pas pénalisé par la détérioration des conditions d’emprunt de l’État français. Il n’y a pas non plus de report d’investisseurs en dettes souveraines vers la dette des grands groupes français, ce qui n’est guère surprenant compte tenu de leur liquidité très inférieure.
Dans les pays de l’OCDE, il est très rare que des groupes émettent à de meilleures conditions que leur pays d’origine. Cela avait été observé brièvement pendant la crise de l’euro de 2012, mais concernait bien moins de groupes qu’aujourd’hui. Cette situation est bien sûr peu flatteuse puisqu’elle s’observe généralement dans les pays émergents, dont les finances gouvernementales peuvent être chaotiques.
Cette indépendance, pour l’instant, des grands groupes français par rapport à la dette de leur État est heureuse. Les groupes moyens semblent aussi non touchés. Ainsi le taux de l’obligation 2030 de SEB a baissé cet été de 10 points de base comme celle d’AXA et d’Allianz, alors que le taux des OAT 5 ans a progressé d’autant.
Les emprunts bancaires à taux variable indexés sur €STR ou Euribor ne devraient pas être concernés, tant que le coût de financement à court terme des banques françaises n’est pas affecté.
Cela sera moins le cas pour les particuliers pour leurs emprunts immobiliers futurs dont le taux d’intérêt est plus ou moins indexé sur celui des OAT long terme. Meilleurtaux annonce ainsi une hausse moyenne de 10 à 15 points de base en septembre pour les crédits immobiliers.
2 % = 73 % ? ? ? (20 septembre 2025)
Les débats sur l’idée de taxer à 2 % chaque année les détenteurs d’un patrimoine de plus de 100 M€ ont montré le caractère irréaliste de cette proposition concernant les start-ups, et l’absence de réflexions microéconomiques de leurs promoteurs.
Le sujet n’est pas ici de savoir s’il faut taxer plus les très riches, si le décide ainsi la représentation nationale ; mais de ne pas se tirer collectivement une balle dans le pied, comme on l’a trop souvent fait dans le passé.
Or cette proposition n’est pas seulement délétère pour les start-ups, elle l’est aussi pour toutes les entreprises avec des actionnaires qui seraient soumis à cette taxe.
Prenons l’exemple de bioMérieux qui en 2024 a fait 4 Md€ de ventes dans les diagnostics in-vitro. C’est une entreprise en croissance : + 17 % de ventes depuis 2021 et + 11 % pour ses effectifs. La trésorerie générée avant impôt sur les sociétés (IS) par son activité a été de 821 M€ et a servi à payer :
· ses investissements : 360 M€,
· son IS : 159 M€,
· un dividende : 100 M€ (24 % du résultat net de 425 M€),
· des rachats d’actions (38 M€) pour distribution gratuite aux salariés,
· et le solde : 169 M€ a été placé en trésorerie en vue d’acquisitions futures pour renforcer bioMérieux.
Au total, 27 % de la richesse créée par bioMérieux est revenu à l’État, via l’IS.
bioMérieux capitalise en Bourse 13,5 Md€. Elle est détenue par la famille fondatrice à 59 % qui serait donc redevable d’une taxe de 2 % x 59 % x 13,5 Md€, soit 159 M€. Pour l’acquitter, cette famille pourrait :
· Soit céder pour 159 M€ d’actions soit 1,2 % du capital chaque année, organisant ainsi le passage des Mérieux sous le seuil des 50 %.
· Ou augmenter les dividendes versés de 100 M€ à 386 M€, ce qui aurait conduit bioMérieux à s’endetter en 2024 de 117 M€, plutôt que de préparer de futures acquisitions en mettant de côté 169 M€.
La volonté d’un entrepreneur de ne pas perdre le contrôle de son entreprise a des chances de le conduire à privilégier l’option dividende. Dans ce cas, à partir d’un résultat avant impôt de 579 M€, l’État s’en approprierait :
· 154 M€ (impôt sur les sociétés)
· 159 M€ (taxe de 2%)
Soit 381 M€, ou 54 % du résultat avant impôt généré par l’entreprise.
Et non 27 % comme aujourd’hui. Le double.
Et pour une entreprise jumelle de bioMérieux, non cotée, où tous les actionnaires seraient redevables de cette taxe, c’est 73 % de la richesse créée par l’entreprise qui serait prélevé par l’État. Oui, 73 % contre 27 % aujourd’hui.
Qui veut tuer à petit feu par inconséquence ou incompétence les entreprises françaises, start-ups ou non, détenues en partie ou en totalité par leurs fondateurs ?
En attendant, ce n’est pas une taxe totémique rapportant entre 5 Md€ et 20 Md€ par an qui réduira significativement, à elle seule, un déficit budgétaire de 161 Md€.