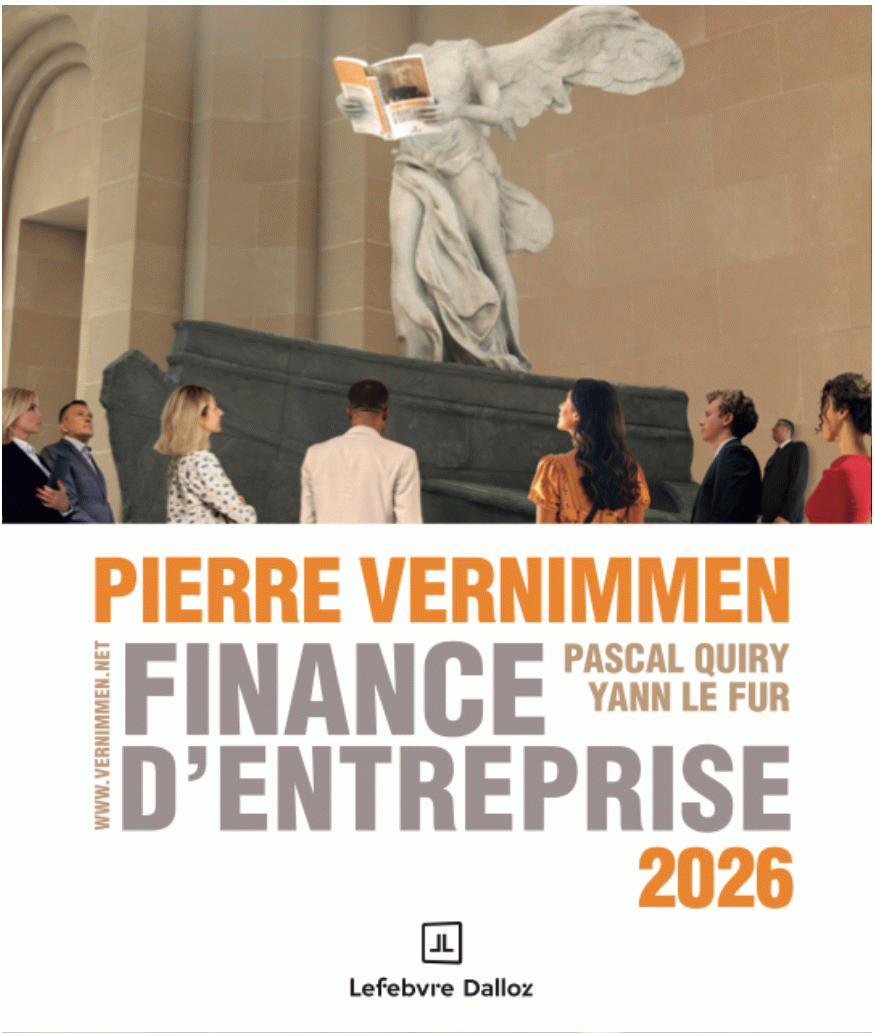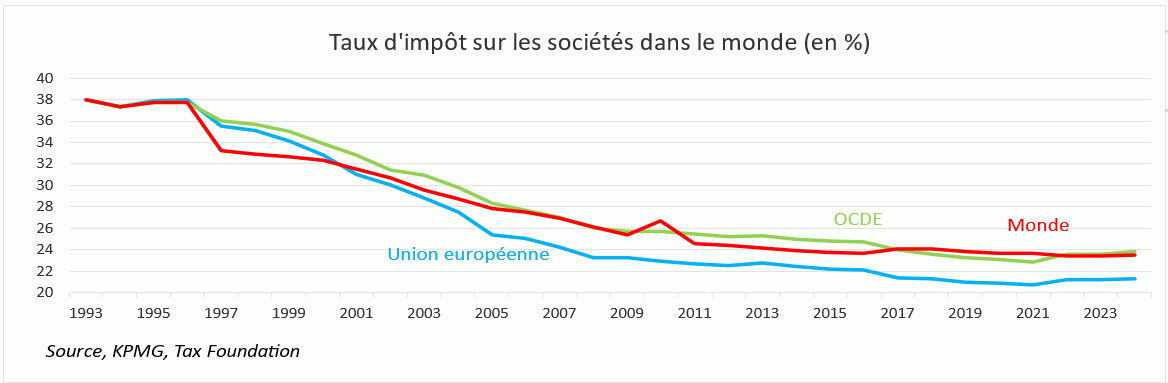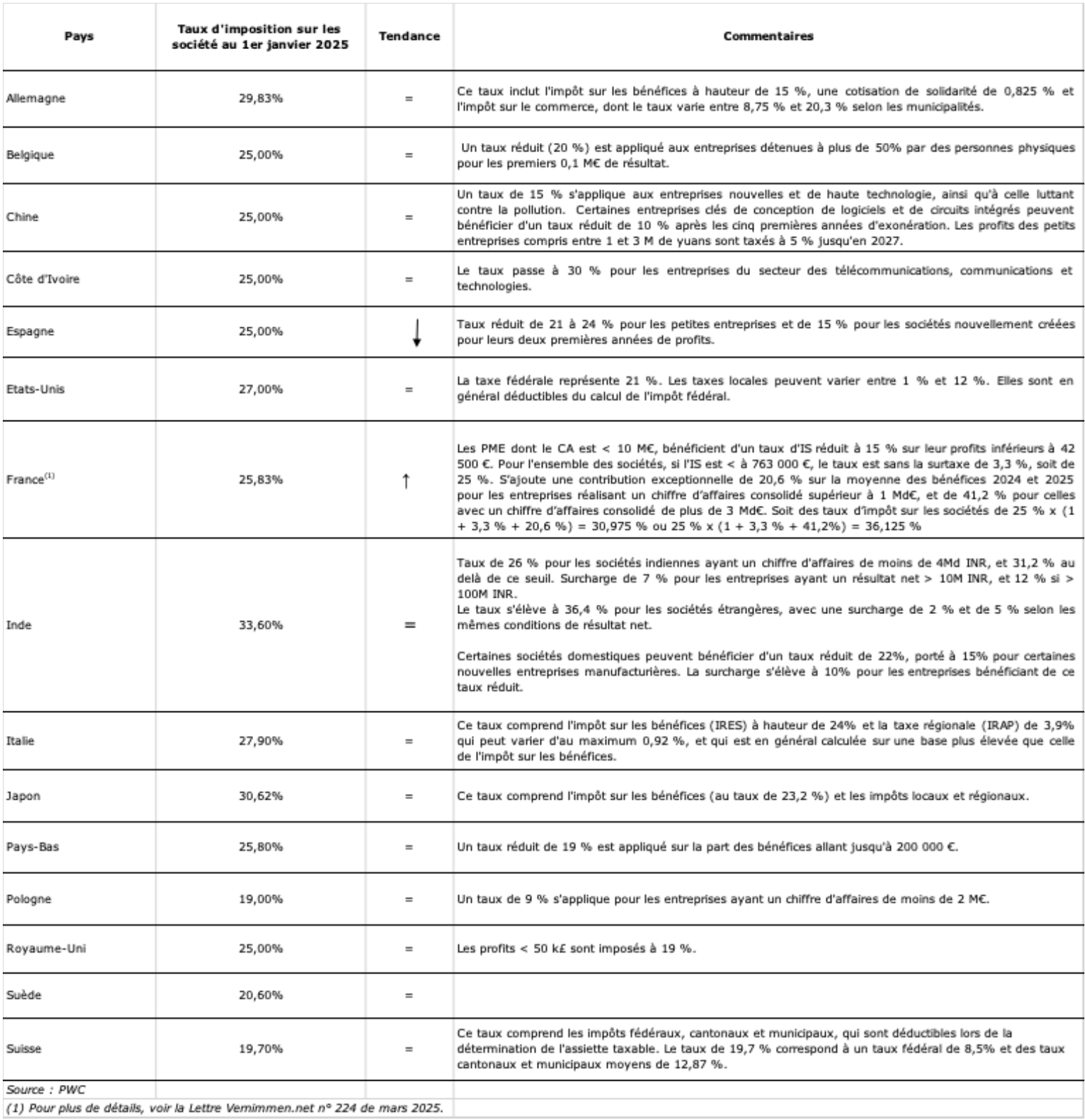La Lettre n°228 de Juillet 2025
Actualités : La prochaine édition du Vernimmen 2026
Comme chaque année, nous offrons à nos lecteurs la primeur de la couverture du nouveau Vernimmen qui sera disponible en librairie à partir du 21 août :
Le 16 septembre à Paris, dans la librairie Dalloz (5ème) à partir de 18h30, nous ferons une séance de dédicaces, permettant d’échanger avec nos lecteurs qui le souhaiteraient.
Et le lendemain 17 septembre, à Lyon, nous serons à partir de 15h au congrès des experts comptables pour une autre séance de dédicaces.
Enfin le jeudi 20 novembre à 19h, dans le centre de Paris nous ferons notre conférence habituelle consacrée à l’avant-propos du Vernimmen 2026, que nous avons intitulé cette année : Les fonds de LBO immobilisés par la hausse des taux d’intérêt ou leur propre dynamique ?
Actualités : Make equity great again ou accroître l'attractivité des marchés financiers européens (2/2)
Voici la seconde partie de l’avant-propos de l’édition 2025, dont la première partie a été publié dans le numéro de juin.
La portée profonde de l’actualisation et ses conséquences
Mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comme l’indique réglementairement toute publicité pour un produit financier. Le sens de cette mention est de mettre en garde l’épargnant contre l’extrapolation de performances passées dans le futur immédiat, ou contre la tentation de penser qu’un gérant qui vient de battre le marché, peut continuer de le faire dans le futur.
Mais dans la durée et macro-économiquement, elle perd de son sens. Pour bien le comprendre, revenons aux fondements de la valeur d’un titre financier qui est l’actualisation des flux de trésorerie qu’il est susceptible de générer dans le futur. Imaginez que, pédagogiquement, nous vous proposions de vous verser la somme de 110 dans un an, pour autant que vous nous achetiez cette promesse aujourd’hui, à un prix qui fait l’objet de cet exercice. Supposez, pour simplifier les calculs de tête, que vous souhaitiez obtenir un taux de rentabilité de 10 % sur votre investissement. À quel prix êtes-vous prêt à nous acheter aujourd’hui cette promesse ?
Normalement vous devriez nous répondre 100, et d’un point de vue technique vous pourriez ajouter que c’est là le fruit de l’actualisation d’une somme future (110 dans un an) pour en déterminer l’équivalent actuel, c’est-à-dire sa valeur actuelle. Dès lors que vous avez déprécié le flux futur pour l’acquérir aujourd’hui à un prix moindre que son montant nominal futur, vous vous garantissez une progression de la valeur de votre investissement.
Actualiser les flux futurs, c’est donc obtenir une rentabilité sur son placement ; et c’est ce qui se fait en finance depuis des siècles, d’où la forme des courbes historiques vues plus haut.
Dans le cas des rentes, cette rentabilité est assez sûre, car sauf faillite de l’émetteur, les flux prévus d’intérêts et de remboursement seront au rendez-vous. Pour les actions, les flux dépendent, non d’un engagement à verser une somme fixe, mais de flux fluctuant dans leurs montants, qui sont fonction de la santé financière de l’entreprise. La rentabilité est donc plus variable, car on peut sous-estimer les flux futurs (comme en 2020, pour la vigueur de la reprise post covid), ou les surestimer (comme en 2019 avant le covid qui n’était sur aucun radar). D’où des périodes de boom et de krach qui se corrigent dans le temps, comme le montre le graphique de David Le Bris. Dans le temps long, la moyenne triomphe des écarts-types.
La conséquence opérationnelle de ceci est que l’individu a financièrement intérêt à avoir :
- une épargne de précaution pour faire face aux aléas de la vie courante, placée en liquidités ou en obligations courtes et peu risquées ;
- puis une épargne à l’horizon de quelques années pour des projets structurants comme une acquisition immobilière ou les études supérieures des enfants, placée en obligations ;
- et la plus grande partie du reste, en particulier dans l’optique de la retraite ou de la transmission, gagne à être investie en actions diversifiées sectoriellement et internationalement.
⁂
Que faire pour améliorer l’attractivité des marchés financiers européens ?
Plusieurs États européens ont fait voter en 2024 des lois pour améliorer l’attractivité de leurs marchés financiers locaux. Ainsi en France, la faculté pour les entreprises se cotant en Bourse de doter les actions détenues par leurs fondateurs de droits de vote multiples (jusqu’à 25 pour une action) pour une durée maximum de 15 ans, des modalités plus souples pour effectuer des augmentations de capital sans droits préférentiels de souscription, la numérisation des activités de financement du commerce international, la qualification automatique des PME éligibles au PEA PME, la faculté de négocier des fractions d’actions, d’obligations ou de parts de fonds, etc.
Que l’on nous permette de dire que ces mesures sont loin d’être à la hauteur des enjeux et se concentrent quasi uniquement sur les émetteurs. Elles ne sont pas de nature à changer les incitations de nos compatriotes à rester très majoritairement investis en produit de dettes. Ainsi la Banque de France estime le patrimoine des Français fin 2023 à environ 14 000 Md€, dont 6 185 Md€ en placements financiers, le solde correspondant principalement à des actifs immobiliers. Sur ces placements financiers, 1 363 Md€ sont des placements en actions non cotées et autres participations, correspondant pour l’essentiel à l’outil de travail des entrepreneurs et dirigeants. Soit un solde librement décidé de 4 822 Md€ composé à 77 % de titres de créances : 1 483 Md€ en compte en euros pour l’assurance-vie et la retraite, 751 Md€ de dépôts à vue, 565 Md€ en livrets A et assimilés, 396 Md€ en dépôts à terme et livrets ordinaires. Le solde de l’épargne, 23 %, soit 1 017 Md€, est investi en actions, dont à peu près la moitié via des unités de compte de contrats d’assurance-vie ou de plan de retraite.
La fiscalité est indéniablement un critère d’orientation majeur, si ce n’est souvent le seul critère de choix de beaucoup d’épargnants. Or pour des raisons historiques, la fiscalité française avantage massivement les placements en titres de dettes.
Ainsi l’assurance-vie permet à un couple de placer 305 000 € en contrat en euros (placés très largement en obligations puisque l’assureur doit garantir le capital), et de retirer chaque année les intérêts à 3 % avec seulement 1 574 € de coût fiscal. Et si ce couple décède avec au moins deux enfants, le contrat ainsi transmis le sera en franchise totale de droits de succession.
Par ailleurs, ce même couple peut placer 22 950 € par personne dans son foyer, soit 91 800 €, sur des livrets A, et 24 000 € sur deux Livrets de développement durable et solidaire, totalement liquides et exonérés de toute fiscalité.
C’est donc un total de patrimoine financier de 420 800 € que ce ménage peut placer sans impôt significatif, sans aucune prise de risque en capital et totalement liquide.
S’il voulait placer cette somme en actions, il pourrait ouvrir des PEA (mais avec un plafond des placements, contrairement à l’assurance-vie), et sans aucune exonération spécifique de droits de succession ou taux d’imposition réduit au-delà des abattements.
Ces 420 800 € correspondent environ au 8e décile des patrimoines avant endettement, immobilier inclus, des ménages français. Autrement les trois quarts des ménages français ont toutes les incitations fiscales à placer en dette, ce qu’ils ne se privent pas de faire, et marginalement de placer en actions : les contrats d’assurance-vie et de retraite sont placés à plus de 74 % en dette (contrats en euros).
Tant que cette distorsion qui voit l’épargne sans risque être non imposée alors que l’épargne à risque l’est, il ne se développera pas de marché financier profond en France. En effet, les ménages continueront de privilégier les placements défiscalisés en dettes, même si ce n’est pas leur intérêt financier à long terme, ni celui du pays, et d’ignorer massivement les placements en actions. Et les start-up prometteuses, les grands groupes continueront d’aller chercher des capitaux de l’autre côté de l’océan ; quand ils ne s’y établiront pas définitivement.
Aussi, si les pouvoirs publics veulent vraiment développer l’attractivité du marché financier, nous suggérons qu’ils réservent les avantages fiscaux des placements en assurance-vie aux seuls supports investis en capitaux propres, les autres entrant dans le régime commun qui n’a rien de spoliateur (barème de l’IR et prélèvements sociaux, ou 30 % forfaitaires). Quant aux livrets d’épargne réglementée (livret A, livret jeune, LDDS, etc.), leur encours par ménage devrait être plafonné, par exemple à 33 200 €, qui est le patrimoine brut du 3e décile, pour ne pas offrir un effet d’aubaine à ceux qui ont les moyens financiers et culturels de s’occuper de la gestion de leur patrimoine.
Parallèlement, un effort de pédagogie comme celui que les Suédois ont réalisé il y a 40 ans, bien avant l’arrivée d’Internet qui facilite grandement les choses, doit être fait envers les ménages, et plus structurellement envers les adolescents, pour intégrer dans leur cursus scolaire des cours sous forme de MOOCs leur permettant d’apprendre avec des pédagogues compétents les bases de la finance : capitalisation, actualisation, valeur actuelle, caractéristiques des actions et des dettes, principaux placements financiers et le b.a.-ba de la gestion patrimoniale personnelle. Il nous semble qu'une attestation de savoir minimum financier (ASMF) serait aussi utile dans la vie aux jeunes que l’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) qui doit être obtenue au collège afin de passer le permis de conduire plus tard.
Enfin, et plus symboliquement, nous suggérons qu’Euronext, qui a déjà fusionné ses 7 plateformes boursières pour n’en faire plus qu’une seule, cesse de s’afficher comme 7 entités différentes dans ses 7 pays (Belgique, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal) pour apparaître comme un seul Euronext avec des indices phares (Europe 200 ? Europe Small and mid ?, etc.) remplaçant le CAC 40, le MIB 40, le BEL 20, etc., et ayant vocation tôt ou tard à accueillir en son sein toutes les grandes valeurs cotées en Europe, à défaut de pouvoir réaliser tout de suite la fusion avec les autres Bourses européennes de Francfort, Londres, Madrid, Stockholm et Zurich.
⁂
Nous avons parfaitement conscience que ce programme esquissé ne pourra être mis en place et ne produira ses effets que dans la durée, comme l’expérience suédoise le montre. Et que dans un moment (juin 2024) où les extrêmes semblent séduire les deux tiers des citoyens avec des mesures parfaitement démagogiques et destructrices, tracer la voie de la raison peut sembler vain. Mais après le bruit et la fureur, reviendra tôt ou tard la voie de la raison sous l’effet de la nécessité ou de la lucidité. Et les pédagogues que nous sommes ont la faiblesse de penser que nous ne formons pas seulement nos étudiants ou nos lecteurs pour les prochaines semaines, mais pour les prochaines décennies.
Rome ne s’est pas faite en un jour ; ni votre Vernimmen qui fête cette année le cinquantième anniversaire de sa première parution.
Tableau : Les taux d'impôt sur les sociétés dans le monde
Les taux d'imposition des résultats des sociétés dans le monde ont très légèrement augmenté en 2024 et s'établissent désormais en moyenne à 23,51 % (23,37 % en 2023). C’est aussi le cas des pays de l'OCDE qui ont commencé à remonter leur taux depuis le plus bas atteint en 2022 (23,04 %) pour le porter à 23,85 % en 2024.
Dans l'Union européenne, les taux d'imposition sont d'environ 21 % pour la deuxième année consécutive, mais ils restent faibles en raison des taux d'imposition des sociétés plus bas en Europe de l'Est.
Recherche : Obligations sociales : le prix du S de l'ESG
En matière de finance responsable, il est important de distinguer les trois composantes E, S et G susceptibles d’être prises en compte dans les choix d’investissement. Les enjeux de gouvernance (G) sont depuis longtemps (probablement depuis toujours) au cœur de la finance. L’administration et le contrôle des entreprises, la répartition des pouvoirs entre investisseurs, dirigeants, salariés, parties prenantes, les éventuels conflits internes sont indissociables du processus de création et de répartition de la valeur.
Les préoccupations environnementales (E) sont quant à elles devenues un enjeu de société majeur et la finance les a progressivement intégrées. La réduction des émissions de carbone présente pour avantages de constituer un objectif consensuel et d’être assez facilement mesurable ; la finance peut ainsi en rendre sa part, et l’existence d’une prime carbone confirme une préférence des investisseurs pour les entreprises vertueuses en la matière. La préservation de la biodiversité est une question plus complexe, mais le sujet commence à être pris en compte.
Reste le social (S), plus politique, moins mesurable et surtout essentiellement qualitatif. L’article que nous présentons ce mois[1] se demande s’il existe une prime sociale comme il existe une prime carbone.
Comme dans le cas de la prime carbone, la prime sociale[2] mesurerait la valeur que les investisseurs attribueraient à la vertu sociale des investissements, ou bien (ce qui revient au même) la performance financière qu’ils sont prêts à sacrifier pour obtenir de la performance sociale.
Pour tester l’existence d’une prime sociale, les auteurs se sont intéressés aux obligations sociales (social bonds) émises entre 2015 et 2020 par des institutions ou agences internationales, nationales ou de collectivités locales. Les obligations dites sociales peuvent notamment servir au financement d’infrastructures et de logements accessibles aux foyers défavorisés, au développement de systèmes d’accès à l’éducation et à la santé, ou à l’amélioration de la sécurité alimentaire. Les émissions par des entreprises ou des institutions financières, minoritaires sur ce marché (moins de 25%) ont été exclues par manque de données sur l’évolution de leur valeur de marché. Aussi, l’échantillon est constitué uniquement de titres dont la maturité est comprise entre 2 et 20 ans. Sur les 83 émissions retenues, 49 ont été effectuées durant la seule année 2020. Ce constat reflète bien la tendance générale des obligations sociales : c’est en 2020, année de déclenchement de la crise covid, que ce marché a pris son véritable essor, en nombre et surtout en volume. En raison de la nature des émetteurs et des projets financés, les émissions d’obligations sociales sont de très grande taille : elles représentent moins de 0,1% du nombre d’émissions obligataires en 2020 mais 1,6% de leur volume. Dans l’échantillon étudié, la taille moyenne des émissions est de 1,5 Md$.
Afin de tester l’existence d’une prime sociale sur l’échantillon, les auteurs construisent des échantillons de contrôle constitués d’obligations comparables ne disposant pas de la caractéristique sociale. Dans l’idéal, ils comparent chaque obligation sociale à une obligation classique du même émetteur et de la même maturité émise l’année précédente. Lorsque ce n’est pas possible, ils retiennent les obligations dont la date de règlement est proche de celle du titre social, éventuellement d’un autre émetteur. Le principal résultat empirique est qu’aucune prime sociale n’est observable sur l’échantillon, ni à la date d’émission (marché primaire), ni généralement sur le marché secondaire.
Le seul effet financièrement notable est l’existence d’un différentiel de rendement (de l’ordre de 6 à 7 points de base) entre les obligations classiques plus anciennes (« off-the-run ») d’un émetteur et ses obligations sociales présentant la même maturité résiduelle. Cette légère prime constitue davantage une prime de liquidité qu’une prime sociale : les investisseurs vendent des anciennes obligations classiques et achètent ces nouvelles obligations sociales, plus liquides.
Ainsi, il semblerait que les investisseurs ne soient pas prêts à renoncer à du rendement pour des obligations sociales, contrairement à ce que l’on observe avec les obligations vertes. Ce résultat pose la question de l’intérêt, pour les émetteurs, à se financer par obligations sociales plutôt que classiques. Les auteurs recherchent une explication du côté de la sociologie des organisations. Selon la théorie du nouvel institutionnalisme, les organisations agissent sous des pressions sociales, mimétiques et normatives, et cherchent à gagner en légitimité auprès de leurs parties prenantes. Même sans intérêt financier à recourir aux obligations sociales, leur émission renforce la crédibilité de l’organisation en ce domaine et valorise leur image. Aussi, avec le développement de ce marché et des systèmes de notation associés, cela peut préparer l’accès à de nouvelles sources de financement.
Q&R : Qui a dit quoi ?
Pour ne pas perdre totalement le contact avec la finance durant la pause estivale, nous vous suggérons d’attribuer à chaque citation son auteur :
- 1. Lorsque vous évaluez une entreprise, vous devez avoir confiance en votre valeur et vous devez avoir la foi que le prix rejoindra cette valeur.
- 2. Les horloges sont faites pour dire l'heure et les tarifs pour dire les coûts.
- 3. C'est probablement lorsque vous atteignez le sommet du cycle que vous êtes le plus populaire.
- 4. C'est le côté humain, en pratique le côté négociation, qui m'a attiré dans la banque.
- 5. Le déséquilibre entre les riches et les pauvres est la plus ancienne et la plus mortelle maladie de toutes les républiques.
- 6. L'expérience montre qu'il n'est pas sage de se fier à la cupidité humaine lorsqu'elle a l'occasion de s'enrichir aux dépens d'autres personnes.
- 7. Mais les dividendes permettent de financer les entreprises !
- 8. L'or est la monnaie, tout le reste est du crédit.
- 9. Plus l'environnement financier est exubérant, plus les gens regardent quelque chose comme les cryptos et passent de la possibilité que ça marche à la certitude que ça va marcher. Et c'est là que vous avez des problèmes.
- 10. Le Bitcoin est une pyramide de Ponzi : vous ne pouvez gagner de l'argent que si vous trouvez un plus grand crétin pour acheter vos bitcoins plus cher que vous ne les avez acquis.
Et pour les auteurs :
Honoré de Balzac, écrivain français du 19e siècle.
Marcel Boiteux, ancien dirigeant d'EDF.
Aswath Damodaran, professeur de finance à Stern Business school à New York, spécialiste des questions d'évaluation.
Jeremy Grantham, investisseur.
Ken Griffin, fondateur de Citadel.
Eric Lombard, alors directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Howard Marks, investisseur et fondateur de Oaktree Capital.
JP Morgan, financier américain 19-20e siècle.
Plutarque, historien romain du 1er siècle après JC.
Tribunal de Colombus, Ohio, lors d'un procès contre la Standard Oil Company of Ohio en 1890.
Siegmund Warburg, banquier européen du 20e siècle
Les réponses sont données à la fin de la section Commentaires.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
Valeur ou prime, laquelle est la première ? (19 juillet)
À la différence de l’œuf et la poule, cette question admet une réponse simple. Dans une offre publique, les banquiers d’affaires expérimentés déterminent d’abord la valeur de la cible pour leur client et en déduisent alors la prime qui est la résultante de la comparaison entre cette valeur et le cours de Bourse.
Les novices, eux, se contentent d’ajouter paresseusement une prime standard (par exemple 35 %) au dernier cours de Bourse pour déterminer le prix de l’offre. Ils prennent alors le risque d’une rébellion des actionnaires qui savent compter et d’un échec de l’offre.
Le rôle du banquier d’affaires en matière d’évaluation n’est donc pas simplement celui d’un manieur d’Excel comme pourrait le croire le naïf. Il doit faire l’éducation de son client et ne pas faiblir devant son avarice ou son ignorance ; et le convaincre, si ce dernier veut parvenir à ses fins, qu’il faut mettre le prix plutôt que d’échouer à franchir le seuil pour une prise de contrôle ou un retrait de cote. C’est là que l’on reconnaît les plus professionnels.
Les exemples récents le montrent :
- NDK (conseillé par le Crédit Agricole du Languedoc) sur Parot : une prime de +243 % sur la moyenne des cours à trois mois, un prix correspondant à la valeur multi-critères pour cette petite valeur peu liquide et pas suivie par les analystes financiers.
- Talan (conseillé par ODDO BHF) sur Micropole : une prime de +190 %
- Quand le groupe Arnault (conseillé par Crédit Agricole CIB) a offert 44 000 € par action Financière Agache, pour acquérir les 2 189 actions qu’il ne possédait pas (0,07% du capital), pour sortir définitivement de Bourse cette holding méconnue du contrôle de LVMH contre un prix d’acquisition de 2 500 à 3 500 € (sur 41 actions lors d’un ramassage au fil de l’eau) dans les 12 mois précédents. Soit une prime de 1 157 % (sic). Un record, sans doute. Mais la qualité, elle, n’a jamais été bon marché.
Sabadell, on n’est jamais meilleur que sous pression (28 juillet)
La banque catalane a présenté son plan stratégique jeudi afin de l’aider à échapper aux griffes de BBVA qui a lancé une OPE hostile il y a plus de 14 mois. En l’état actuel, et sans révision de la parité, cette offre a peu de chance de réussir puisque l’offre de BBVA décote de 13 % par rapport au cours de Sabadell.
Pour achever de convaincre ses actionnaires de ne pas apporter leurs titres à l’offre de BBVA, Sabadell leur a promis de restituer tous les capitaux propres générés par ses résultats qui viendraient en excès de 13 % de ses actifs moyens pondérés (ratio CET1), par le biais de dividendes (pour 60 % des résultats) ou de rachat d’actions pour le solde. 13 % n'a rien d’aventureux puisque le minimum prudentiel est de 9,4 % ; BBVA est à 12,8 %, et BNP Paribas à 12,5 %.
On est là au cœur du processus d’allocation du capital.
Les dirigeants et les actionnaires de Sabadell considèrent qu’ils sont confortables avec une structure financière où les actifs pondérés de leur banque sont financés avec 87 % de dettes et 13 % de capitaux propres. Garder des capitaux propres en excès de ces 13 % revient inévitablement à les placer en actifs monétaires sans risque (qui ne rentrent pas dans le calcul du ratio CET1), faute de pouvoir accorder des crédits supplémentaires à ses actuels clients ou à des nouveaux (ce qui ferait ainsi disparaître ces capitaux propres excédentaires).
Bien évidemment, il serait préférable que Sabadell utilise ses capitaux propres au-delà du ratio de 13 % pour accorder de nouveaux crédits. Mais les arbres ne montent pas au ciel, et dans un secteur à maturité comme celui de la banque universelle en Europe, il y a des limites physiques à l’expansion d’un portefeuille de crédits, sauf à accepter de mauvais risques. Il est donc préférable de rendre ces capitaux propres nouveaux, générés par les résultats, aux actionnaires de Sabadell, via des dividendes ou des rachats d’actions ; plutôt que de les employer à détruire de la valeur, soit par des pertes sur crédits défaillants, soit par des placements certes sans risque mais au taux de rentabilité bien inférieur à celui demandé par les actionnaires.
À charge pour les actionnaires de réinvestir ces capitaux propres dont Sabadell n’a pas besoin, auprès d’entreprises qui ont-elles des besoins de capitaux propres pour financer leur expansion sur des nouveaux marchés. Ainsi en souscrivant par exemple à l’augmentation de capital d’Iberdrola, l’énergéticien espagnol, qui a levé le même jour 5 Md€ pour continuer à se développer dans la construction de réseaux électriques, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Faire circuler l’argent est la meilleure garantie que ne se constituent pas des poches d’inefficience et de gaspillages ; et que ceux qui innovent, dans des secteurs en développement ou à maturité, trouvent les capitaux propres dont ils ont besoin. Dividendes et rachats d’actions ne sont que les outils au service de ce but d’une meilleure allocation possible du capital.
Commentaire : Réponses à Qui a dit quoi ?
- 1. Lorsque vous évaluez une entreprise, vous devez avoir confiance en votre valeur et vous devez avoir la foi que le prix rejoindra cette valeur. Aswath Damodaran
- 2. Les horloges sont faites pour dire l'heure et les tarifs pour dire les coûts. Marcel Boiteux
- 3. C'est probablement lorsque vous atteignez le sommet du cycle que vous êtes le plus populaire. Ken Griffin
- 4. C'est le côté humain, en pratique le côté négociation, qui m'a attiré dans la banque. Siegmund Warburg
- 5. Le déséquilibre entre les riches et les pauvres est la plus ancienne et la plus mortelle maladie de toutes les républiques. Plutarque
- 6. L'expérience montre qu'il n'est pas sage de se fier à la cupidité humaine lorsqu'elle a l'occasion de s'enrichir aux dépens d'autres personnes. Tribunal de Colombus
- 7. Mais les dividendes permettent de financer les entreprises ! Eric Lombard
- 8. L'or est la monnaie, tout le reste est du crédit. JP Morgan
- 9. Plus l'environnement financier est exubérant, plus les gens regardent quelque chose comme les cryptos et passent de la possibilité que ça marche à la certitude que ça va marcher. Et c'est là que vous avez des problèmes. Howard Marks
- 10. Le Bitcoin est une pyramide de Ponzi : vous ne pouvez gagner de l'argent que si vous trouvez un plus grand crétin pour acheter vos bitcoins plus cher que vous ne les avez acquis. Jeremy Grantham,