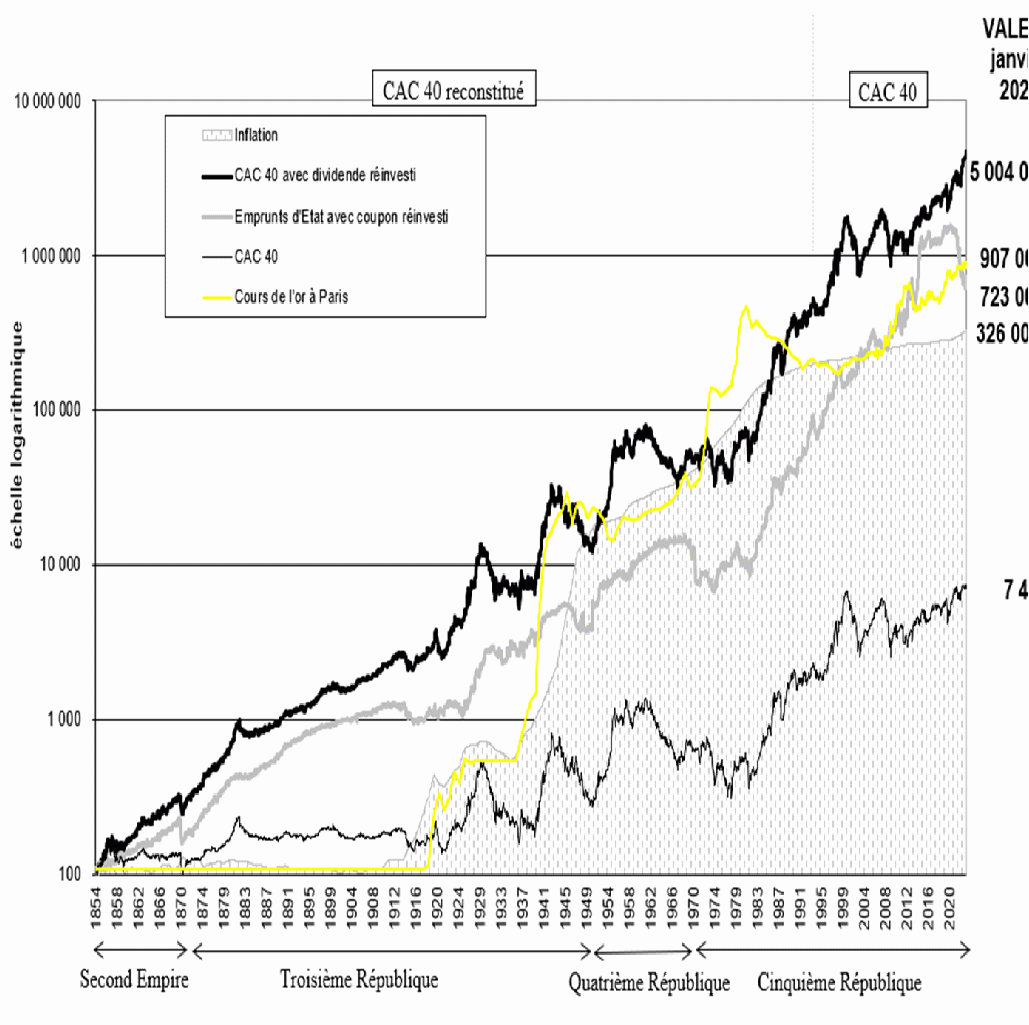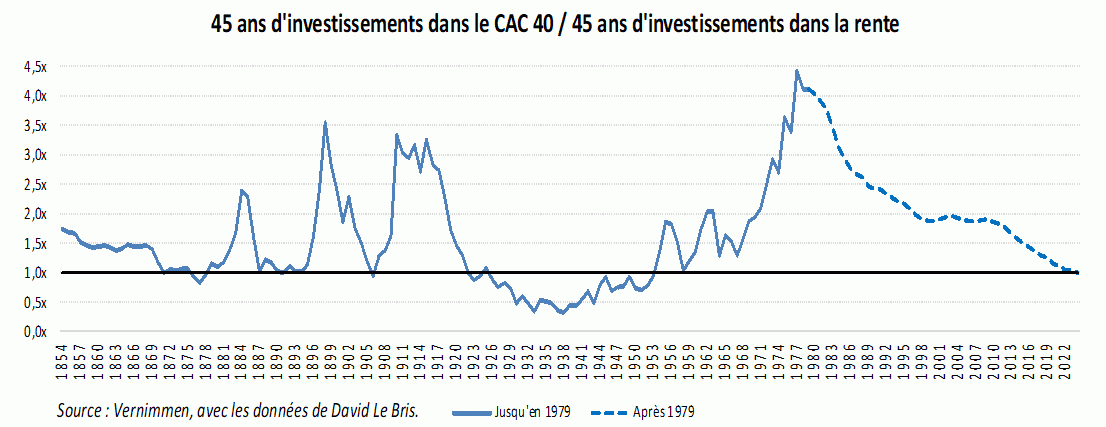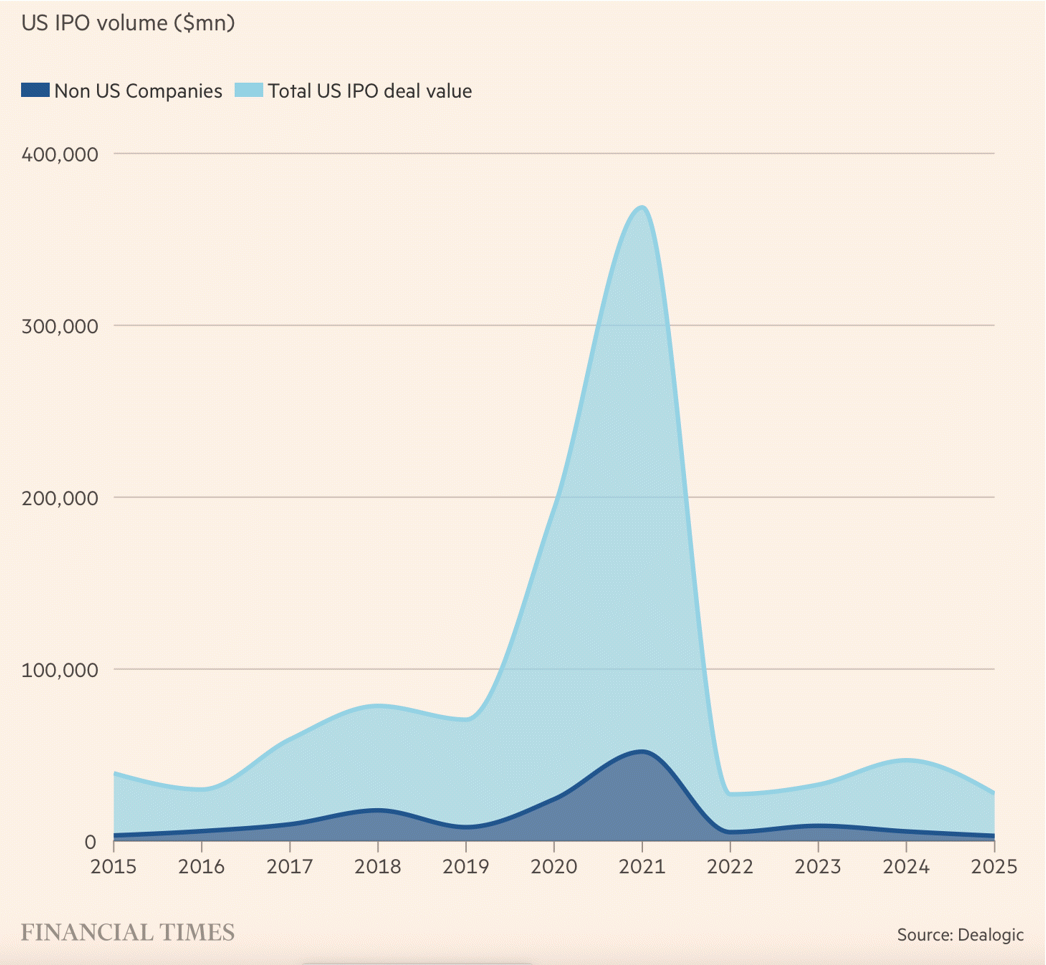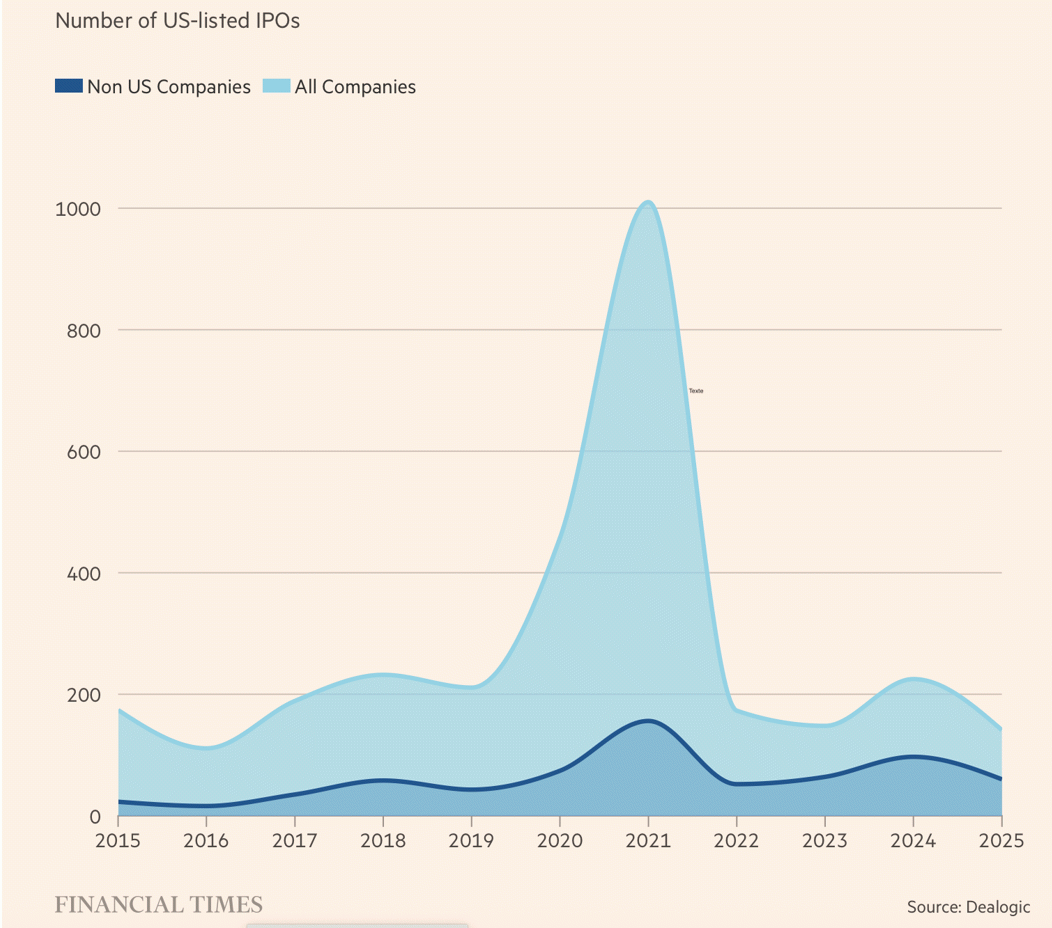La Lettre n°227 de Juin 2025
Actualités : Make equity great again ou accroître l'attractivité des marchés financiers européens (1/2)
Alors que nous mettons la dernière main à la nouvelle édition du Vernimmen qui sera disponible en librairie le 21 août 2025, nous vous livrons dans ce numéro de La Lettre Vernimmen et dans celui de juillet à venir, l’avant-propos de l’édition 2025.
L’avant-propos de l’édition 2026 sera consacré au marché du LBO, et aux difficultés auxquelles il fait actuellement face.
Les marchés financiers européens : un retard croissant par rapport à ceux des États-Unis.
De 1989 à 2009, l’indice Euro Stoxx 600 a doublé de niveau et le S&P 500 aux États-Unis a triplé de valeur. Puis de 2009 à 2024, le premier a progressé de 150 % et le second de 450 %.
En 2008, la première banque américaine, JP Morgan, capitalisait 75 Md€, et les 10 premières banques de la zone euro 7 fois plus, à environ 510 Md€ cumulés. En 2024, la capitalisation boursière de JP Morgan atteint 515 Md€, soit l’équivalent de la capitalisation boursière des 10 premières banques de la zone euro. BNP Paribas, première banque de la zone euro, capitalise moins de 70 Md€ et l’indice Euro Stoxx des banques européennes est à son niveau de début 1997.
BlackRock, le premier gestionnaire d’actifs américain, gère environ 9 700 Md€ d’actifs contre 2 100 Md€ pour Amundi, le leader européen.
Si historiquement l’écart entre les PER américains et européens était de l’ordre de 2 à 4 points, depuis 2019 l’écart moyen a bondi à 7 points (21 sur le S&P 500 contre 14 sur l’Euro Stoxx 600). Certes les taux de croissance sont plus élevés aux États-Unis, mais les taux d’intérêt le sont aussi et pourraient le rester sur le long terme, ce qui joue dans le sens inverse.
En conséquence, un certain nombre de groupes européens, principalement britanniques, et ayant une part importante de leurs activités aux États-Unis ont décidé de se faire coter aux États-Unis, plutôt qu’en Europe (Arm dans les semi-conducteurs) ou d’y transférer leur cotation boursière (CRH dans les matériaux de construction, Ferguson dans la plomberie-chauffage, etc.). D’autres ont annoncé y réfléchir (TotalEnergies, Shell et BP). L’expérience montre que la cotation aux États-Unis ne garantit pas automatiquement une revalorisation des cours. Des 14 groupes britanniques qui se sont fait coter à New-York depuis 2014, seuls 3 valent plus cher qu’avant leur transfert (et 8 ont disparu de la cote).
Les pouvoirs publics européens se sont donc inquiétés de la situation, conscients qu’un transfert de la cotation est souvent une première étape avant un transfert du management, puis du siège social. L’illustrent Linde qui serait la seconde capitalisation boursière germanique (à la page 1152), ou SLB, l’ancien Schlumberger, qui serait la 15e capitalisation boursière française (à la page 1154), si ce groupe de recherche sismique pour l’industrie pétrolière, fondé en France, n’avait pas progressivement transféré son centre aux États-Unis.
Plus généralement, et au-delà du cas emblématique de transferts envisagés de la cotation boursière de grands groupes, les pouvoirs publics européens se sont émus qu’une partie de l’épargne européenne soit investie hors d’Europe, principalement aux États-Unis. Les groupes financiers d’outre-Atlantique ont alors plus de moyens pour venir ensuite investir... en Europe, et influencer ainsi les décisions des groupes européens, que cela soit via les gestionnaires d’actifs (BlackRock, Vanguard, Fidelity, etc.), via des fonds d’investissement (KKR, Blackstone, etc.), de capital risque (Sequoia, Lightspeed, etc.).
Si l’épargne des ménages européens est ample, à environ 35 500 Md€, nourrie par un taux d’épargne de 13,3 % du revenu disponible, bon nombre d’entreprises européennes lèvent des fonds auprès des groupes financiers non européens, car elles ne trouvent pas suffisamment de fonds localement auprès des investisseurs européens. Ainsi la prometteuse start-up française de l’IA, Mistral, perçue comme le principal rival du créateur de Chat GPT (Open AI), a levé 1 090 M€ entre juin 2023 et juin 2024 en 3 tours de financement, à chaque fois dirigés par des fonds de capital-risque américains (Lightspeed, Andreesen Horowitz, DST Global et General Catalyst).
Alors que le PIB des États-Unis (environ 25 000 Md€) n’est pas si différent du PIB de l’Europe à 27 (environ 17 000 Md€), la profondeur du système financier américain est bien supérieure à celles des marchés financiers européens pour trois raisons principales : une marchéisation différente de l’économie, des systèmes de financement des retraites différents, et le morcellement des marchés financiers européens.
Le système de financement des retraites aux États-Unis est un système par capitalisation dans lequel les salariés mettent obligatoirement de côté une partie de leurs revenus investis par des fonds de pension sur le marché financier. Ces sommes investies essentiellement en actions, et capitalisées sur plusieurs décennies, seront rendues progressivement aux salariés après leur départ en retraite, sous forme de pensions, et jusqu’à leur décès.
En Europe, le modèle dominant depuis 1945 est celui de la répartition dans lequel les cotisations des retraites payées par les salariés servent à payer les pensions des retraités actuels. Même si la pérennité de ce système est menacée par l’évolution démographique (le nombre de bébés européens a baissé de 19 % depuis 2008) et le vieillissement de la population, sans parler des mesures totalement irresponsables proposées aux deux extrêmes du spectre politique français, il ne pourra pas être changé du jour au lendemain. Des systèmes complémentaires et partiels de retraite par capitalisation ont été introduits au cours du temps.
Ceci explique pourquoi seulement 17 % de l’épargne des Européens est investie en actions contre environ 45 % aux États-Unis.
Si l’un des piliers de l’Union européenne est la libre circulation des capitaux, celle-ci est dans les faits entravée par la persistance de réglementations nationales différentes, sans même parler de fiscalité, qui complexifient et compartimentent pour partie les marchés européens des capitaux : droits des affaires et des faillites différents ; absence de pleine fongibilité des dépôts, du capital ou de la liquidité des banques paneuropéennes pourtant supervisées par le régulateur européen (BCE) car les régulateurs locaux veulent garder une supervision des filiales locales de ces banques ; absence d’une Bourse couvrant les 27 pays de l’Union ; absence d’un système paneuropéen de compensation et de livraison (il y en a 18 pour la compensation et 21 pour la livraison des titres négociés en Europe), etc.
D’où des réflexions en cours (rapports Letta et Noyer) qui dessinent des voies concrètes pour continuer d’avancer vers un marché financier européen unifié et défragmenté : relancer la titrisation des prêts bancaires, particulièrement immobiliers, pour accroître la flexibilité des banques ; créer un produit d’investissement long terme paneuropéen ; assouplir le cadre réglementaire et prudentiel des banques et des compagnies d'assurances comme les États-Unis l’ont fait ; renforcer les pouvoirs de l’ESMA pour aboutir à une vraie supervision européenne des marchés de capitaux ; améliorer le fonctionnement du « post-marché ».
* * *
Ce que les Suédois ont réussi à faire
La Suède n’a que 10,5 M d’habitants, mais ceux-ci ont réussi depuis 1980 à créer un marché financier local 2,6 fois plus profond relativement à son PIB que ceux du reste de l’Europe continentale. Si bien que 16 % des entreprises suédoises de plus de 250 salariés sont cotées en Bourse, contre seulement 3 % dans l’Europe des 27 (moins de 2 % en Allemagne et 3 % en France). Dès lors, il n’est pas surprenant que le nombre des cotations nouvelles sur la Bourse de Stockholm depuis 2013 (501) dépasse sur la même période le montant cumulé des introductions en Bourse à Paris, Francfort, Amsterdam et Madrid. Seul le Royaume-Uni a fait mieux avec 765 cotations nouvelles.
Et le succès appelle le succès, avec une progression de l’indice de la Bourse de Stockholm de 85 % sur les dix dernières années, contre 49 % pour l’Euro Stoxx 600 et 17 % pour le FTSE 100 de la Bourse de Londres.
Comment ce résultat a-t-il été obtenu ?
Pas en un jour, mais avec des efforts continus de pédagogie et des avantages fiscaux temporaires, pour inciter les ménages suédois à investir en actions. Ainsi ont été créés en 1984 les Allemansfonder, littéralement « fonds pour tout le monde », investi à 100 % en actions et exonérés d’impôt, détenus dès 1990 par 1,7 million de Suédois. Les avantages fiscaux initiaux de ce produit ont disparu au profit d’un prélèvement fiscal annuel unique de 1 % du capital, ce qui incite les Suédois à faire leur marché pour éviter les mauvais investissements, afin de pouvoir faire face à ce prélèvement.
Des retraités de l’industrie financière vont expliquer dans les lycées aux jeunes de 16 à 18 ans le b.a.-ba de la finance et comment placer au mieux son épargne.
Si les avantages fiscaux ont disparu, la culture action des épargnants suédois est restée : la part des dépôts et comptes sur livret dans l’épargne financière est passée de 40 % en 1980 à moins de 20 % de nos jours ; celle des plans d’épargne retraite et des contrats d’assurance-vie a bondi de 19 % à 48 %. Alors qu’en France la part des actions dans les OPCVM est de 25 %, elle atteint 66 % en Suède. Au total, dans l’épargne financière des Suédois, les actions représentent 42 %, contre 17 % dans l’Europe des 27 (et 23 % en France).
Dans le bilan des compagnies d’assurance suédoises, la part des actions est de 48 %, contre 26 % dans l’Europe des 27 (24 % en France) ; et… 4 % au Royaume-Uni (venant de 50 % en 2000) où la capitalisation boursière des sociétés cotées est passée de 159 % du PIB britannique en 2000 à 95 % aujourd’hui.
* * *
Le retour aux fondamentaux
Nous devons au travail de bénédictin de David Le Bris le graphique suivant qui montre l’évolution d’un placement de 100 au 1er janvier 1854, soit dans le CAC 40 (ou équivalent) avec réinvestissement des dividendes, soit dans l’emprunt d’État (la rente) avec réinvestissement des coupons jusqu’en 2023, avec aussi le comportement de l’inflation. Nous attirons l’attention de notre lecteur sur le fait que l’échelle est logarithmique afin que les paraboles des placements capitalisés au long cours deviennent des quasi-droites facilitant la lecture.
On peut tirer deux enseignements de ce travail de recherche, conformes à ce que l’intuition et la théorie enseignent : sur une longue période, la rentabilité d’un placement en actions a battu celle d’un placement dans la rente ; et l’investissement en actions a été plus risqué que celui dans la rente comme en témoigne une volatilité plus grande du placement dans le CAC 40.
Par ailleurs, notre lecteur qui regardera de près ce graphique, par exemple pour voir la grande crise de 1929 ou celle de 2008, se rendra compte que ce qui a été sur le coup d’un point de vue financier (et pas uniquement, tant s’en faut) un traumatisme, se voit finalement à peine quelques années plus tard et se verrait encore moins si nous avions adopté une échelle linéaire et non logarithmique.
Certes, l’investisseur qui a investi en septembre 1929 et qui revend en septembre 1939 a perdu la moitié de son investissement ; celui qui a investi en juin 2007 et qui revend en mars 2008 en a perdu 58 %. Mais outre la malchance d’investir au plus haut temporaire du marché actions et de revendre au plus bas définitif du marché actions, ce comportement correspond à celui d’un joueur, et non d’un épargnant qui, pour sa retraite, investit de manière lissée tout au long de sa vie active.
Aussi nous avons calculé, grâce à la base de données de David Le Bris, ce qui serait arrivé à un épargnant qui, en 1854, aurait investi la somme de 100 chaque année pendant 45 ans, soit dans le CAC 40 dividendes réinvestis, soit dans la rente coupons réinvestis ; et avons fait le rapport des sommes ainsi capitalisées au bout de 45 ans. Puis nous avons répété l’exercice chaque année de 1854 à 2023, les dernières années (en pointillé) en nous limitant à moins de 45 ans, n’ayant pas le don de divination des cours futurs. Dans le graphique suivant, figure, pour chaque année de début d’investissement, le ratio entre la valeur de 45 années d’investissement de 100 par an dans le CAC 40 divisée par la valeur de 45 années d’investissement de 100 par an dans des obligations d’État (rente) :
Ce graphique se lit ainsi : l’épargnant qui a commencé à investir en 1854 disposera 45 ans plus tard d’une somme 1,7 supérieure s’il a investi dans un placement actions versus un placement en rente. Ce sera seulement de 0,9 fois pour celui qui a commencé en 1906, car le niveau du CAC 40 de 1929 n’est définitivement dépassé qu’en 1951, mais de 4,4 fois pour celui qui a commencé en 1977.
Au-delà de 1979 (2024 – 45 = 1979), nous avons poursuivi la courbe, mais avec un nombre d’années en réduction naturellement, jusqu’à ne plus représenter qu’un an d’investissements en 2023. Dans ces conditions, il est logique que la courbe en pointillés sur la droite converge vers un, puisqu’il y a de moins en moins de temps pour capitaliser sur la différence de rentabilité moyenne entre un placement actions et un placement obligations.
Autrement dit, entre 1854 et 1979, l’investissement d’une même somme chaque année sur le marché actions a permis à l’épargnant d’obtenir un montant d’épargne supérieur à celui qu’il aurait obtenu en investissant en rente (obligations d’État) dans 71 % des cas. Ce taux serait quasiment égal à 100 % sans la crise économique et financière de 1929, et la Seconde Guerre mondiale 10 ans après.
En introduisant progressivement une part croissante d’obligations dans le portefeuille quelques années avant son échéance comme le font les gestionnaires de fonds de retraite,
les résultats auraient été moins sensibles à la performance des actions les dernières années, les pics et les creux auraient été moins marqués. D’un autre côté, celui qui le plus perdu dans notre simulation, l’investisseur qui commence en 1938 et s’arrête en 1983 avec un portefeuille action valant un tiers du portefeuille obligataire, rate la grande reprise du marché actions qui s’enclenche justement cette année.
Notons que le risque aurait été réduit si nous avions géographiquement diversifié le portefeuille au lieu de l’avoir concentré sur le CAC 40, même si l’on peut se dire que les composants du CAC 40 sont actuellement infiniment plus internationaux (de l’ordre de 85 % de leurs ventes est fait hors de France) qu’ils ne l’ont jamais été, ce qui contribue à l’amélioration de la performance sur les dernières décennies.
La suite et la fin de cet article seront publiées dans La Lettre Vernimmen de juillet 2025.
Tableau : Les introductions en Bourse aux États-Unis
Initialement publiés par le Financial Times, ces deux graphiques montrent que si les montants levés aux États-Unis lors des introductions en Bourse par des sociétés non américaines sont assez marginaux en montants (de 10 à 20 % du total), sauf en 2021 du fait de l’entrée sur le marché new-yorkais du britannique Arm, en nombre d’opérations, la situation est différente :
En effet autour de 40 % des sociétés introduites aux États-Unis sont d’origine étrangère (le pic de 2021 est dû aux SPAC). Le niveau des multiples d’évaluation plus élevé, le PER moyen de l’EuroStoxx 600 est de 17, contre 26 pour le S&P 500, est naturellement le premier facteur de marketing et d’attractivité, même s’il ne faut pas prendre les investisseurs américains pour des grands enfants : le seul fait d’être coté aux États-Unis ne vous garantit pas une valorisation à l’américaine si vous n'avez pas une croissance… à l’américaine !
Ainsi le cours d’Amrize, filiale issue de la scission des activités nord-américaines d’Holcim, a-t-il ouvert en baisse lors de sa première cotation ce 23 juin ; ne faisant pas apparaître de création de valeur du fait de cette scission, et donc de meilleure valorisation pour ses actifs nord-américains.
Recherche : Coût du capital et taux d'actualisation : un écart qui explique le sous-investissement des entreprises
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
L’article que nous présentons ce mois[1] porte sur l’un des fondamentaux de la finance d’entreprise : le taux d’actualisation retenu lors des choix d’investissement. La théorie dominante prescrit d’investir dans les projets à VAN positive, en utilisant un taux d’actualisation reflétant le risque du projet. Si ce risque est en ligne avec celui de l’activité habituelle de l’entreprise, le taux d’actualisation pertinent est le coût du capital. De manière équivalente, un projet est créateur de valeur lorsque son taux de rentabilité interne (TRI) est supérieur au coût du capital[2]. Toutes choses égales par ailleurs, une hausse du coût du capital doit donc se traduire par une baisse du volume des investissements, et inversement.
Depuis le début des années 2000, c’est à une baisse significative du coût du capital que l’on a assisté, sans pour autant que les investissements augmentent dans les proportions prévues par la théorie. Il existe ainsi une forme de sous-investissement général, parce que le taux d’actualisation s’est progressivement écarté du coût du capital, en ne diminuant pas au même rythme.
Conceptuellement, l’article distingue trois taux qui sont supposés être égaux dans les modèles standards de marchés à l’équilibre :
- Premièrement, le coût du capital financier représente le véritable taux auquel il faudrait comparer les TRI des projets pour décider des investissements. Ce coût du capital[3] correspond à la moyenne du coût des capitaux propres et du coût de la dette financière, pondérée selon la structure financière de l’entreprise.
- Deuxièmement, il existe un coût du capital perçu, qui peut différer du coût réel par exemple par difficulté de calcul. L’écart entre coût financier et coût perçu est dénommé « décalage du coût du capital » par les auteurs.
- Troisièmement, le taux d’actualisation utilisé peut différer du coût du capital perçu, notamment par prudence ou par crainte que la VAN ne reflète pas tous les coûts (comme les frais administratifs fixes).
L’écart entre le taux d’actualisation et le coût du capital perçu est dénommé dans l’article « décalage du taux d’actualisation ». Ainsi, le décalage total entre coût du capital financier et taux d’actualisation est la somme du décalage du coût du capital et du décalage du taux d’actualisation.
Pour identifier les coûts perçus et le taux d’actualisation utilisés, les auteurs ont étudié les communiqués[4] d’entreprises cotées dans le monde entier entre 2002 et 2021. Au total, alors que l’écrasante majorité des dirigeants utilisent un taux d’actualisation dans leurs choix d’investissement, via la VAN ou le TRI, seules 3 % des communications en font mention explicite. Les auteurs parviennent tout de même à un échantillon final de plus de 2 500 grandes entreprises dans 20 pays différents.
L’échantillon permet de mesurer les évolutions au niveau de chaque entreprise. Le premier résultat est le suivant : si le coût du capital perçu ne correspond pas exactement au coût du capital financier, les différences sont faibles. Surtout, les variations du coût du capital financier sont rapidement transmises au coût perçu. Le décalage du coût du capital est donc négligeable.
En revanche, le décalage du taux d’actualisation est important. Autrement dit, les dirigeants sont conscients des variations du coût du capital financier, mais ils ne l’incorporent pas correctement à leurs décisions d’investissement. Sur les vingt dernières années, la baisse du coût du capital financier ne s’est transmise qu’avec retard aux taux d’actualisation. Dans un délai de deux ans après la variation du coût du capital, aucune variation du taux d’actualisation n’est statistiquement observable. Dans 80 % des cas, le taux d’actualisation est resté exactement le même.
Après trois ou quatre ans, seul le quart de la variation est transmis (une baisse de 1 % du coût du capital se traduit par une baisse de 0,25 % du taux d’actualisation trois ans plus tard). Il faut plus de dix ans pour que la variation soit totalement incorporée au taux d’actualisation.
Cet ajustement lent des taux d’actualisation permet d’expliquer le sous-investissement observé sur cette période. Le coût du capital ayant diminué surtout après 2010[5], le taux d’actualisation retenu sur la période est resté trop élevé. Sur l’ensemble de l’échantillon, il aurait dû être inférieur d’environ 2,5 points de pourcentage. Les auteurs vérifient que ce taux d’actualisation trop élevé correspond mathématiquement au sous-investissement observé par rapport aux modèles standard.
Pour conclure, les dirigeants d’entreprises sont conscients des variations du coût du capital, et pourtant ils ne les incorporent pas (ou très lentement) à leurs taux d’actualisation. En conséquence, sur les vingt dernières années, ils investissent trop peu, et leurs décisions d’investissement sont trop peu sensibles aux variations du coût du capital.
La raison de ce comportement reste à identifier. Le plus souvent les dirigeants expliquent cet écart par une volonté de prudence. Les auteurs de l’article constatent que le décalage (et donc le sous-investissement) est plus élevé dans les entreprises disposant d’un fort pouvoir de marché. Ils suggèrent que le coût du décalage (renoncement à des projets créateurs de valeur) est plus supportable lorsque la concurrence est limitée.
[1] N.J. Gormse et K. Huber, « Corporate Discount Rates », American Economic Review juin 2025, vol. 115, no 6, pages 2001 à 2049.
[2] Il s’agit ici de l’équivalence entre les critères de la VAN et du TRI pour déterminer si un projet doit ou non être entrepris. Notons que l’article raisonne sur la masse totale des investissements de chaque entreprise sans prise en compte d’éventuelles variations des risques.
[3] Aussi appelé coût moyen pondéré du capital (CMPC) ou Weighted Average Cost of Capital (WACC) en anglais.
[4] « Conference calls » en anglais
[5] Comme notre lecteur peut le constater à la lecture du graphique du § 28.22 du Vernimmen 2025.
Q&R : Comment traiter en évaluation la trésorerie minimum requise réglementairement pour une société de gestion ?
Les régulateurs des sociétés de gestion d’actifs pour le compte de tiers imposent que ces dernières bloquent une fraction de leur trésorerie correspondant à plusieurs trimestres de leurs coûts opérationnels, afin d’assurer leur solvabilité.
Dans ce cadre, il nous paraît logique de traiter ces sommes, non comme de la trésorerie, mais comme un investissement nécessaire à l’activité, de même nature qu’une immobilisation.
Les sommes ainsi bloquées ne figureront pas dans le passage de la valeur de l’actif économique à la valeur des capitaux propres, dans les approches indirectes d’évaluation.
Corrélativement, les variations requises d’une année sur l’autre dans le montant de la trésorerie réglementairement bloquée seront considérées comme des investissements, et viendront ainsi en moins dans le calcul des flux de trésorerie disponible.
Enfin, les produits financiers obtenus sur cette trésorerie bloquée seront parallèlement ajoutés aux produits d’exploitation. À défaut, il serait fait totalement abstraction de la trésorerie bloquée en valeur, comme si elle était tombée dans un trou noir. Cette société de gestion vaudrait alors autant qu’une société de gestion similaire en tout point de vue, mais sans trésorerie réglementaire bloquée, et donc en infraction avec son régulateur, ce qui est absurde.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
Euronext, après la honte, le déshonneur (7 juin)
Euronext avait bloqué le retrait de cote de la foncière MAB à l’issue d’une offre où, première depuis au moins 30 ans, aucun titre n’a été apporté, et avec un cours final de 22 % au-dessus du prix de l’offre.
Pour réussir cet exploit, une expertise fort accommodante avait été délivrée par Paper Audit et Conseil aboutissant à valoriser les actifs immobiliers à un prix moyen de 321€/m2, soit 80 % du prix de vente de son plus mauvais actif. Et pourtant MAB écrit sur son site internet : « MAB, un portefeuille immobilier d’exception ».
Cette étude, dépourvue de toute expertise immobilière par actif, autre première dans un retrait de cote, avait été soumise à Euronext qui, soit ne l’avait pas lue, soit n’avait pas remarqué l’erreur monumentale de l’expert valorisant ainsi les capitaux propres : PER x Résultat net – Endettement, aboutissant ainsi à compter ce dernier 2 fois.
Sous la pression des actionnaires minoritaires, Euronext a demandé à l’expert un rapport complémentaire. Celui-ci est une tartufferie. On y apprend ainsi :
- qu’il n’est pas possible de valoriser les bâtiments de MAB par comparaison avec des ventes similaires d’autres entrepôts ou locaux d’activité, car il n’en existe pas de similaire. Vous devez halluciner quand vous en voyez le long des routes ! Mais de toute façon « l'approche des comparables ne peut pas être mise en œuvre sauf à surévaluer de façon manifeste son parc immobilier » ; surévaluer par rapport à cette pseudo expertise, bien sûr ;
- que le décret tertiaire est un « cygne noir » ! Il en faut bien un pour justifier que 100 M€ d’investissements entre 2024 et 2035, soit plus que la société a investi à ce jour, se traduisent par… une stabilité des loyers ! Et pourtant, MAB écrit sur son site internet : « MAB continue de renforcer sa position dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, affichant une croissance solide et des perspectives prometteuses » ;
- que l’erreur monumentale de compter 2 fois la dette est une simple « coquille » !
Au bout de 4 mois dans lesquels Euronext a :
- refusé de recevoir les actionnaires minoritaires ;
- refusé de demander à MAB les valeurs d’assurance de ses bâtiments qui auraient fourni une comparaison utile ;
- refusé de demander à MAB le courrier annuel envoyé à ses banques avec son estimation de la valeur de ses actifs, qui est plus de 2 fois supérieure à celle de l’expert ;
- refusé de communiquer aux actionnaires minoritaires le rapport complémentaire de l’expert, au mépris du contradictoire le plus élémentaire ;
Euronext a prononcé la radiation de MAB effective depuis le 6 juin.
À l’AG du 27 juin, l’actionnaire majoritaire de MAB votera la révocation du directeur général, dans l’entreprise depuis 25 ans, grand professionnel reconnu de l’immobilier, artisan probe de sa création de valeur. Son seul tort est de ne pas avoir apporté ses titres à une offre soutenue par un rapport qui n’a d’expertise que le nom et, in fine, par Euronext qui n’a pas craint d’ajouter le déshonneur à la honte.
Rappelons que l’un de nous deux, Pascal Quiry, est actionnaire de MAB depuis 2020.