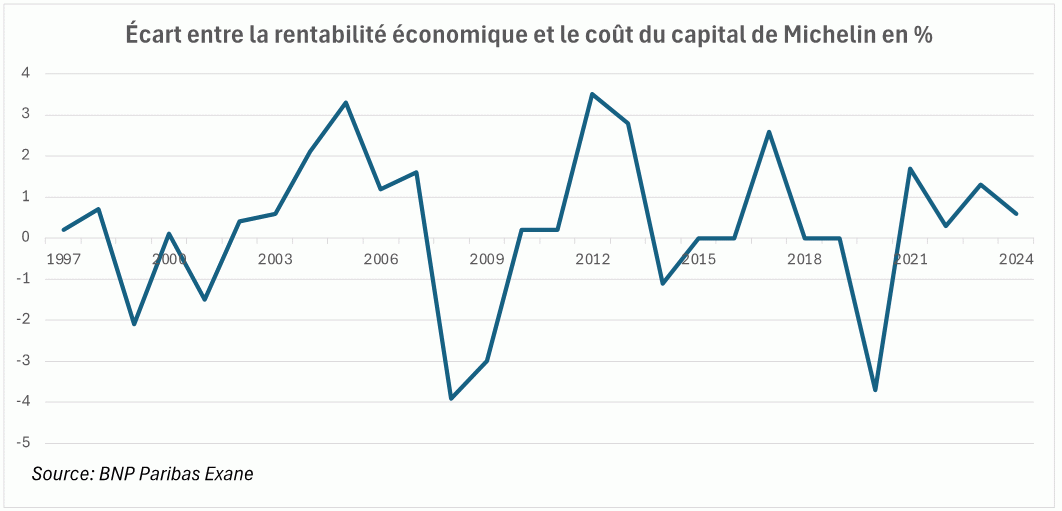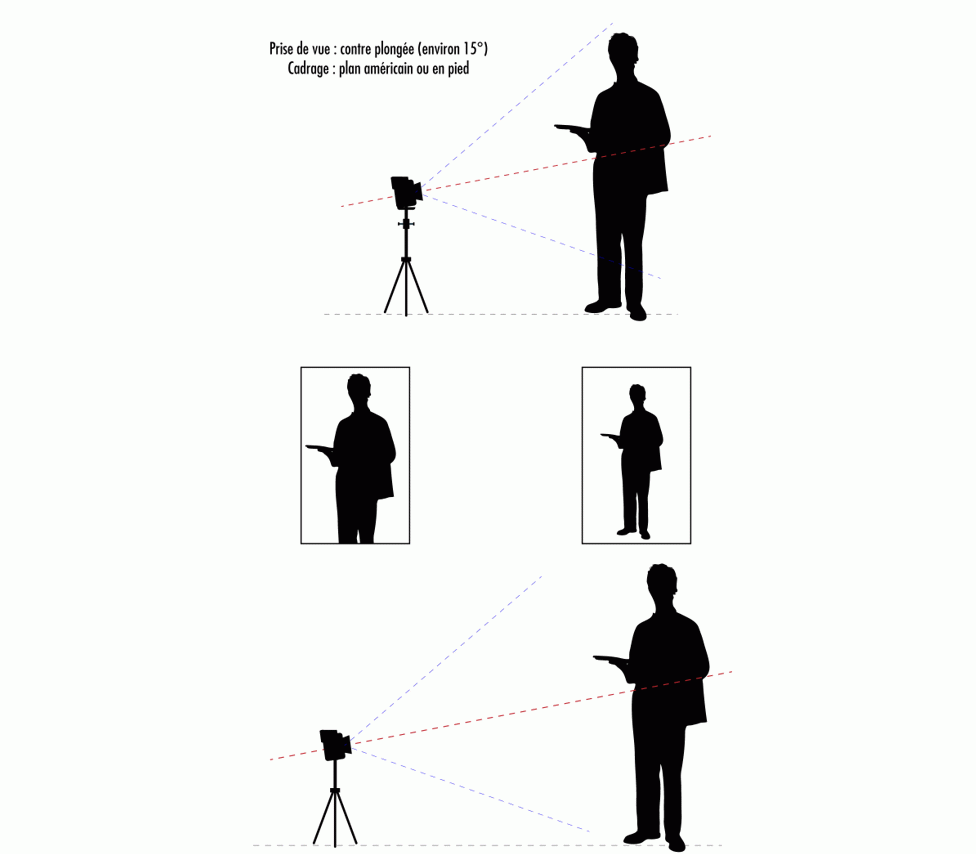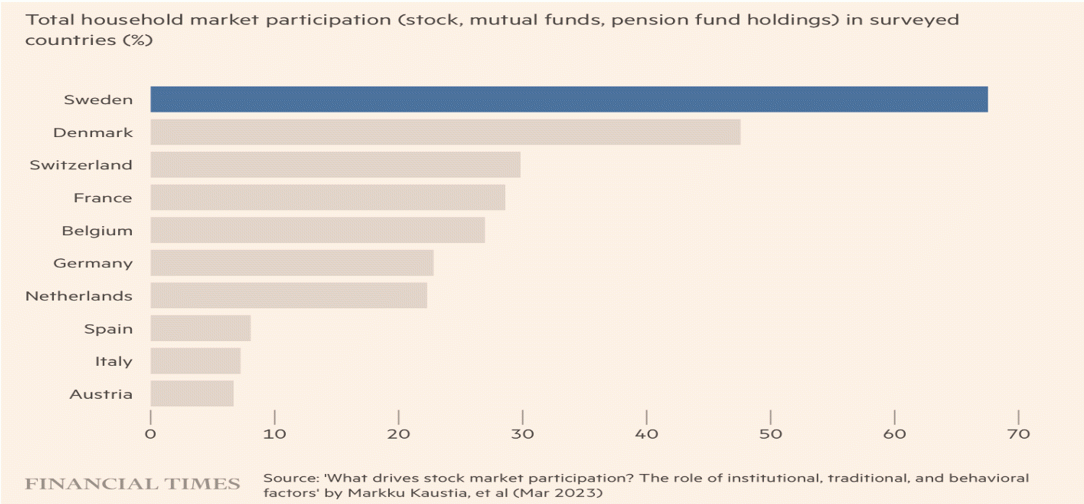La Lettre n°226 de Mai 2025
Actualités : Interdire les licenciements économiques si l'on a versé des dividendes ou réalisé des profits ?
Le groupe socialiste au Sénat a déposé une proposition de loi visant à limiter le recours au licenciement économique dans les entreprises d’au moins 250 salariés ; et la rapporteure de la Commission des affaires sociales a souhaité échanger avec l’un de nous deux. D’où cet article.
La proposition de loi prévoit qu’une entreprise ne pourrait procéder à des licenciements économiques si, au cours de l’année précédente, elle avait versé des dividendes, attribué des stock-options ou des actions gratuites, réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif, ou bénéficié d’un crédit d’impôt recherche.
Avec la combinaison des critères de CIR ou de résultat positif, c’est la quasi-totalité des entreprises françaises de plus de 250 salariés qui se verraient ainsi interdire la possibilité de procéder à des licenciements économiques ; sauf à attendre un an de plus, ET à la condition expresse alors de ne pas demander de CIR, ET de ne pas faire de résultats positifs, ET de ne pas distribuer de dividendes, ET de ne pas attribuer des actions gratuites ou des stock-options.
Il serait aisé de balayer d’un revers de main ce texte, tant certaines dispositions prévues dans la proposition de loi semblent hors sol. On peut comprendre que la proximité temporelle du versement de dividendes, qui laisse supposer que l’entreprise se porte bien, et des licenciements économiques[1] paraissent en contradiction pour des personnes n’ayant pas ou pas beaucoup d’expérience de la vie des affaires.
On comprend moins en quoi les outils de partage de la valeur au sein de l’entreprise que sont les stock-options ou les attributions d’actions gratuites, qui n’affaiblissent pas sa trésorerie, devraient restreindre la liberté de gestion des entrepreneurs qui inclut la faculté de licencier. Quant au crédit d’impôt recherche, créé en 1983, son instauration et son développement ne résultent pas une libéralité de l’État au profit des entrepreneurs, mais du souhait des législateurs et des gouvernements de garder sur le territoire national des activités de recherche et développement significatives, perçues comme stratégiques pour l’avenir du pays, mais pénalisées par un coût du travail in fine plus élevé qu’ailleurs en raison de mesures (35 heures de travail hebdomadaire, durée d’indemnisation du chômage de 18 à 27 mois, retraite à 62,5 ans actuellement) que l’on ne veut pas éliminer par ailleurs, et qu’aucun autre pays n’a adoptées. D’où des mécanismes de compensation comme le CIR.
* * *
Pourquoi une entreprise pourrait-elle ressentir le besoin de procéder à des licenciements économiques, alors qu’elle a versé des dividendes l’an passé ? Parce que les dividendes versés l’an passé sont fonction des résultats d’il y a deux ans, et qu’en 18 mois une conjoncture économique peut changer du tout au tout nécessitant d’adapter la voilure à un monde différent. 18 mois, c’est moins que la durée entre les derniers confinements (avril 2021) et la flambée des prix de l’énergie déclenchée par l’invasion de l’Ukraine (février 2022), ou qu’entre le retour à la normale des prix de l’énergie (début 2024) et l’explosion des droits de douane aux États-Unis (avril 2025), ou plus lointain entre la fin de la crise financière de 2007-2009 et le début de la crise de l’euro en 2011.
Une des entreprises non cotées dont nous sommes actionnaires a versé un petit dividende en 2020, au titre de ses résultats 2019 qui étaient largement positifs (17 % des résultats). Pourquoi ? Parce que son dirigeant l’était devenu en achetant 30 % du capital aux anciens actionnaires, et qu’à 40 ans, il avait dû s’endetter pour cela. Ce petit dividende lui permettait d’honorer l’échéance du crédit mis en place à son niveau. 15 mois après, en septembre 2021, face à un effondrement du carnet de commandes, ce dirigeant réagit vite, licencie 34 % de ses effectifs, entre en conciliation avec ses créanciers pour étaler ses dettes (PGE et crédits bancaires classiques), et en sort en moins de 6 mois. 3 ans après ses effectifs ont triplé, car avec une base plus légère, l’entreprise a pu repartir de l’avant, explorer de nouveaux marchés, conquérir de nouveaux clients, avec des talents et des compétences différents pour une bonne part.
Si elle avait dû attendre 6 mois, parce qu’elle avait versé un dividende l’exercice d’avant, l’empêchant donc de licencier, elle serait morte, parce que lorsqu’une entreprise est face à une contraction forte de son activité, sa survie dépend de sa vitesse de réaction qui se compte en semaines, pas en trimestres ou semestres. C’est d’ailleurs ce que le co-auditionné, l’administrateur judiciaire Frédéric Abitbol, a confirmé à la rapporteure.
Pourquoi une entreprise pourrait-elle ressentir le besoin de procéder à des licenciements économiques, alors qu’elle a réalisé des résultats positifs ? Parce que faire des profits ne suffit s’ils ne sont pas mis en relation avec les capitaux qui ont été investis afin de dégager une rentabilité en relation avec les risques pris. N’oublions pas que les entreprises sont en concurrence sur plusieurs marchés en parallèle. Bien sûr d’abord ceux où elles exercent leur savoir-faire, mais aussi ceux de l’emploi, et celui des investisseurs. Ces derniers ont en permanence des dizaines de milliers d’opportunités d’investissement (en se limitant aux entreprises cotées), et défendent leur patrimoine en cherchant en permanence le meilleur couple risque/rentabilité. Leur pouvoir est d’allouer ou non des capitaux, soit en souscrivant à des augmentations de capital, soit en acquérant des titres à d’autres investisseurs dont ils font le relais à un prix qui reflète les performances économiques et financières de l’entreprise.
Prenons l’exemple de Michelin dont les 7 500 licenciements économiques avaient défrayé l’actualité en 2000, et qui a annoncé des réductions d’effectifs de 1 255 personnes en 2026 à Vannes et Cholet avec fermeture des 2 usines. On se rappelle qu’à l’époque le premier Ministre, ancien trotskiste devenu socialiste, avait calmement expliqué « qu’il ne faut pas tout attendre de l’État ou du gouvernement » à ceux qui voulaient que ces licenciements soient interdits. De 1997 à 2024, Michelin a eu une rentabilité économique (après impôt sur les sociétés) plus élevée de 0,3 %, en moyenne que son coût du capital, c’est-à-dire le taux de rentabilité que demandent ses actionnaires et ses prêteurs sur les 26 Md€ qu’ils lui ont confiés (son actif économique) :
Factuellement les licenciements de Michelin de 2000 ont permis de redresser une situation délicate pour le groupe, mais ne lui ont pas permis, compte tenu de l’intensité concurrentielle de son secteur d’obtenir des surrentabilités durables, puisque le surplus moyen est resté ensuite stable à 0,3 %.
On pourrait considérer que les pertes supportées à Vannes et Cholet, ou l’insuffisante rentabilité de ces actifs, à échelle du groupe Michelin, sont de peu de conséquences. Probablement. Mais à répéter ce raisonnement, et pourquoi ne serait-il pas répété, on met l’entreprise en péril. Non pas qu’elle aille nécessairement directement à la faillite de ce fait, mais elle affaiblit son autofinancement par rapport à celui de ses concurrents, et entre dans une spirale de sous-performance qui, en se cumulant dans le temps, aboutit à sa marginalisation, voire à sa disparition comme entité indépendante.
Certes le résultat d’exploitation estimé de Michelin en 2025 peut paraître très élevé à 3 183 M€. Mais après impôt à 24 % en moyenne et sur un actif économique de 26 Md€, cela donne 9,1 % de rentabilité économique, soit peu ou prou son coût du capital actuel de 9,3 %.
Le fait que la comptabilité n’aide pas à la compréhension de la performance des entreprises en incluant au compte de résultat la rémunération des prêteurs, mais pas le coût des capitaux propres est sûrement une grande déficience pour l’éducation des néophytes en ce domaine.
* * *
On pourrait renverser la problématique et se dire qu’une entreprise qui aurait licencié ne pourrait pas l’année suivante verser de dividendes, comme une punition à payer pour satisfaire la fraction de l’opinion publique mal formée sur ces sujets.
La rapporteure avait d’emblée de jeu évoqué cette piste avant de l’esquiver quand nous avons voulu l’aborder sur le fond.
Cette possibilité serait moins pire que la précédente si l’on peut dire. Mais elle n’est pas sans poser au moins deux problèmes :
- Comment faire pour les filiales de groupes versus les entreprises indépendantes ? Si une filiale d’un groupe a licencié et qu’elle ne verse pas de dividende à sa maison mère, cette dernière n’aura pas de difficulté, via un compte courant, à prélever la trésorerie nécessaire l’année suivante au versement de son propre dividende. Mais l’entreprise indépendante sera, elle, tenue par la loi et ne pourra pas distribuer. Faudrait-il donc mettre un seuil de significativité dans les groupes, par exemple 10 % des effectifs et la loi ne s’appliquerait qu’en cas de licenciements supérieurs à ce seuil ?
- Comment fait-on avec des groupes étrangers ? Voit-on le groupe HSBC cesser de verser des dividendes pendant un an parce qu’il a licencié en France ? Ou va-t-on par réalisme se limiter aux seuls groupes français, les pénalisant une nouvelle fois par rapport à leurs concurrents étrangers, non soumis à cette disposition ? Rappelons que les banques européennes ont beaucoup souffert dans leur statut boursier quand la BCE leur a interdit de verser des dividendes en 2020, même si elles étaient largement au-dessus de leurs capitaux propres minimum réglementaires. Effectivement, effet de clientèle jouant, leurs actionnaires des banques le sont essentiellement pour percevoir des dividendes afin de faire face à leurs propres contraintes (fonds de pension, fonds de distribution).
* * *
Deux réflexions finales sur cet échange :
- À aucun moment la question de quel est le problème que cette proposition de loi est supposée résoudre n’a été abordée par la rapporteure, à savoir pourquoi le taux de chômage français est-il plus élevé que celui de ses principaux partenaires économiques : France : 7,3 %, Italie : 6 %, Royaume-Uni : 4,5 %, États-Unis : 4,2 %, Pays-Bas : 3,9 %, Allemagne : 3,5 %, Pologne : 2,7 %.
Ce qui nous paraît clair est que si cette proposition de loi devait être adoptée en l’état, l’effet serait sûrement inverse de celui recherché de bonne foi par ses auteurs. Les entreprises françaises auraient alors toutes les bonnes raisons du monde d’aller implanter leurs activités hors de France, pour exporter depuis l’étranger vers la France leurs produits et services, au détriment de l’emploi en France.
- À aucun moment la rapporteure ne s’est interrogée pour savoir, si cette mesure étant si bonne, pourquoi aucun des pays qui nous entoure ne l’a jamais mise en place.
Par manque de connaissances économiques de base, 65 sénateurs raisonnent comme si la France était à l’abri de frontières et de droits de douane comme elle l’était avant 1957 ; et comme si mettre des contraintes supplémentaires aux seules entités créant des richesses significatives dans le pays pouvait réduire le chômage.
À voir la réaction finale de la rapporteure, il semble que le sujet n’est pas de réduire le chômage, mais d’afficher une mesure qui donne une satisfaction au moins temporaire à des électeurs. N’étant pas idiots ni aveugles, ils seront tôt ou tard dépités par les effets contraires de ceux attendus, mais si prévisibles, et nourriront les camps des extrêmes.
On ne gagne rien, nous semble-t-il, à ne pas éduquer ses concitoyens quand on est en position de le faire. Aussi avons-nous rappelé à la rapporteure que l’inflation en France avait disparu pour 30 ans quand un ministre socialiste de l’économie en 1984, avait supprimé définitivement le contrôle des prix par l’État qui était supposé mettre en échec l’inflation et qui la nourrissait pour partie. De la même façon, on ne lutte pas contre le chômage en interdisant très largement par une voie détournée les licenciements économiques.
[1] Les licenciements économiques sont justifiés par des difficultés économiques dues à mutations technologiques ou des marchés de l’entreprise. Ils ne sont pas d’ordre personnel comme des licenciements individuels pour faute ou inaptitude.
Actualités : FIGURER SUR LA COUVERTURE DU PROCHAIN VERNIMMEN ?
Nous proposons à ceux de nos lecteurs qui seraient désireux de figurer sur la couverture de la prochaine édition du Vernimmen d’adresser leur photo à notre éditrice[1], la photo devant être prise selon les spécificités indiquées ci-contre.
Elles remplaceront à ne pas en douter avantageusement des photos issues d’une intelligence artificielle lambda. Toutes ne pourront probablement pas être sélectionnées ; et nous nous engageons bien sûr à recueillir votre accord formel avant de signer le bon à tirer de la couverture que nous vous transmettrons alors en avant-première.
[1] m.vimont@lefebvre-dalloz.fr
Tableau : L'exposition du patrimoine des ménages aux marchés actions
Initialement publié par le Financial Times, et tiré d’une étude académique, ce graphique a l’intérêt de montrer l’exposition totale des ménages, directe et indirecte, dans les principaux pays de l’Europe continentale aux marchés actions.
Que les Suédois soient pour les deux-tiers d’entre eux investis en actions, contre 30 % seulement au mieux dans les autres grands pays européens n’est pas l’effet du hasard. C’est celui d’une politique constante qui débute au début des années 1980, au moment où le marché boursier était dans ses plus bas, ce qui la facilita bien sûr, avec deux branches : la pédagogie pour former les citoyens aux outils financiers de base ; la fiscalité avec des fonds actions dotés temporairement d’avantages fiscaux pour amorcer le mouvement et supprimer dans un second temps.
On ne pourra qu’être frappé par la persistance dans ce domaine aussi de caractéristiques différentes entre l’Europe du Nord et du Sud, ou entre l’Europe de culture protestante et l’Europe de culture catholique.
Recherche : Biodiversité et finance : le succès de la finance blended et le besoin d'instruments de mesure
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Parmi les grands enjeux environnementaux, la lutte contre le changement climatique a donné lieu à une mobilisation croissante du monde financier. La « décarbonation des portefeuilles » est désormais un objectif affiché par nombre d’investisseurs, facilitée par des outils de mesure relativement bien établis (bilan carbone, scénarios de transition, alignement avec l’accord de Paris…)[1]. En revanche, la protection de la biodiversité reste difficile à intégrer dans la décision financière. L’absence de métriques partagées, la complexité des chaînes écologiques, et le caractère souvent local et diffus des impacts freinent la construction de produits d’investissement adaptés.
Pourtant, les enjeux sont considérables. Les services écosystémiques – pollinisation, régulation des eaux, stockage du carbone, fertilité des sols – sont essentiels au fonctionnement de l’économie. Selon les Nations unies, plus de 50 % du PIB mondial dépend directement du bon état des écosystèmes naturels.
L’étude présentée ce mois[2] est, à notre connaissance, la première publication majeure sur le thème du financement de la biodiversité. L’objectif des auteurs est double. D’abord, proposer un cadre de réflexion sur les conditions permettant à des investisseurs privés de participer au financement de projets de conservation ou de restauration de la biodiversité. Ensuite, à partir d’une (petite) base de données de financement de projet, commencer à évaluer la performance financière et écologique de ces projets selon leur mode de financement.
La difficulté centrale lorsque l’on veut associer biodiversité et finance est la monétisation de la biodiversité, c’est-à-dire la capacité à associer un projet écologique à des retours économiques. Les exemples sont variés : préserver les pollinisateurs améliore les rendements agricoles ; restaurer une forêt génère des crédits carbone valorisables sur les marchés ; sauvegarder un environnement favorable au tourisme… Dans beaucoup de cas, le retour économique n’est pas suffisant pour attirer les investisseurs privés, même lorsqu’ils sont soucieux de l’environnement. Surtout, l’impact écologique est plus difficilement mesurable que le taux d’émission de CO2 d’une usine. Pour cette raison, c’est souvent la finance blended qui est mobilisée : une structure mêlant capitaux privés et capitaux publics ou philanthropiques, qui vise à améliorer le couple rendement-risque pour l’investisseur privé (via garanties, subventions, priorités de remboursement…)[3].
Le cadre conceptuel construit par les auteurs consiste à mettre les investisseurs face à un choix tridimensionnel entre rentabilité, risque et biodiversité. Toutes choses égales par ailleurs, les investisseurs préfèrent plus de rentabilité, moins de risque, et plus de biodiversité (ou d’actions favorables à sa préservation). Le manque de données sur ce thème est un problème et explique aussi l’absence d’articles sur ce thème. Les auteurs ont réussi à collecter des données confidentielles issues de 33 projets de biodiversité financés entre 2020 et 2022 par un gestionnaire d’actifs spécialisé.
Parmi ces projets, 19 sont financés exclusivement par du capital privé et 14 par des structures mixtes.
Le premier résultat important porte sur les TRI des projets. Ceux à financement exclusivement privé affichent 14,7 % en moyenne contre 11,9 % pour les projets en finance blended. En revanche, ils sont significativement plus petits (18 M$ en moyenne contre 29 M$) et moins ambitieux sur le plan écologique. Même à taille équivalente, leur impact est 4 à 5 fois moins important que celui des projets blended. Ces derniers bénéficient aussi (en termes d’emplois) à un plus grand nombre de personnes.
Le profil de risque, mesuré par un indicateur de volatilité, est légèrement meilleur pour les projets mixtes (6,3 % contre 6,7 %). Ceci s’explique notamment par le fait qu’une partie de la contribution publique dans le cadre d’un financement mixte consiste à couvrir le risque. Autre résultat notable : le couple rentabilité/risque est proche dans les deux cas, conformément à une prédiction du cadre conceptuel proposé. La finance blended permet de repositionner des projets sur la frontière efficiente.
Enfin, l’étude compare les projets financés à 32 autres ayant été écartés. Ces derniers affichaient une rentabilité et un impact écologique plus faibles, suggérant l’existence d’un seuil minimum de rentabilité et d’impact en dessous duquel même la finance blended ne suffit pas.
En conclusion, l’étude illustre les conditions de faisabilité économique de la biodiversité finance. Le capital privé peut jouer son rôle, surtout s’il est soutenu par des instruments publics et des outils de mesure adaptés. La biodiversité, après le carbone, est en passe de devenir un enjeu central pour la finance durable. Toutefois, sans instruments de mesure robustes, cadres de référence partagés et politiques publiques adaptées, la finance restera mal équipée pour répondre à cet enjeu.
[1] Voir à ce sujet « La taxe carbone, un instrument efficace pour la réduction des émissions de CO2 : l'exemple suédois », Lettre Vernimmen no 224, mars 2025.
[2] C. Flammer, T. Giroux et G.M. Heal, « Biodiversity Finance », Journal of Financial Economics, vol. 164, 2025.
[3] Voir aussi la question/réponse de la Lettre Vernimmen no 221, novembre 2024.
Q&R : Êtes-vous à la hauteur en matière de taux actuariels et de taux équivalents ?
C‘est un de nos lecteurs recruteurs de stagiaires pour une partie de son temps qui nous a soufflé cette question, fatigué qu’il était de voir de nombreux candidats échouer à répondre correctement à ces trois questions :
Avec votre premier travail, vous empruntez 100 000 € à une banque pour vous acheter un appartement. Vous empruntez sur 25 ans, avec une mensualité fixe, en mai 2025. Vous avez les moyens d’honorer les échéances et l’appartement est standard.
Question 1(à l’oral) : quel taux vous serait proposé si vous empruntiez en mai 2025 ?
Question 2 (à partir d’un fichier Excel vierge) : quelle est la mensualité de crédit correspondante ?
Question 3 : combien devrez-vous à la banque après le paiement de la 180e échéance en mai 2040 ?
Réponses aux questions
Question 1 : de l’ordre de 3 % en France en mai 2025.
Question 2 : la mensualité M se calcule ainsi :
100 000 = (M / T) x (1 – (1 + T)^( – 25 x 12)), d’où il vient que la mensualité M est de :
100 000 x T / (1 – (1+T) ^ (- 25 x 12)).
Sachant que T est 3 % / 12, il vient que la mensualité est de 474,21 €.
Notre lecteur familier du chapitre 18 du Vernimmen consacré au taux de rentabilité actuariel nous fera remarquer, avec raison, que 3 % / 12 = 0,25 % est un taux proportionnel à 3 % sur un an, mais pas un taux équivalent. Que si l’on voulait prendre un taux mensuel équivalent à 3 % sur un an, ce serait 0,2466 % puisque (1 + 0,2466 %)^12 – 1 = 3 %. En retenant, 0,25 % par mois et non 0,2466 %, le taux actuariel de cet emprunt passe de 3 % à 3,04 %. Il n’y a pas de petits profits !
Question 3 : il faut se rappeler que la fraction du remboursement du capital du prêt comprise au sein d’une mensualité un mois donné progresse par rapport à la fraction du remboursement du capital du prêt comprise au sein de la mensualité précédente d’un pourcentage égal au taux d’intérêt de l’emprunt, ici 0,25 %.
Ce que l’on doit à la banque en mai 2040, après la 180e échéance, correspond au capital initial, moins la somme des remboursements déjà effectués au sein des mensualités précédentes acquittées. Cette dernière somme peut se calculer relativement aisément grâce aux propriétés des suites géométriques :
La fraction du remboursement du capital comprise dans la première échéance est de 474,21 – 100 000 x 3 % / 12 = 224,21 €.
Au bout de la 180e échéance, il aura été remboursé à la banque :
224,21 x ((1 + 3 %/12)^180 – 1) / (3 % / 12) = 50 890. L’emprunteur devra donc à la banque 100 000 – 50 890 = 49 110 €.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
Retarder l'inévitable a toujours un coût (4 mai)
Mediobanca détient 13 % de Generali, le plus grand assureur italien et le no 3 en Europe. Cette participation représente un gros tiers de ses actifs et de ses résultats, et lui donne le contrôle de fait de Generali, ce qui contribue évidemment à son pouvoir et à son influence.
Les dirigeants de Mediobanca ont très bien réussi à éviter que cet actif majeur ne se traduise dans son cours de Bourse par une décote par rapport à la somme des parties, attirant critiques et prédateurs.
Toutefois, il n’y a pas que la finance dans la vie ; il y a aussi le pouvoir. Or qui contrôle Mediobanca contrôle Generali. Les dirigeants de Mediobanca en avaient bien sûr conscience. Mais plutôt que de résoudre ce dilemme, couper ce point fort qui est aussi leur point faible, ils ont, comme trop souvent dans la nature humaine, préféré l’attentisme à l’action préemptive, pensant que la bonne tenue en Bourse de leur cours les protégeait.
Et le risque a pris la forme le 24 janvier d’une OPE de la part de celui qui fut durant plus d’une décennie l’homme malade de la banque européenne, Monte dei Paschi di Siena, MPS. Quand on apprit que MPS lançait une offre publique d’échange non amicale sur Mediobanca, nombreux avons-nous été à croire que le 1er avril et ses poissons avaient 70 jours d’avance. C’est un peu comme si on annonçait qu’Atos faisait une OPE sur Cap Gemini !
La banque de détail MPS, enfin redressée, capitalisant en Bourse 9 Md€, voulait devenir banque universelle en acquérant Mediobanca (alors 12,5 Md€ de capitalisation boursière) avec ses actifs de banque d’investissement et de gestion d’actifs, etc., et sa participation de 13 % dans Generali. Enfin MPS, disons plutôt ses deux premiers actionnaires privés, les familles Caltagirone et Del Vecchio, conteste le contrôle de Generali à Mediobanca dont ils sont aussi par ailleurs actionnaires.
Pour échapper à MPS et à ses deux gourmands actionnaires, Mediobanca vient d’annoncer une OPE sur la filiale cotée de Generali active dans la gestion privée. OPE payée en actions Generali, qui seraient ainsi quasiment tous cédées. Ce qui pourrait logiquement réduire l’attrait de Mediobanca pour les familles Caltagirone et Del Vecchio, à qui le retrait de Mediobanca de Generali ouvre une large porte pour contrôler l’assureur. D’autant plus que leur position au capital de ce dernier est mécaniquement augmentée si Generali annule ses propres actions reçues en contrepartie de la cession de sa filiale de gestion privée à Mediobanca.
En confessant qu’il songeait depuis 5 ans à cette opération, le dirigeant de Mediobanca reconnaît simplement que différer l’inévitable a toujours un coût, ici peut-être la perte de son indépendance si cette habile manœuvre échoue.
Si elle réussit, ce sera la fin symbolique du capitalisme sans capital en Italie, comme le furent en leur temps l’indépendance donnée à PAI Partners par Paribas en France, ou la cession par Deutsche Bank de ses participations dans les groupes industriels allemands.
KKR – Capital Group, des fiançailles avant un mariage ? (11 mai)
Capital Group est l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’actifs pour compte de tiers. Basé à Los Angeles, il gère 2 800 Md$, essentiellement avec une gestion active pour le compte de dizaines de millions d’investisseurs particuliers. Il détient ainsi 16,6 % de Publicis, 10,3 % de ASML Holding ou 13,8 % de BAT.
Comme pour tous les gestionnaires actifs, la montée de la gestion passive est une menace bien réelle. Si Capital Group a multiplié par 2 ses actifs sous gestion depuis 2016, Vanguard, pionnier de la gestion passive, les a multipliés sur la même période par 3 à 10 500 Md$. Avec des frais de gestion affichés à 0,07 % de ses encours, Vanguard a des arguments commerciaux que Capital Group n’a pas.
La dette privée, c’est-à-dire non cotée, et le plus souvent plus rentable car plus risquée que les obligations cotées, est une façon de lutter contre la gestion passive en augmentant les taux de rentabilité servis aux clients. Mais ce n’est pas parce que l’on gère 555 Md$ en obligations cotées que l’on se sent à l’aise dans le domaine de la dette privée.
KKR est né dans les LBO, mais s’est de longue date diversifié dans tout type d’investissements : infrastructure, immobilier, et la dette privée (100 Md$ sur ses 600 Md$ d’actifs gérés). S’allier avec Capital Group, c’est trouver de nouvelles ressources : les particuliers innombrables que Capital Groupe sert via 200 000 conseillers financiers ou gestionnaires de patrimoine indépendants. Il est vrai qu’en 40 ans les investisseurs institutionnels ont eu le temps de se convertir aux charmes du private equity, alors que seuls 5 % des particuliers y ont accès.
Les deux ont annoncé l’an dernier une alliance pour concevoir d’abord deux nouveaux fonds lancés il y a deux semaines investis à 60 % dans des obligations cotées et à 40 % dans des prêts directs aux entreprises ou dans du financement d’actifs. L’investissement minimum est de 1 000 $. Trimestriellement, et en cas de besoin, jusqu’à 10 % du fonds pourra être racheté à la valeur liquidative, et on peut imaginer que KKR fera la liquidité corrélative sur les dettes privées détenues par ces 2 fonds. La commission de gestion annoncée pour ces 2 fonds est de 0,84 % ou de 0,89 %.
D’autre fonds mélangeant ainsi actifs cotées et actifs non cotés devraient être lancés en 2026 par les duettistes, dans le domaine des actions, et dans celui des fonds à échéance. De là, on peut imaginer qu’un jour, KKR et Capital Group en viennent à fusionner, ayant appris à travailler ensemble pour mieux trouver de nouveaux actifs à gérer et proposer aux particuliers de la classe moyenne l’accès au private equity.
Mais d’ici là ils devront prouver que leur alliance ponctuelle est efficace malgré des cultures d’entreprise différentes, d’autant que leurs concurrents ne sont pas de reste : Apollo a fait de même avec State Street et Vanguard avec Blackstone. La distinction actifs cotés/ actifs non cotés s’affaiblit, et ce n’est pas une tendance qui va elle disparaître.