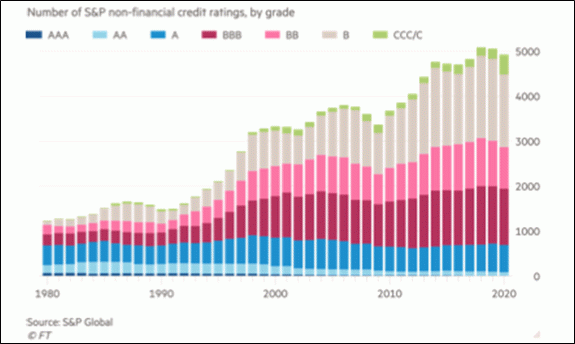La Lettre n°184 de Décembre 2020
Actualités : L'innovation de Danone pour intégrer le coût de son empreinte carbone dans ses comptes sera-t-elle durable ?
Depuis son passage à une édition annuelle en 2008, l’avant-propos du Vernimmen s’ouvre par des développements prospectifs sur la finance d’entreprise. Cette année, il nous a semblé que la publication en février 2020, par Danone, d’un bénéfice net par action (BNPA ou BPA) sous déduction du coût de son empreinte carbone (qui le réduit de 36 % par rapport au BPA standard), était une innovation de rupture, propre à réconcilier l’analyse financière et l’analyse extra-financière, qui jusqu’à présent se regardaient comme des chiens de faïence.
Aussi, à l’occasion de la sortie de la dernière édition du Vernimmen, nous avons organisé une table ronde réunissant Nadia Ben Salem-Nicolas, responsable de la relation investisseurs et de la communication financière pour Danone, côté émetteur, et Pierre Tegner, analyste financier qui suit Danone pour ODDO-BHF, dont voici le compte-rendu.
Le Vernimmen : Quelle a été la réaction de tes clients investisseurs sur la publication de cet agrégat ? Est-ce qu’il est passé complètement inaperçu parce qu’il a été publié en février, quand les marchés financiers avaient d’autres sujets de préoccupation, as-tu eu des réactions à ce sujet ?
Pierre Tegner : Les relations sont assez limitées entre le monde financier et le monde de l’extra-financier pour la simple et bonne raison que l’analyste financier classique est assez peu sollicité par un investisseur ISR ou ESG. Dans la plupart des cas, les analystes spécialisés sur l’ISR sont sollicités par des investisseurs ISR.
En l’occurrence, comme Danone est une entreprise qui fait de l’ISR depuis au moins 20 ans, voire plus, mécaniquement les investisseurs sont quand même sensibilisés à ces questions-là.
J’ai eu assez peu de remarques dans la mesure où, en même temps que cet indicateur a été exposé, a été présenté un plan à long terme pour réduire l’empreinte carbone de Danone, s’attaquer à la problématique du plastique, et de la supply chain. Même si ce n’était pas nouveau, cela a suscité énormément d’intérêt, à la fois de la part des investisseurs spécialisés sur l’ISR, et également de la part des investisseurs classiques.
Comme cela a été une première, je dirais que le sens critique des investisseurs était assez peu aiguisé au départ, même s’il y en a un qui m’a dit que pour faire 1 € de bénéfice, globalement Danone consomme 36 centimes d’empreinte carbone, ce qui est quand même assez élevé, puisque l’empreinte carbone de l’industrie de l’agroalimentaire en règle générale c’est 20 %. C’est la seule remarque que j’ai eue.
Je pense que c’est un indicateur qui doit s’inscrire dans la durée pour que, petit à petit, les investisseurs puissent développer un sens critique et aider Danone à affiner la présentation de ce BPA.
Le Vernimmen : Qu’est-ce qui a amené Danone à présenter cet indicateur ? D’où vient l’idée ? On sait que Danone est très engagé dans ces sujets, mais comment cela a-t-il mûri au sein de la société ?
Nadia Ben Salem-Nicolas : Je vais mettre les choses en perspective d’abord, pour comprendre les termes du débat et l’origine de cette réflexion chez Danone. J’enfoncerais peut-être des portes ouvertes, mais c’est important de le dire. En tant qu’entreprise agroalimentaire, l’activité de Danone est intrinsèquement liée à l’agriculture. L’agriculture, c’est 60 % de l’empreinte carbone de Danone. Et quand je dis empreinte carbone de Danone, on la mesure sur l’ensemble de notre chaîne de valeur, c’est-à-dire à la fois les émissions directes sur les équipements qui appartiennent à l’entreprise (les tours de séchage, les véhicules et les fours), mais également les émissions indirectes jusqu’aux activités de nos fournisseurs, et donc y compris les fermiers et les producteurs de lait.
Après le secteur de l’énergie, l’agriculture est le deuxième émetteur de carbone au niveau mondial. Je crois que c’est à peu près 15 à 16 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, donc c’est important.
La bonne nouvelle, c’est que l’agriculture peut aussi contribuer à la solution et aider à relever un certain nombre de défis parmi lesquels le réchauffement climatique, et j’arrive à cette idée qui est (je m’en étonne à chaque fois quand j’en parle aux investisseurs) assez peu connue… En fait, le grand public comprend que les vaches émettent du méthane, mais assez peu de gens savent que des sols sains ont la faculté de séquestrer du carbone dans le sol. C’est une idée qui est une réalité scientifique, même si elle est assez peu connue. Il existe aujourd’hui différentes pratiques d’agriculture régénératrices qui peuvent transformer un sol, qui est émetteur en gaz à effet de serre, en un agent rétenteur de carbone, puisque le carbone représente à peu près 60 % de la matière organique dans un sol.
Du coup, pour une entreprise comme Danone, le carbone n’est pas qu’un enjeu moral ou un enjeu d’aide générationnelle ; c’est un enjeu éminemment économique. C’est un enjeu de résilience de notre modèle. C’est un enjeu de productivité des fermes. C’est un enjeu du devenir de l’agriculture. Et c’est un critère de préférence pour les consommateurs à l’heure où ceux-ci sont de plus en plus exigeants sur la transparence et la recherche de la naturalité.
Donc, j’en arrive à votre question. Qu’est-ce qui nous a amenés à prendre cette décision, du mariage du financier et du non-financier d’une certaine façon ? Je dirais que ce mariage s’est fait sous une double impulsion.
La première impulsion est quand même celle des investisseurs que l’on sentait plus mûrs pour comprendre que les intérêts économiques étaient, ou sont, de plus en plus étroitement liés aux enjeux environ-nementaux et sociaux, compte tenu de l’avènement de nouveaux risques financiers. Et donc l’accord de Paris est passé par là, des coalitions qui se sont montées, Climate Action 100+, la lettre du CEO de BlackRock qui parle de reshaping of finance sous l’impulsion des enjeux climatiques… Donc, ça c’est le premier enjeu.
Et de l’autre côté, la propre démarche d’une entreprise comme Danone qui est engagée autour de 9 objectifs de long terme qui fusionnent des objectifs économiques, sociaux et environnementaux en ligne avec les objectifs de développement durable, une entreprise qui est précurseur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela fait plus de 10 ans que Danone a des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, cela fait plus de 10 ans que Danone a mis en place des objectifs environnementaux dans les éléments de rémunération de ses dirigeants, que l’entreprise bénéficie d’une reconnaissance externe hyper forte de ses projets de réduction d’émissions, puisqu’elle fait partie des 8 seules entreprises, sur plus de 8 000 qui ont postulé, à avoir obtenu un score AAA par l’agence de notation CDP. Danone maîtrise tellement bien sa mesure de ses émissions qu’on a pu évaluer, et c’était ça aussi un peu le fait générateur de 2019, qu’on avait atteint notre pic d’émissions en CO², ce qui signifiait que désormais, à partir de fin 2019, la croissance de Danone se ferait avec une réduction de ses émissions en absolu. Croissance d’une activité, croissance de chiffre d’affaires, qui vont avec une réduction des émissions carbone. C’est majeur.
Donc on s’est dit : que fait-on de cette information ? Et face à l’urgence climatique, comment peut-on mettre l’innovation en communication financière, faire évoluer nos indicateurs afin de démontrer la création de valeur financière et environnementale ? Parce que dans les marchés, « if you can’t mesure it, it does not exist ».
Donc, voilà, on est rentré dans cette réflexion, on s’est posé la question : quel était le bon indicateur ? On est assez vite arrivé à cette définition de BNPA carboné parce que, dans notre industrie, l’évaluation se fait beaucoup en PER. Donc, on a décidé de communiquer pour la première fois sur l’évolution d’un BNPA courant ajusté du coût du carbone qui tient compte d’une estimation de l’impact financier des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de notre chaîne de valeur.
On a montré qu’en 2019, cette évolution avait été de plus de 12 %, plus importante que celle du BNPA courant qui ne s’élevait qu’à 8 %, grâce à des gains d’efficacité carbone qui avaient été générés en 2019 et qui s’élevaient à 9 %. Et surtout qu’à l’avenir, dans la mesure où le pic d’émissions carbone avait été atteint en 2019, ces gaz à effet de serre avaient vocation à diminuer en valeur absolue, et que ce BNPA courant ajusté du carbone devrait mécaniquement augmenter plus vite que le BNPA courant.
Qu’est-ce qui nous a conduit à faire ça ? C’est vraiment vouloir prendre le tournant afin de traduire la notion d’impact en valeur tangible et prendre en compte, dans l’information financière, les impacts positifs/négatifs du carbone. Pour nous, c’était aider les investisseurs dans leurs choix d’investissements, démontrer la véritable création de valeur des entreprises et inciter d’autres entreprises à accélérer leur transformation.
Ma réponse est un peu longue, mais c’est le cheminement qui nous a conduits à prendre cette décision en février dernier.
Le Vernimmen : Est-ce que vous avez des réactions des analystes, des investisseurs ou au moins des agences de ESG ?
Nadia Ben Salem-Nicolas : La réponse courte est que ceux que ça intéresse, ça les a encore plus intéressés ; et ceux que ça n’intéresse pas, ça ne les intéresse pas nécessairement davantage. Et parfois, ceux que ça intéresse et ceux que ça n’intéresse pas peuvent faire partie de la même institution, comme vous l’écrivez dans l’avant-propos du Vernimmen 2021.
Beaucoup ont salué des efforts pour être précurseur, pour intégrer l’extra-financier dans le financier. À l’heure où il n’y a pas de normes de reporting extra-financier, je pense que toute initiative qui permet aux analystes et aux investisseurs de mieux comprendre et de comparer la création de valeur des entreprises est, de façon générale, plutôt soutenue et encouragée. J’ai quand même eu des discussions assez intéressantes, des questions qui ne m’avaient jamais été posées jusqu’à présent, et pas du tout par des gourous de l’ESG, afin d’avoir plus de détails sur les émissions carbone par activité, par géographie, ce qui s’était assez peu produit jusqu’à présent.
Le fait qu’on a été transparent, rigoureux sur la méthodologie, le choix du prix de la tonne de carbone, le rationnel, la réflexion, les détails du calcul ont été plutôt appréciés. Je pense à une dernière réaction qui nous conforte aussi dans ce choix : c’est l’adhésion d’autres entreprises, puisqu’il y a d’autres entreprises, comme Atos, qui ont annoncé qu’elles prendraient des mesures similaires. Donc, je pense que c’est ce qui est important. Il n’y a pas eu de re-rating overnight, ce n’était pas ce qui était prévu. Ce qui était important pour nous, c’était que la réflexion commence à se structurer, qu’on commence à s’interroger sur comment valoriser les externalités positives ou négatives. Comment en tenir compte dans un modèle ? Est-ce qu’il faut en tenir compte ? Est-ce que la valeur d’une entreprise n’est qu’une somme actualisée des cash-flows avec une valeur terminale ? Comment est-ce qu’on intègre cet extra-financier dans le financier ? Comment on mesure l’impact ?
Je pense qu’on ne s’attendait pas à une réaction dans la semaine sur la valorisation. Ce qu’on souhaitait, et ce qu’on a commencé à voir, c’est une discussion sur ces sujets et puis, progressivement, il y aura des ajustements dans les constructions des modèles. Ce qui est important, c’est que les choses bougent, et qu’il y ait des débats comme celui-ci.
Le Vernimmen : Pierre, as-tu connaissance d’initiatives similaires d’autres groupes ?
Pierre Tegner : Des initiatives similaires qui consistent à ramener le carbone par action et le défalquer du BNPA, non. C’est unique d’après ce que m’a dit l’équipe ESG chez ODDO. Alors c’est toute la difficulté, c’est-à-dire que pour susciter un intérêt, il faut que Danone donne un peu plus de billes. Typiquement, quand il y a une acquisition, nous, les analystes financiers, de manière très classique, on fait ROIC/WACC pour voir à quelle échéance l’opération est créatrice de valeur. Est-ce que derrière, le département M&A de Danone a annoncé des critères pour savoir quelles sont les manières d’évaluer l’acquisition par rapport à la question environnementale ? Plus ils vont donner de billes, plus ça va susciter un intérêt.
Mais comme c’est assez unique, si on rentre trop vite dans la sophistication, ils risquent de perdre des investisseurs. Donc c’est un juste équilibre, apporter des détails pour ceux qui y portent un intérêt et permettre aux autres entreprises de s’en inquiéter.
Quand j’entends parler Nadia et quand j’ai entendu parler Emmanuel Faber (PDG de Danone), il y a un exemple qui me vient à l’esprit, mais qui est encore très éloigné de ce que Danone a fait. C’est celui d’Unilever, quand Paul Polman est arrivé comme CEO en 2008, il a commencé à communiquer énormément sur l’ISR. En 2010, il a lancé l’Unilever Sustainable Living Plan avec l’objectif de doubler de taille en maintenant un niveau stable de l’empreinte carbone, de l’empreinte environnementale. On se rapprochait de cette idée-là, mais elle n’était pas quantifiée. Et aujourd’hui, tout ce qu’on peut espérer c’est que, effectivement, il y ait d’autres entreprises qui suivent Danone, pour un peu concurrencer et challenger Danone dans l’élaboration de ce critère-là, parce que la concurrence est source d’innovation. Tout le monde le sait. Et plus il y a de concurrents et mieux ce sera. Pour l’instant, Danone est tout seul, oui.
Le Vernimmen : Est-ce que vous pensez que vous pouvez continuer à être seul à publier cet agrégat, ou le taux de croissance de cet agrégat, si vous n’êtes pas comparés à d’autres ?
Nadia Ben Salem-Nicolas : J’ai des investisseurs qui me posent de plus en plus de questions sur nos émissions carbone, savoir ce qu’il y a derrière, comment on les mesure, quels outils de comptabilité carbone. Et qui sortent quand même aussi les rapports de nos concurrents et commencent à faire leur propre travail de comparaison et arriver aussi aux BNPA carbonés d’autres entreprises. Donc, quand bien même les autres ne le publient pas, il y a des investisseurs qui s’intéressent, et je pense que c’est ça la finalité. C’est surtout de s’interroger, de regarder, de commencer à comparer. Je ne pense pas qu’on aura un BNPA carboné estampillé par les auditeurs demain, comme on peut l’avoir sur un EBITDA.
Mais, nous, on va continuer à le faire, afin de continuer à valoriser la création de valeur financière et extra-financière de Danone. On va continuer à saluer les initiatives similaires, qu’elles soient le BNPA carboné ou autre chose. On va continuer à éduquer, à partager sur ce choix d’indicateur. Et puis, on est pour notre part favorable à une standardisation, une harmonisation du reporting extra-financier. Je pense que les autorités politiques et économiques européennes sont en train de s’en emparer pour ne pas laisser ce terrain de souveraineté à d’autres. C’est vraiment indispensable de permettre aux investisseurs, comme à l’ensemble des parties prenantes, de comparer les actions des entreprises en matière de développement durable afin de pouvoir mesurer les impacts de chacune d’entre elles. C’est d’ailleurs le sens du fait qu’on ait rejoint un groupe de travail sous l’égide de l’ONU, on l’a fait il y a 6 mois, qui s’appelle le CFO TaskForce for the SDGs. C’est un groupe de travail qui regroupe des directeurs financiers sur le plan international, et des responsables des choix d’investissement des fonds, afin d’œuvrer collectivement à une approche collective de la finance durable à l’aune des objectifs de développement durable des Nations-Unies.
De quoi ce groupe de travail va-t-il accoucher ? Est-ce que c’est le BNPA carboné qui sera retenu ? Je n’en sais rien. Mais c’est un groupe qui travaille justement dans le sens d’une standardisation, d’une harmonisation de ce reporting extra-financier.
Le Vernimmen : Quelles sont les prochaines étapes ? Est-ce qu’il faut prendre en compte idéalement toutes les externalités, et retraiter aussi, par exemple, celles du plastique dans un BPA ?
Nadia Ben Salem-Nicolas : Les prochaines étapes, c’est de faire en sorte de continuer à publier, à faire de la pédagogie, continuer à communiquer avec nos investisseurs sur cet agrégat, et puis continuer à travailler ensemble, parce que c’est intéressant que ce soit porté par Danone mais, comme je le disais dans l’introduction, c’est encore plus intéressant si nous sommes plusieurs à œuvrer dans ce sens, si on ne s’arc-boute pas sur le choix de cet indicateur. Ce qui est intéressant, c’est que de l’extra-financier soit mesuré et capté, et soit valorisé dans du financier.
Alors après, j’entends votre question sur le plastique. Je tiens à dire que l’un ne va pas sans l’autre. En travaillant sur le climat, on travaille également sur l’agriculture, on travaille sur l’eau et on travaille sur le plastique. Parce que notre objectif, c’est d’être neutre en carbone en 2050 sur l’ensemble de notre chaîne de valeur. Et cette ambition ne sera réalisée que grâce à des actions concrètes, sur des enjeux environnementaux matériels pour le modèle économique de Danone, et c’est l’agriculture régénératrice. Je le redis, l’agriculture, c’est 60 % de nos émissions, c’est la préservation et la restauration des ressources en eau. Et c’est aussi, parce que c’est à peu près 10 % de nos émissions, le packaging et une économie circulaire de nos packagings afin de diminuer leur impact sur l’environnement.
Le Vernimmen : Vous avez choisi de communiquer sur l’évolution du BNPA carboné et pas sur la masse du BNPA carboné en tant que tel. Pour quelles raisons ?
Nadia Ben Salem-Nicolas : Nous ne voulions pas créer de la confusion auprès des investisseurs pour dire que notre BNPA et notre valorisation devaient être ajustés d’autant, mais plutôt montrer en dynamique la vertu de notre modèle et le fait d’avoir atteint, je le redis, notre pic d’émissions carbone dès 2019.
Ce sur quoi nous communiquons et qui est intéressant dans la discussion avec les investisseurs, c’est vraiment les bénéfices pour l’actionnaire de la décarbonisation de notre activité. C’est de montrer qu’une entreprise qui a atteint son pic d’émissions, parce qu’elle travaille sur des projets d’agriculture régénératrice notamment, sera davantage en mesure d’améliorer son BNPA, en tout cas plus rapidement qu’une entreprise qui continue d’augmenter ses émissions.
Ce qui est important, c’est l’évolution de l’agrégat et pas tellement l’agrégat lui-même.
Le Vernimmen : Le prix de la tonne de carbone que vous avez retenu de 35 € n’est pas loin du prix de marché des crédits carbone dans le système européen. Est-ce que vous avez l’intention de faire évoluer ce prix, ou de le maintenir constant pour avoir une comparabilité de votre BPA décarboné ? Nécessairement, si on a une évolution de ce prix, cela crée une complexité supplémentaire dans l’appréciation du critère.
Nadia Ben Salem-Nicolas : Je n’ai pas de réponse définitive et fermée sur ce point aujourd’hui. Pourquoi avons-nous retenu 35 €/t ? Évidemment, cela a fait l’objet de discussions et de débats en interne. En fait, depuis 2015, on a déterminé un coût pour les émissions carbone de 35 €/t, c’est conforme à ce qui est inclus dans notre analyse de risques dans le questionnaire du CDP Climat et qui repose sur 3 éléments de benchmark via un faisceau d’indices pour rendre solide cette hypothèse : c’est le coût de la tonne carbone sur le marché volontaire, le coût de la tonne carbone sur le marché régulé ETS et c’est une référence des entreprises qui communiquent sur un coût carbone.
Alors, l’idée est que cette hypothèse reste plutôt stable dans le temps pour pouvoir permettre la comparabilité de cet indicateur. Après, bien évidemment, il faudra que cette hypothèse ne soit pas décorrélée non plus des hypothèses de marché. Donc à date, le projet c’est plutôt de maintenir, au moins pour l’année prochaine, cette hypothèse de 35 €/t.
Le Vernimmen : Est-ce que vous prenez en compte un effet impôt sur ce coût carbone pour calculer le BNPA ?
Nadia Ben Salem-Nicolas : Non, c’est un coût brut, pas après impôt, parce que l’idée était aussi d’avoir un agrégat accessible pour tous… pas de se faire plaisir avec un agrégat complexe. Déjà, il faut quand même un peu rentrer dans le détail des émissions, du nombre d’actions, de l’hypothèse du coût. On n’a pas ajouté une couche fiscale dans la définition de l’agrégat de l’indicateur.
Le Vernimmen : Quels scopes ont été retenus pour les estimations d’utilisation de carbone ? Périmètres 1 et 2, on l’a compris. Est-ce que ça va jusqu’au périmètre 3, c’est-à-dire l’ensemble de la chaîne de valeur de Danone ?
Nadia Ben Salem-Nicolas : Oui, c’est un périmètre de responsabilité 1, 2 et 3. C’est comme ça qu’on le mesure depuis plus de 10 ans. C’est comme ça qu’on se fixe des objectifs, que c’est comptabilisé, donc y compris le périmètre 3 qui sont toutes les émissions indirectes dues aux activités d’une organisation donnée : les émissions des fournisseurs et des consommateurs. Cela inclut l’agriculture, le transport, la distribution des produits. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile à mesurer, mais c’est là que sont les plus grandes opportunités de réduction des émissions d’une entreprise.
Dans le cas de Danone, les émissions de périmètre 3 représentent 95 % de nos émissions totales. Notre responsabilité directe et les émissions liées aux achats d’électricité, donc périmètre 1 et périmètre 2, c’est 5 % de nos émissions totales.
Donc, on comprend très vite que là où on a un levier, une marge de manœuvre, c’est sur le périmètre 3. Dans ces 95 %, l’agriculture c’est 60 %. Ce n’est pas seulement les vaches qui émettent moins de carbone, et effectivement en jouant sur la façon dont elles sont élevées, est-ce qu’elles sont en pâturage et ce qu’elles mangent, cela influe sur la quantité d’émissions. Mais en plus, c’est ce que je disais dans mon introduction, c’est très important de travailler sur la rétention, la qualité des sols, parce que des sols sains permettent de séquestrer le carbone.
Le Vernimmen : Pierre, quelle est ton appréciation de la capacité des normes comptables à prendre en compte des externalités ? On l’avait vu sur les stock- options, suite à l’éclatement de la bulle TMT, qui ne sont pas un coût cash et que les IFRS avaient pris en compte. Est-ce qu’à ton avis les régulateurs comptables peuvent un jour effectivement, au-delà des agences ISR, avoir un résultat après externalités ?
Pierre Tegner : Je vais répondre de manière pratique. Les régulateurs, je pense, ont suffisamment d’imagination pour trouver le moyen d’élaborer un critère qui intègre le carbone et notamment pour le changer, sachant que principalement ce que recherchent les régulateurs comptables, c’est la pérennité.
Mais dans la pratique, on assiste surtout à une inflation des normes comptables qui crée des changements permanents et qui ne facilite pas la tâche dans le suivi des indicateurs clés de performance.
Ensuite, il faudrait un consensus assez large, et donc derrière, il faudrait que Danone arrive à convaincre les régulateurs de la nécessité de construire des indicateurs durables et pérennes qui s’inscrivent dans le temps. Mais, pour l’instant, on en est loin. Je crois que l’essentiel c’est qu’on comprenne un sujet qui est assez complexe et qu’on arrive à l’intégrer, même de manière qualitative.
Tableau : Évolution de la solvabilité des entreprises américaines depuis 1990
Ce graphique, publié par le Financial Times montre :
- que de plus en plus d'entreprises américaines ont eu accès au marché obligataire, avec des notations inférieures à celles des entreprises qui émettaient déjà des obligations, ce qui n'est pas une surprise puisque souvent de nouveaux marchés sont ouverts par les émetteurs les plus solvables, avant de s’élargir à des émetteurs de moindre qualité ;
- que le nombre de sociétés notées AAA s'est effondré aux États-Unis, reflétant l'évolution mondiale : elles étaient 65, il y a 40 ans, et ne sont plus que 5 maintenant, dont Microsoft et Johnson & Johnson pour les États-Unis.
Avoir une notation AAA n'est pas en soi un objectif pour un directeur financier ou un conseil d'administration. C'est plutôt une relique et un sujet de fierté. Pour l'obtenir et la conserver, il faut un niveau de capitaux propres et de liquidités à l'actif du bilan qui pourrait être mieux utilisé ailleurs. Nous n'avons pas le sentiment que les dirigeants de Nestlé, qui sont arrivés à cette conclusion en 2007 lorsqu'ils ont annoncé un programme de rachat d'actions pour 15 milliards de francs suisses, perdant le jour même leur notation AAA, ont commis une erreur stupide.
Recherche : Emprunt bancaire contre emprunt obligataire : lequel est le moins cher (aux Etats-Unis) ?
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
La comparaison entre le coût de la dette bancaire et celui de la dette obligataire pose des problèmes méthodologiques. L’observation directe des taux d’intérêt, même en tenant compte des durées d’emprunt, ne permet pas d’identifier le type de dette le moins cher, pour au moins deux raisons.
Premièrement, le choix de la méthode n’est pas indépendant des conditions de marché. Le directeur financier tient compte de la situation du marché au moment de choisir entre dette bancaire et dette obligataire, si bien que la prise en compte de la date d’émission exacte est cruciale. Deuxièmement, même à caractéristiques apparemment équivalentes, la dette bancaire et la dette obligataire n’ont pas, en pratique, le même degré de séniorité. Selon une base de données Moody’s, en cas de défaut, les prêts bancaires sont remboursés à hauteur de 84 %, contre seulement 35 % pour les obligations[1]. Un article récent[2] propose une méthode permettant de surmonter ces difficultés et de comparer le coût des deux types de dette.
Pour résoudre la première difficulté, l’auteur a recours à une base de données d’emprunts bancaires reliée à des données de marges (spreads) de marché sur les obligations des mêmes émetteurs aux dates d’emprunt. Bien entendu, cela implique de ne retenir, dans l’échantillon, que des entreprises pour lesquelles il existe un marché obligataire actif (essentiellement de grandes entreprises). L’auteur peut ainsi comparer la marge négociée avec la banque et la marge effective sur le marché obligataire exactement à la même date.
Le deuxième problème est plus difficile à surmonter, car il n’existe généralement pas de possibilité d’émettre sur le marché une dette disposant du même degré de séniorité effective que la dette bancaire[3]. Lorsque l’auteur compare la dette bancaire et la dette obligataire, sans prendre en compte ce problème, il constate que, pour les entreprises dont le risque de faillite est significatif, les marges sont plus élevées sur la dette obligataire que sur la dette bancaire. Toutefois, si la dette obligataire semble plus chère, c’est parce qu’elle offre moins de sécurité que la dette bancaire en cas de défaut.
Pour résoudre ce problème, l’auteur utilise un modèle structurel permettant de prendre en compte le risque de faillite, ainsi que le taux de perte en cas de faillite pour les deux types de dette. Une fois ceci pris en compte, les résultats sont sans appel : la dette bancaire est beaucoup plus chère que la dette obligataire. Selon les estimations de l’auteur, le prêteur bancaire touche en moyenne 140 à 170 points de base de plus que le prêteur obligataire à risque équivalent. Cela signifie qu’environ la moitié de la marge perçue par les banques constitue une forme de prime par rapport à une marge de marché de date et de risque équivalents.
Ces résultats conduisent à s’interroger sur les raisons possibles du coût plus élevé de la dette bancaire. L’auteur montre que l’illiquidité de cette dette ne peut justifier à elle seule un tel écart. Le fait que seules les banques fournissent de la dette à ces niveaux de séniorité peut expliquer le recours à la dette bancaire de la part des entreprises. La marge effectivement payée étant inférieure à celle de la dette obligataire (lorsqu’on ne corrige pas le niveau de risque), le directeur financier soucieux de minimiser le montant des intérêts versés peut choisir d’emprunter auprès de la banque. Toutefois, en situation de concurrence, la rémunération perçue par les prêteurs devrait être la même à niveau de risque donné.
L’explication la plus convaincante est celle de l’existence d’avantages annexes perçus par l’entreprise dans la relation bancaire. D’une part, l’obtention d’un prêt bancaire est plus rapide, et les caractéristiques du prêt bancaire peuvent être négociées dans le détail pour correspondre aux besoins exacts de l’émetteur. D’autre part, le fait même d’obtenir ce prêt permet à l’entreprise d’envoyer un signal positif à tous ses investisseurs, puisque la banque a effectué un travail de sélection. Il existe donc des bénéfices spécifiques de la relation entre la banque et l’entreprise. La dette bancaire est plus chère que la dette obligataire, mais le coût additionnel est lié à la répartition entre la banque et l’entreprise de ces bénéfices.
On notera ainsi que la base de données utilisée par l’auteur est composée uniquement d’entreprises américaines, et donc actives dans un marché sur lequel la concurrence bancaire est bien inférieure à celle que l’on observe en Europe, et en France particulièrement. Heureux banquiers commerciaux américains !
[1] Sur des données américaines entre 1997 et 2017.
[2] M. Schwert (2020), « Does borrowing from banks cost more than borrowing from the market? », Journal of Finance, vol. 75(2), 2020, p. 905 à 947.
[3] La raison de la supériorité des banques dans la fourniture de dette senior est une question de recherche ouverte, non traitée dans cet article.
Q&R : Faut-il taxer les dividendes pour financer la transition énergétique ?
Si taxer constituait l’unique solution aux problèmes, la France, championne du monde des prélèvements obligatoires, les aurait tous résolus depuis longtemps ! Cessons de penser que taxer est l’unique façon d’influencer les comportements.
Au moins trois raisons nous font penser que c’est une mauvaise idée.
Peut-on imaginer un dispositif plus contraire à son objectif ? Comment croit-on que les fabricants et exploitants d’éoliennes, de centrales solaires ou à biomasse (ce qui inclut des groupes comme Orsted, NEOEN, mais aussi des ETI comme Voltalia) se financent, si ce n’est – en partie du moins – par des augmentations de capital régulières ? Or, les investisseurs de ces entreprises « vertes » trouvent les fonds nécessaires en réinvestissant les dividendes provenant d’autres sociétés. Taxer les dividendes revient ainsi à réduire la circulation des capitaux et à diminuer les fonds disponibles que les investisseurs peuvent allouer au financement de la transition écologique.
Par ailleurs, il est aberrant de décourager les citoyens d’investir au capital des entreprises au moment où, de toute évidence, un certain nombre d’entre elles vont avoir besoin de plus de capitaux propres pour faire face aux conséquences de la pandémie.
Enfin, rappelons que la France et la Belgique ont été condamnées en 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne pour leurs taxes sur les dividendes instaurées en 2012 et 2013, jugées contraires au droit européen. Or, dans le cas français, ces taxes ne rapportaient qu’un peu plus de 2 Md€ par an.
L’urgence de la transition énergétique et l’importance des investissements requis requièrent d’autres dispositifs que des expédients dignes de l’Ancien Régime. Si on veut modifier la fiscalité en faveur de la transition énergétique, retirons les avantages fiscaux des contrats en euros de l’assurance-vie qui ne seraient pas investis en faveur de l’environnement. Les contrats en euros pèsent 1 400 Md€ d’encours, sur les 1 785 Md€ investis en assurance-vie en France.
Même si la suppression de cette niche fiscale n’entraînerait qu’une réorientation de 10 % des fonds ainsi placés vers des obligations vertes[1], 140 Md€ seraient ainsi fléchés vers la transition énergétique. Un montant 70 fois supérieur, donc, à ce que rapportait la dernière taxe sur les dividendes… Sans parler de ce qu’économiserait l’État en avantages fiscaux, désormais supprimés au profit de placements qui ne favorisent pas la transition énergétique. Et il y a tout à parier que la réorientation serait bien supérieure à 10 %, compte-tenu de l’intérêt essentiellement fiscal de l’assurance-vie.
[1] Pour plus détails sur les obligations vertes, voir le chapitre 22 du Vernimmen 2020.
Autre : Formations
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Ingénierie financière » le 8 mars et le 19 octobre 2021, à Paris.
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 6 mai et le 19 novembre 2021, à Paris.
- « Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity » le 4 mai et le 26 octobre 2021, à Paris.
- « Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2020 » le 25 mars et le 27 septembre 2021, à Paris.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière, des réponses à des questions qui nous sont posées ou des citations. Ce mois, nous reprenons les dix dernières citations que nous avons ajoutées à notre base au fil de nos lectures et qui feront leur apparition en 2021 et au-delà sur ces pages. Et nous vous proposons d’essayer de retrouver leurs auteurs, pour ne pas laisser vos méninges inactives en cet hiver. Les réponses sont données à la page suivante.
Citations
A : « Il n'y a qu'une seule classe dans la société qui pense plus à l'argent que les riches, et ce sont les pauvres. »
B : « L'écriture est la seule profession où personne ne vous considère ridicule si vous ne gagnez pas d'argent. »
C : « C'est cher sur ce que nous savons, et bon marché sur ce que nous ne savons pas. »
D : « Mon œuvre est proche de la vie, donc l'argent y est forcément présent, c'est le sens élémentaire de la réalité. »
E : « L'argent aime le silence. »
F : « Arrêtez d'écouter les économistes, écoutez les traders ! »
G : « Tout bon investissement est un investissement de type value. »
H : « Une dette, ça se rembourse. »
I : « Le marché peut être vraiment stupide. »
J : « Le meilleur expert sur le prix, c'est celui qui fait le chèque. »
Auteurs
1 : Jules Renard, écrivain français du xixe siècle
2 : Araz Agalarov, oligarque russe
3 : Bruno Crastes, gestionnaire d'actifs et fondateur de H2O
4 : Bruno Le Maire, ministre des Finances de la France
5 : James Gorman, PDG de Morgan Stanley
6 : Guy Verrecchia, entrepreneur français et PDG d'UGC
7 : Oscar Wilde, poète et dramaturge irlandais du xixe siècle
8 : Paul Veyne, historien français, spécialiste de l'antiquité
9 : Charlie Munger, associé de Warren Buffett dans Berkshire Hathaway
10 : Un analyste de Morgan Stanley dans une note sur Tesla
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.