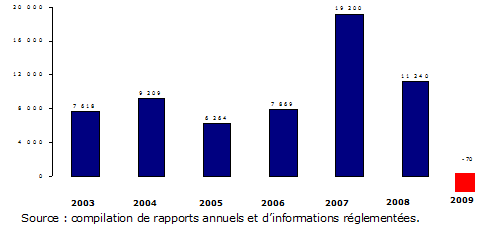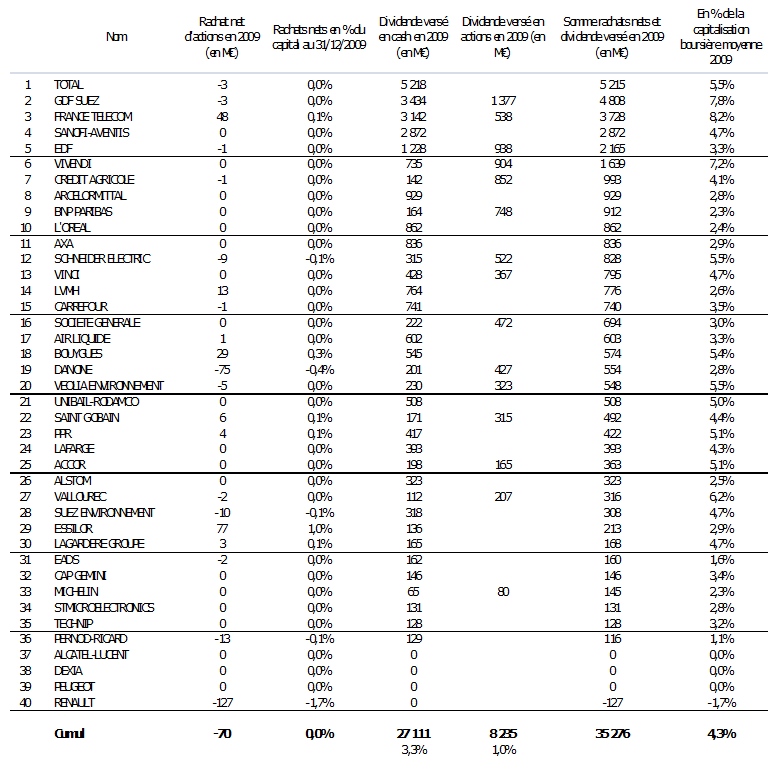La Lettre n°84 de Février 2010
Actualités : Création et partage de valeurs dans les LBO
Il peut paraître étrange de parler de création de valeur dans les LBO à un moment où, d’une part le nombre de LBO réalisés a atteint un plus bas (au Royaume-Uni on a retrouvé en 2009 le niveau de …… 1995) et à un moment où certains estiment qu’environ 80 % des LBO sont en bris de covenants (même si les statistiques officielles de l’AFIC, sur base déclarative sont beaucoup plus modestes…), ce qui montre qu’ils sont mal partis pour créer de la valeur.
Nous avons toujours pensé et écrit (1) que les LBO repartiraient car ils présentent, dans un certain nombre de cas, un mode de gouvernance supérieur à celui de la société familiale ou de la société cotée. On en voit actuellement le début du commencement des prémices pour plusieurs raisons :
• le redémarrage des introductions en bourse (Medica appartenant à BC Partners a été introduite en bourse à Paris, le 10 février 2010) redonnant aux investisseurs en LBO de la liquidité permettant de réamorcer la pompe ;
• la réouverture fulgurante du marché des emprunts high yield (2) (Novasep a levé 370 M€ au mois de décembre, Virgin Média devait lever en janvier 500 M£ et devant la demande a pu réunir 1.500 M£) qui pourrait devenir un mode de financement majeur et non plus marginal des LBO. Ce dynamisme fait écho au dynamisme du marché obligataire investment grade aux pires moments de la crise alors que la dette bancaire se faisait rare ;
• un certain desserrement de la contrainte chez les banques prêteuses de nouveau désireuses de financer des LBO, bien entendu pour autant que les conditions soient attractives et les leviers raisonnables.
In fine, à la situation assez traumatisante pour beaucoup de ces deux dernières années, voici que la « boite à outils » du Private Equity s’enrichit, en ce début 2010, de deux ingrédients qui pourraient clairement aider au rebond du marché.
Peut-on pour autant parler de rebond durable ? Les quatre derniers mois de 2009 ont enregistré, un peu partout dans le monde, des volumes d’opérations nouvelles en croissance d’un mois sur l’autre, ce qui n’avait pas été enregistré depuis longtemps. Mais on part de très bas. Attendons quelques mois pour constater une tendance pertinente.
Enfin, et si besoin était, le lecteur qui nous connaît sait, que même dans cette rubrique intitulée « actualité », nous essayons de voir plus loin que le bout de notre nez !
* * *
Plusieurs études récemment publiées (3) :
• la première étude analyse 241 LBO réalisés entre 1999 et 2006, à 85 % en Europe, avec des investissements en capitaux propres compris entre 1 M€ et 4,3 Md€, soit l’une des bases d’étude les plus larges ;
• la seconde étude analyse, quant à elle, 66 opérations réalisées au Royaume-Uni entre 1996 et 2004 et débouclées entre 2000 et 2007 pour l’essentiel ;
• quant à celle de BCG et de l’IESE, elle s’appuie sur l’étude des performances de 218 fonds de private equity de 1979 à 2002.
aboutissent à des résultats convergents pouvant ainsi être présentés :
En moyenne, l’investissement en capitaux propres des fonds de private equity est multiplié par 2,72 sur une durée sous LBO de 3,5 ans, soit un TRI sur capitaux propres de 48 %. Ce taux s’explique par le succès de certains investissements avec des TRI supérieurs à 300 % (sic). Le TRI médian « n’est que » de 33 %. A l’entrée, le rapport dette / EBE est de 4,2 ; à la sortie du montage il est de 2,7.
Les auteurs décomposent ce facteur multiplicateur de la mise initiale de 2,72 selon ses composantes :
• l’effet de levier de la dette qui dope les TRI et les coefficients multiplicateurs, explique 0,89 point de ces 2,72, soit le tiers uniquement ;
• l’effet sur la période étudiée de la hausse des multiples (valeur de l’actif économique / excédent brut d’exploitation, EV / EBITDA) en explique 0,47 supplémentaire, soit 17 % ;
• le reste, soit la moitié, provient d’améliorations opérationnelles : la croissance de l’EBE pour 29 % et l’effet génération de flux de trésorerie permettant le désendettement pour 15 %. De son coté, la croissance de l’EBE s’explique principalement (à 77 %) par la croissance du chiffre d’affaires et à 23 % par celle du niveau de la marge EBE / chiffre d’affaires.
Quand on analyse plus en détails, on s’aperçoit que sur la période récente (2001 – 2006), les effets de levier ont été accrus par rapport à la période précédente (1989 – 2000), permettant d’avoir de meilleurs taux de rentabilité au prix d’un risque naturellement beaucoup plus élevé, d’autant que la part de la croissance de l’EBE a été nettement moindre, montrant une moindre création de valeur.
Les meilleurs TRI sont obtenus pour des investissements réalisés en périodes économiques mauvaises (1991 – 1993 et 2001 – 2003) pendant lesquelles l’essentiel de l’amélioration opérationnelle vient de la croissance du chiffre d’affaires. Warren Buffet ne dirait pas mieux !
Les auteurs s’intéressent sur la même période à la rentabilité économique (c'est-à-dire en neutralisant l’effet de levier dû à l’endettement) d’un placement en actions d’entreprises cotées dans les mêmes secteurs d’activité en Europe et ayant les mêmes marges EBE / chiffre d’affaires à la mise en place du LBO. Ils montrent une surperformance des entreprises sous LBO correspondant à 6 points de TRI supplémentaires hors effet de levier et donc à structure financière comparable : le TRI des LBO est de 31 % contre 25 % pour les sociétés cotées comparables.
Ce qui revient à dire que sur 3,5 ans de durée de détention moyenne sous LBO, un investissement de 100 est devenu 100 × 1,31 3,5 = 257. D’où une plus value de 157. Les gestionnaires de fonds de LBO s’approprient, au titre de leur intéressement à la performance (carried interest) environ 20 % de la plus value, soit 31 et 2 % par an des fonds gérés, soit 7. Au total, la plus value nette pour l’investisseur est de 157 – 31 – 7 = 119, soit un TRI sur 3,5 ans de 25 %. Autrement dit autant qu’un placement en actions de sociétés cotées ce qui veut dire deux choses :
• les gestionnaires des fonds de LBO créent bien de la valeur pour leurs actionnaires, les investisseurs dans les fonds ;
• mais ils se l’approprient, en moyenne, intégralement, voire même au-delà puisque le calcul ne prend pas en compte le coût de l’illiquidité de l’investissement dans ces fonds de LBO comparé à la liquidité d’un placement boursier.
L’étude du BCG aboutit, de son coté, aux mêmes conclusions.
Mais de cela les investisseurs se sont rendus compte puisque, sauf peut être pour les fonds de private equity avec un historique bien établi de surperformance régulière, les règles de rémunération des 20 % / 2% appartiennent au passé.
Reste à comprendre comment les dirigeants des fonds de LBO sont à même d’améliorer les performances opérationnelles des entreprises qu’ils ont achetées en LBO.
Il y a des raisons liées à la gouvernance d’entreprise mise en place qui aligne fortement les intérêts des dirigeants d’entreprise sous LBO et du fonds par le double effet de l’intéressement financier des dirigeants de la société opérationnelle à la performance financière du fonds de LBO sur son investissement et de la contrainte de l’endettement qui les pousse à être plus efficaces dans la génération de flux de trésorerie disponible (4) (5).
Par ailleurs, les deux dernières études montrent qu’au-delà de la mise en place et du fonctionnement d’une autre gouvernance d’entreprise, les dirigeants de fonds de LBO sont capables de superformer quand :
• les associés sont spécialisés sur un certain nombre de secteurs économiques qu’ils connaissent comme le fond de leur poche et qui en fait plus des industriels que des financiers ;
• les associés sont focalisés car, plus on peut descendre vite sa courbe d’expérience, plus on peut construire un avantage compétitif ;
• les associés disposent d’une capacité d’intervention en amont pour détecter à l’avance les opérations à venir (le fameux « angle » des fonds d’investissement) permettant de séduire plus facilement les dirigeants de la cible et d’aller plus vite dans le processus d’achat ;
• les associés ont une vraie compétence en amélioration de l’efficacité opérationnelle des entreprises allant parfois jusqu’à une implication personnelle dans le management de l’entreprise sous LBO des partenaires du fonds de LBO.
La multiplication des fonds de LBO sur les 10 dernières années a certainement quelque peu dilué la moyenne des compétences et la recherche de l’angle devient de plus en plus complexe.
Cela dit, comme un certain nombre de fonds de LBO sont entrain de disparaître faute de performance correcte, et certainement plus parmi les plus récemment arrivés sur le marché, le niveau moyen va s’élever de nouveau.
(1) Par exemple dans l’introduction des éditions 2009 et 2010 du Vernimmen.
(2) Pour plus de détails sur les emprunts high yield, voir le chapitre 26 du Vernimmen 2010.
(3) Value Creation in Private Equity de A.K. Achleitner (Centre for Entrepreneurial and Financial Studies – Capital Dynamics ; Corporate governance and value creation : Evidence from Private Equity de V. Acharya, M. Hahn et C. Kehoe ; The advantage of persistence de H. Meerkatt, J. Rose, M. Brigl (BCG) et H. Liechtenstein, M. Julia Prats et A. Herrera (IESE).
(4) Nous avons l’habitude de dire à nos étudiants, mutatis mutandis,que l’on battrait plus souvent des records dans les piscines olympiques si l’on mettait derrière les nageurs des … crocodiles.
(5) C’est la théorie de l’agence, voir le chapitre 32 du Vernimmen 2010 pour plus de détails
Tableau : Rachats d'actions et dividendes en 2009 en France
Avec - 70 M€ de rachats d’actions en 2009, les entreprises du CAC 40 ont logiquement atteint un point très bas correspondant à la nature totalement discrétionnaire de cette forme de distribution de liquidités aux actionnaires qui peut être arrêtée à tout moment.
Ce chiffre négatif s’explique par les cessions d’actions achetées les années précédentes supérieures aux achats de 2009, et qui trouvent le plus souvent leur fondement dans des stock-options arrivées à échéance, non levées du fait de la baisse des cours de bourse et qui n’ont plus besoin de ce fait d’être couvertes par des actions autodétenues, alors cédées.
A l’exception de Essilor qui a racheté 1 % de son capital, tous les groupes ont arrêté en 2009 leurs rachats d’actions pour consacrer les fonds ainsi économisés à des investissements (Sanofi–Aventis, EDF–Suez) ou au désendettement (Arcelor Mittal).
De la même façon, les dividendes versés ont été réduits mais avec une plus grande viscosité propre à cette forme de distribution : 43,0 Md€ avaient été versés en 2008, 35,3 Md€ l’ont été en 2009, soit - 18 %. On retrouve un niveau intermédiaire entre celui de 2006 et de 2007. Sur cette somme, un quart environ l’a été sous forme de dividendes payés en actions qui ont eu beaucoup de succès, compte tenu de la hausse des cours entre le moment où cette option a été proposée et le moment où l’actionnaire a pu faire son choix (1).
L’essentiel de cette pratique est concentré sur des groupes assez endettés (Danone, Saint-Gobain, EDF) ou les groupes bancaires compte tenu de la pression au renforcement de leurs capitaux propres.
Le trio de tête des versements de dividendes (Total, France Télécom, GDF – Suez) représente à lui tout seul 36 % des sommes payées.
Le taux de distribution, pour les entreprises qui ont versé un dividende est à 35 % en repli par rapport à celui constaté l’an d’avant (42 %), en bonne partie expliquée par les moindres résultats des banques et un taux de distribution de leur part plus faible.
Quatre groupes n’ont pas versé de dividendes : Alcatel (qui est familier du fait) et Dexia, Peugeot et Renault pour cause de crise financière.
Au total, les groupes du CAC 40 ont réduit en 2009 le numéraire versé à leurs actionnaires, en dividende ou en rachat d’actions, de 50 % : 27,0 Md€ contre 54,2 Md€.
Recherche : La renégociation des contrats d'emprunt
Parmi les contrats de dette à long terme entre les banques et les entreprises, plus de 90% font l’objet d’une renégociation avant terme. Cette renégociation peut porter sur des éléments aussi importants que le montant, le taux ou la maturité du contrat. Si les études théoriques sur le financement des entreprises prennent souvent en compte cet aspect, peu d’études empiriques ont été menées jusqu’à présent pour décrire ces renégociations. C’est à une telle étude, publiée en 2009 (1), que nous nous intéressons ce mois-ci.
L’analyse porte sur un échantillon de 1 000 contrats de prêt entre des institutions financières et des entreprises cotées américaines, entre 1996 et 2005. Elle montre dans un premier temps que les contrats à long terme (plus de trois ans) voient presque systématiquement (96%) leur montant, leur maturité ou leur taux d’intérêt renégociés. L’ampleur de cette renégociation est importante : la maturité est en moyenne modifiée de 64% (à la hausse ou à la baisse), le montant de 43%, et le spread de 40%. En revanche, il est rare qu’elle se traduise par un changement de prêteur (11% des cas seulement).
Cette renégociation a lieu relativement tôt dans la vie du contrat, généralement avant la mi-maturité. Elle implique que les deux parties au contrat obtiennent un surplus de renégociation ; la répartition de ce surplus est ensuite fonction de leur pouvoir de négociation.
La renégociation, souvent initiée par l’emprunteur, peut s’expliquer par une modification de sa santé financière. Une augmentation de la valeur des actifs et une diminution du taux d’endettement de l’emprunteur induit, sans surprise, une augmentation du nominal de l’emprunt et une diminution du taux d’intérêt. De même, une amélioration des perspectives d’investissement de l’emprunteur (2) conduit à une renégociation qui lui est particulièrement favorable (hausse du nominal et/ou baisse du taux), en raison de son pouvoir de négociation.
Des facteurs extérieurs au contrat peuvent aussi affecter la renégociation. C’est le cas par exemple de la croissance du PIB : lorsqu’elle augmente, les montants prêtés sont renégociés à la hausse (on dit que la renégociation est « pro-cyclique »).
Enfin, les auteurs montrent que les caractéristiques du contrat initial influencent la manière dont il est renégocié. Si l’intérêt payé par l’emprunteur est lié contractuellement aux flux de trésorerie de l’entreprise (on parle de pricing grid), alors une détérioration de ces flux donne un pouvoir de négociation au prêteur. La banque propose une réduction du nominal et une hausse du taux, ce que l’emprunteur accepte car le montant des intérêts devient trop lourd.
Inversement, en l’absence de pricing grid, l’emprunteur n’a pas d’intérêt direct à renégocier lorsque sa situation se dégrade (les conditions du contrat initial lui étant plus favorable que ce qu’il pourrait espérer). Dans cette situation, c’est donc l’emprunteur qui détient le pouvoir de négociation.
Plus généralement, lorsque le taux d’intérêt du prêt est lié à une variable, une modification forte de cette variable incite à une renégociation. Ce résultat est intéressant : lorsque les contrats de prêts lient le taux à une variable, ils n’évitent pas la renégociation mais en prévoient les conditions.
Cet article est important car il confirme qu’une bonne théorie des crédits bancaires ne peut ignorer la renégociation. Celle-ci concerne la très grande majorité des contrats, porte le plus souvent sur les éléments majeurs, et est de grande ampleur. Puisque la grande majorité des emprunts sont renégociés, la principale fonction de la négociation initiale (et des termes du contrat) est de répartir le pouvoir de négociation entre l’emprunteur et le prêteur.
(1) M.R. ROBERTS et A.SUFI (2009), Renegociation of financial contracts : Evidence from private credit agreements, Journal of Financial Economics, n°93, p.159-184.
(2) Mesurées par le ratio market-to-book.
Q&R : Les métiers de la banque
La grande majorité des groupes bancaires présentent désormais les segments d’activités suivants :
La banque de détail qui s’adresse aux particuliers et généralement aux petites et moyennes entreprises. Elle a une fonction d’intermédiation entre les agents à excédent de financement dont elle collecte les ressources et les agents à besoin de financement à qui elle prête ces ressources. Elle a des millions de clients et de ce fait une dimension de nature industrielle. Un portefeuille important de prêts permettra de réduire le risque en se fondant sur la loi faible des grands nombres : tous les emprunteurs ne peuvent pas faire défaut en même temps (même si un comportement moutonnier et une concurrence à outrance ont pu faire oublier les grands principes d’analyse du risque aux banques en 2006-2007).
Certains services annexes ont été développés par les banques de détail pour compléter leur offre aux entreprises et renforcer leur valeur ajoutée. Ainsi, ces banques pourront assister les entreprises dans la gestion de leurs flux (chèques, virements…) ou de leur trésorerie. Enfin, on trouve également au sein de la banque de détail l’ensemble des activités de services financiers spécialisés pour la clientèle des particuliers (crédit à la consommation, etc.). Les services financiers spécialisés pour les entreprises (affacturage, crédit-bail, etc.) sont généralement inclus dans cette division car très tournés vers les PME.
La banque d’investissement et de financement qui apporte des services sophistiqués à des grandes entreprises dans une logique d’un sur mesure partiel ou total. Elle a quelques milliers de clients tout au plus. Elle offre principalement les services suivants :
• accès au marché actions (equity capital markets) : la banque assiste l’entreprise pour son introduction en Bourse, puis dans les opérations d’augmentation de capital qui suivent : elle contribue à préparer et à réaliser ces opérations. Elle peut également conseiller l’entreprise dans l’émission de produits qui deviendront à terme des actions (bons de souscription d’actions, obligations convertibles) ;
• accès au marché obligataire (debt capital markets) : de même, la banque pourra assister les moyennes et grandes entreprises à lever de la dette directement auprès d’investisseurs grâce à l’émission d’obligations ;
• conseil en fusions et acquisitions : ce service offert par les banques d’affaires n’est pas directement lié au financement d’entreprise ni aux marchés financiers (même si l’appel au marché est parfois le corollaire d’une opération d’acquisition) ;
• accès aux financements bancaires : crédits syndiqués, lignes bilatérales, financements structurés…
• couverture des risques financiers et gestion des opérations de change.
La banque de gestion d’actifs qui a ses propres clients — les investisseurs institutionnels, les particuliers fortunés — mais travaille aussi par le biais de SICAV ou de fonds communs de placement (FCP) pour les clients de la banque de détail. Elle peut avoir besoin de produits de la banque d’investissement (couverture, exécution des ordres…).
À côté des groupes bancaires globaux présents sur l’ensemble des métiers de la banque, certains acteurs ont privilégié une spécialisation sur un nombre réduit d’activités comme les fusions-acquisitions et la gestion d’actifs (Lazard, Rothschild…) ou des géographies plus ciblées (Mediobanca…).