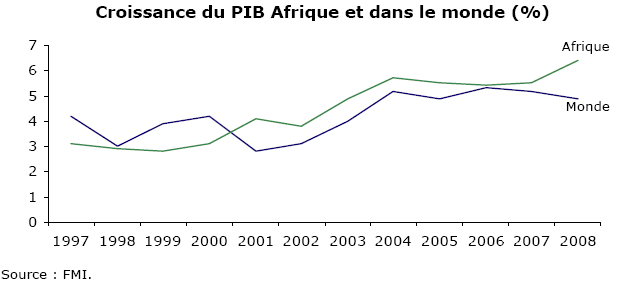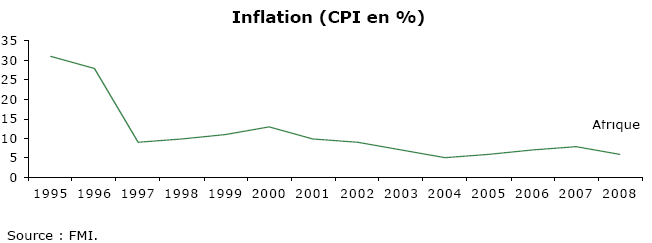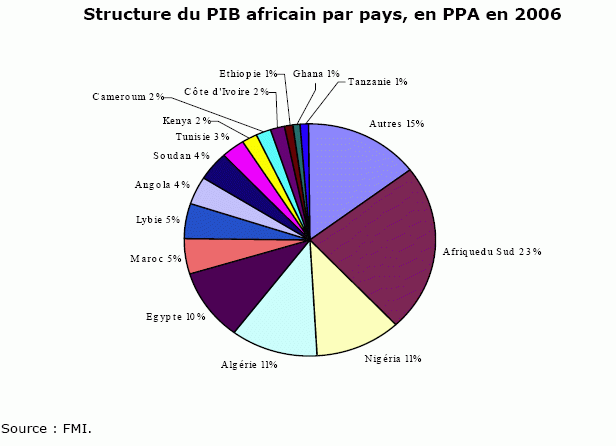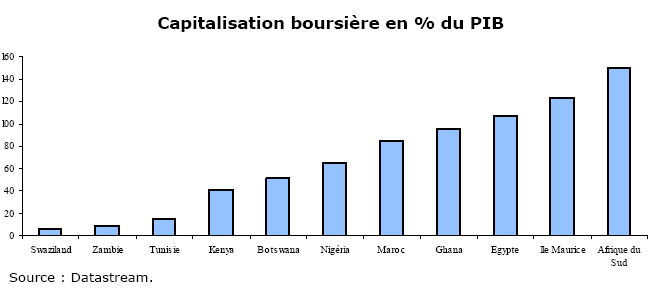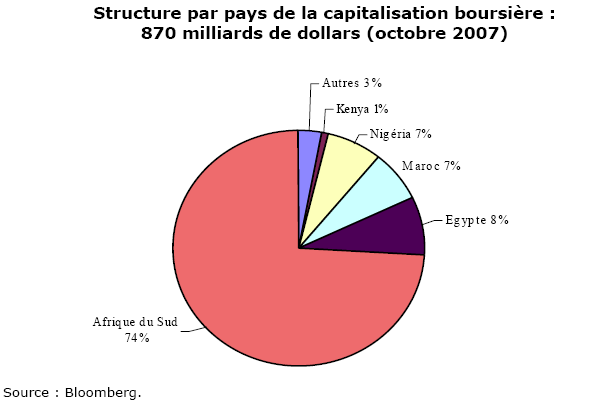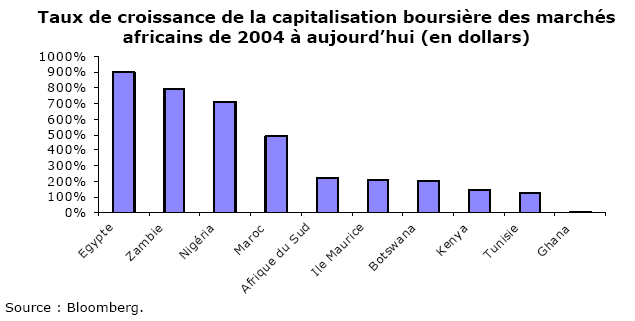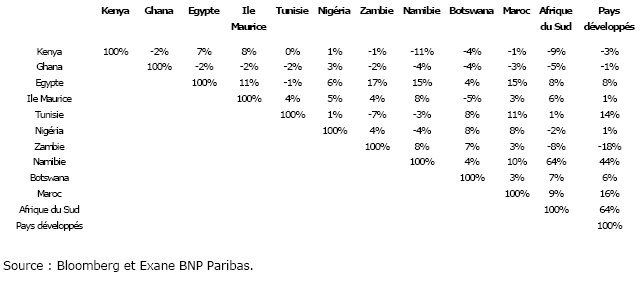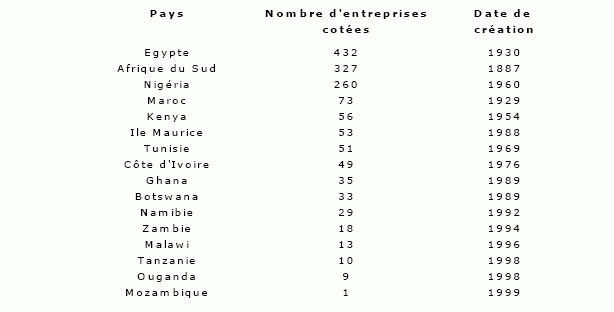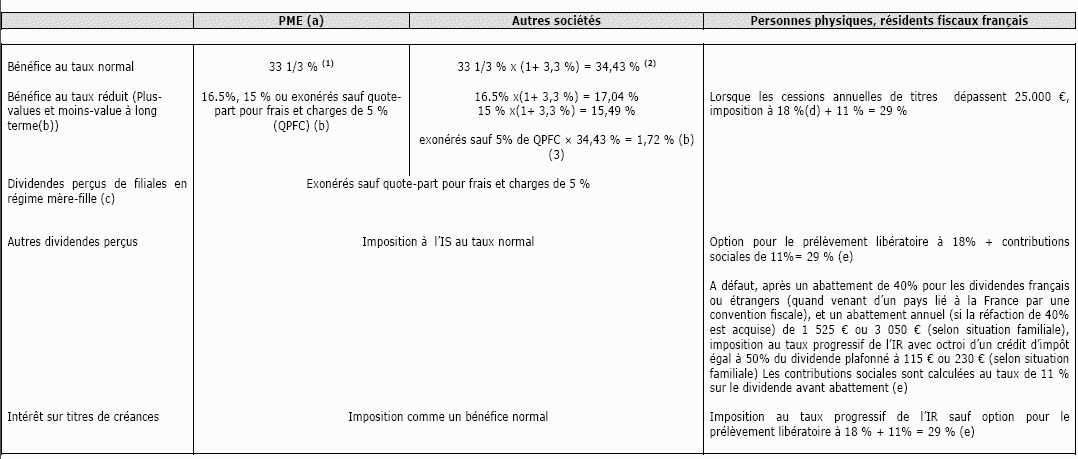Les principales entreprises cotées sont, soit des groupes de télécom (Télécom Maroc, Orascom Télécom, …), des banques (Attjari Wafa Bank, Banque de Tunisie, National Bank of Malawi, …), des groupes miniers (Anglogold Ashanti, Anglo American, Iam Gold, …) bénéficiant souvent d’une double cotation à Londres ou en Australie, des groupes agroalimentaires (SAB Miller, East African Breweries, Zambia Sugar, …) et des filiales locales de groupes multinationaux (Lafarge, Barclays, Standard Chartered, Diageo, ..).
Les bourses constituent la partie visible de la finance africaine mais ne concernent qu’une franche limitée de l’économie. A l’autre extrême se trouve la microfinance (1).
Un système bancaire peu profond
Entre les deux se situe en Afrique Noire un système bancaire peu développé : les crédits alloués au secteur privé représentent en 2006, selon le FMI, 16 % du PIB pour les pays de l’Ouest Africain (UEMOA), 6 % pour ceux de l’Afrique Centrale (CEMAC) contre 84 % en Afrique du Sud (107 % dans les pays développés). La situation est bien différente en Afrique du Nord où certains pays ont un système bancaire développé (Maroc, Egypte) et en Afrique du Sud.
Dans la zone Franc, deux tiers des crédits sont à moins d’un an. En Ouganda, seul 0,5 % des dépôts à terme ont une échéance supérieure à 1 an. Les Etats de l’Afrique Subsaharienne ont une dette dont la maturité moyenne est de 231 jours contre 5,5 ans pour les pays développés. Parallèlement, les banques sont sur-liquides puisque les dépôts en Afrique de l’Ouest représentaient, en 2006, 111 % des crédits au secteur privé et 171 % en Afrique Centrale, et ce malgré un taux de bancarisation dans cette zone de seulement 5 %.
Il en résulte que, selon la Banque Mondiale, 42 % des entreprises de l’Afrique Noire employant moins de 25 personnes n’ont pas accès aux crédits bancaires, et qu’elles sont encore 28 % à être dans ce cas lorsqu’elles ont entre 26 et 100 salariés.
Elles sont les victimes de droits de propriété mal définis (prise de garanties difficiles et longues à mettre en œuvre), d’un système comptable complexe qui pousse à rester dans le secteur informel, de l’insuffisance de cabinets comptables compétents et crédibles, de l’inexistence des centrales de risques. L’asymétrie d’informations pousse à l’autofinancement contraint et forcé.
* * *
Si René Dumont avait publié en 1966 un ouvrage titré « L’Afrique noire est mal partie », qui avait connu une large audience, il nous semble qu’aujourd’hui on pourrait titrer sur « Le nouveau départ de l’Afrique ».
Les progrès fait sur ce continent, l’intérêt qu’il suscite (le groupe financier russe Renaissance vient de lever un fonds de 500 M$ pour y investir, la banque chinoise ICBC va investir 5,5 Md$ dans la banque Standard Bank, …) portent à l’optimisme, même si la route du développement est nécessairement longue et non linéaire.