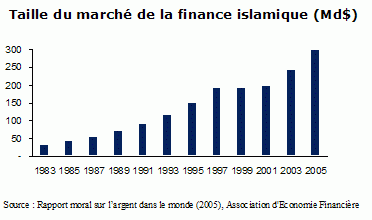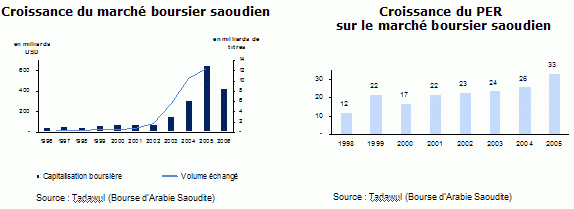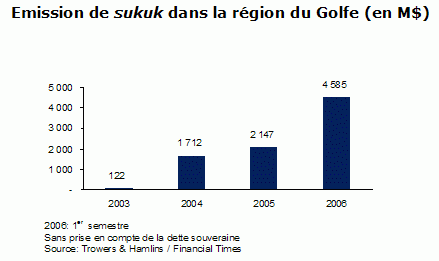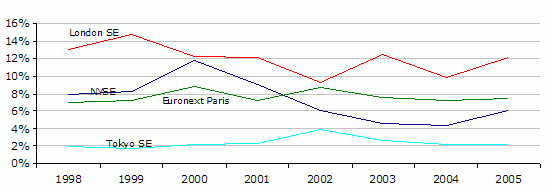La Lettre n°51 de Octobre 2006
Actualités : La finance islamique
La finance islamique contemporaine est née dans les années 1970 suite à la première crise pétrolière. Elle représente aujourd’hui quelques 300 Md$. Le FMI estimait, qu’il existait, à fin 2005, plus de 300 institutions financières islamiques dans plus de 75 pays avec un taux de croissance du secteur de 15 % par an sur les 10 dernières années.
Le marché de la finance islamique a connu une croissance exceptionnelle durant les cinq dernières années. Cette croissance s’explique essentiellement par le rapatriement des fonds moyen-orientaux vers leur pays d’origine suite aux événements du 11 septembre 2001, l’essor économique et la croissance boursière qu’a connues la région, à l’image du marché boursier saoudien dont la capitalisation boursière a été multipliée par 10 et les PER par 2 durant les 5 dernières années.
Les banques « conventionnelles » n’ont pas tardé à réagir afin de ne pas perdre une partie de cette manne, voire de gagner de nouveaux clients, et ont pour beaucoup d’entre elles lancé leur propres filiales islamiques.
A titre d’exemple, la part des produits islamiques dans le système bancaire des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) représente 17 % des actifs totaux. Ces actifs représentent, quant à eux, uniquement 28% des actifs financiers islamiques dans le monde.
Le marché des fonds d'investissement islamiques est aussi un des secteurs de la finance islamique qui connaît une très grande croissance. Actuellement, il y a environ 100 fonds islamiques de private equity dans le monde. Le total des actifs gérés par ces fonds excède 5 Md$; même si ce montant est en très forte croissance, il reste très faible lorsque l’on sait qu’actuellement chacun des grands fonds de LBO est en train de lever 3 fois cette somme.
Principes de la finance islamique
La lois islamique (Charia) ne s’oppose pas au principe multimillénaire de la rémunération de l’argent prêté, mais au caractère fixe et prédéterminé du taux d’intérêt (Riba). En effet, la finance islamique considère que le fondement de la rémunération de l’argent placé est la rentabilité de l’actif ainsi financé et elle seule. Elle exclut par principe l’idée d’une rémunération fixe, déconnectée de la rentabilité de l’actif financé.
Autrement dit, la finance islamique se base sur le principe de partage des pertes et profits. L’obligation principale pour une transaction financière est qu’elle doit se fonder sur un actif tangible afin de permettre le partage des pertes et profits que cet actif génère.
Si dans la conception classique le fondement du taux d’intérêt est la rémunération de la renonciation a une liquidité immédiate et donc potentiellement à une consommation immédiate (1), elle est donc tout autre en finance islamique.
En théorie cela devrait permettre le règne des capitaux propres puisque l’emprunteur sait qu’en cas de difficultés sa dette et sa rémunération n’ont pas le caractère d’exigibilité qu’on lui connaît habituellement. Les coûts fixes financiers n’existent pas, puisqu’en cas d’adversité, ils deviennent des coûts variables. L’effet de levier est donc inexistant, ce qui devrait se traduire par moins de faillite d’entreprises, donc par des rentabilité économiques plus faibles : les acteurs les moins efficaces, n’étant pas éliminés par la faillite, peuvent poursuivre plus longtemps une activité avec des marges faibles qui tirent vers le bas la rentabilité des secteurs.
A l’inverse, la possibilité de faire fortune en tant qu’entrepreneur paraît plus limitée sans le recours possible à un effet de levier bien utilisé qui a, par exemple, permis à B. Arnault (LVMH) et F. Pinault (PPR – Artémis) de devenir en 25 ans les deux entrepreneurs les plus riches de France, sans parler de L. Mittal hors de l’hexagone.
L’Islam condamne également toute spéculation (Gharar), tout pari sur l’avenir. Ainsi, les systèmes de vente à découvert, options, swaps, ..., sont interdits dans un système financier islamique.
Pour s’assurer de la parfaite adéquation des produits qu’elles proposent avec les préceptes islamiques, les banques islamiques se sont dotées de comités indépendants, les « Conseils de Charia » ou Sharia boards composés de théologiens spécialisés en droit financier. Ces comités participent activement au développement et à la surveillance des produits des banques. Ils sont, également, responsables de certifier que chaque produit adhère strictement aux principes de la Charia.
Les produits financiers islamiques standards
Les principaux produits islamiques sont :
• Murabaha (Intermédiation)
L’institution financière émettrice joue le rôle d’un intermédiaire commercial, achetant des marchandises nécessaires à ses clients et les leur revendant en différé moyennant profit. On se rapproche de la titrisation (2) ou du portage (3).
• Mudharaba (Commandite)
C’est un contrat entre une institution financière et une entreprise, l’une agissant comme bailleur de fonds « commanditaire » et l’autre agissant comme manager « commandité », pour investir dans une activité ou une classe d'actif prédéterminée qui octroie à chacun une part du résultat déterminée lors de l’investissement. Le commandité ne partage pas les pertes, la perte financière incombe au bailleur de fonds seulement ; la perte du manager étant le coût d’opportunité de sa propre force de travail qui a échoué de générer un surplus de revenu.
• Musharaka (Association)
C’est un partenariat entre une institution financière et une entreprise sur la base duquel l’institution financière comme l’entreprise investissent dans le projet. L’institution financière et son partenaire partagent les profits et les pertes selon des proportions prédéfinies. On est proche du concept de tour de table avec des industriels et des financiers qui a été utilisé pour monter nombre d’affaires nouvelles en leur temps (Total, RTL, M6, Bouygues Télécom, …).
Il existe une deuxième forme de Musharaka :la Musharaka décroissante par laquelle l’entreprise consent à racheter la part de l’institution financière après une période donnée. Là on se rapproche du portage.
• Ijara (Crédit-bail)
C’est un contrat d'achat dans lequel une institution financière achète un équipement ou une propriété et le loue en crédit-bail à une entreprise.
L’Ijara peut prendre la forme d’Ijara-wa-Iqtina (crédit-bail avec promesse d’achat). Ce contrat est similaire à l’Ijara mais inclut une promesse d’achat du bien de la part du client à la fin du contrat.
Enfin, une troisième variante de l’Ijara est l’Ijara avec Musharaka décroissante. Ce contrat peut être utilisé pour l’achat d’immobilier. La part de l’institution financière dans le bien loué diminue avec les paiements de capital que le client effectue en sus du paiement des loyers, l’objectif étant, à terme, le transfert de propriété du bien au client.
• Wakala (Agence)
C’est un contrat d’agence incluant, généralement, des frais d’expertise. Les banques l’utilisent souvent pour les grands comptes de dépôt : le client possède les capitaux investis, il nomme une banque islamique comme agent et paye une commission d'expertise pour rémunérer le travail de gestion des fonds par la banque.
• Salam (Forward)
C’est un accord à court terme par lequel une institution financière verse, d'avance, les montants correspondant à la livraison future d'une quantité définie de marchandises. Un Salam est principalement utilisé pour le financement des marchandises. Il est semblable à un forward (4) où la livraison est à une date future en échange du paiement au comptant.
• Istisna’a (Contrat de traitance)
C’est un contrat d’entreprise en vertu duquel une partie (Moustasni’i) demande à une autre (Sani’i) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme. Il s’agit d’une variante qui s’apparente au contrat Salam à la différence que l’objet de la transaction porte sur la livraison, non pas de marchandises achetées en l’état, mais de produits finis ayant subi un processus de transformation.
L’ Istisna'a fournit donc un financement à moyen-long terme pour couvrir les besoins de financement pour la fabrication, la construction ou la fourniture de produits finis.
Il apparaît clairement que les produits financiers islamiques les plus proches des produits bancaires classiques (Ijara – crédit bail, Murabaha – portage, titrisation) sont les plus pratiqués (68% en 2005) et que les produits les plus risqués pour les institutions financières (Mudharaba - commandite, Musharaka – participations minoritaires) ne représentent que 17% en 2005.
Le rêve (ou le cauchemar !) d’un monde fait uniquement de capitaux propres évoqué plus haut est donc loin d’être réalisé. Il est vrai qu’il n’y a pas de miracle en finance.
Autres produits financiers islamiques
En finance islamique, les comptes courants et compte d’épargne ne sont pas rémunérés. Ces dépôts sont considérés comme des prêts (Qard) et leur remboursement est garanti. En effet, et selon le principe de la confiance (al-wadiah), le contrat liant la banque et ses clients dans le cadre d’un compte courant ou un compte d’épargne est un contrat établi pour protéger les richesses des épargnants.
Les «comptes d’investissement» destinés à financer des placements sont, quant à eux, rétribués en fonction du résultat dégagé par ces mêmes placements. L’épargnant peut ainsi perdre tout ou partie du montant initial.
Les produits obligataires islamiques sont représentés par les Sukuk. Le Sukuk est à la finance islamique ce que les Asset Backed Securities (ABS) sont à la finance conventionnelle. Il a une échéance fixée d'avance et est adossé à un actif permettant de rémunérer le placement en contournant le principe de l'intérêt. Sans surprise, les Sukuk sont structurés de telle sorte que leurs détenteurs courent un risque de crédit et reçoivent une part de profit et non un intérêt fixe et commun à l’avance comme dans un ABS.
Les produits sous-jacents des Sukuk peuvent être représentés par des contrats tels l’Ijara, la Musharaka ou la Mudharaba.
C’est le groupe financier saoudien Dallah Albaraka qui a émis le premier Sukuk en 1998. Le marché des Sukuk dépasserait les 10 Md$.
Les produits financiers islamiques se sont, par ailleurs, adaptés aux besoins des épargnants et des institutions financières suivant les évolutions de la finance moderne avec le développement de l’ingénierie financière et l’apparition de produits structurés tels les Sukuk convertibles et les produits de couverture de risque.
La couverture de risque ou hedging fait traditionnellement appel aux options, des produits financiers interdits par la Charia. La couverture des risques en adéquation avec la finance islamique nécessite, par conséquent, des montages complexes et un effort de structuration plus important. Les produits islamiques de couverture de risque en sont donc encore à leur début.
Comme l’aversion au risque ou l’appétence pour le risque sont des traits de caractère les moins également partagés au monde, le potentiel de croissance de ces produits est fort !
* * *
D'une niche spécialisée, la finance islamique a crû très rapidement durant les trois dernières décennies pour devenir une industrie mondiale portant sur plusieurs centaines de Md$.
Il n’est pas à douter que les institutions financières continueront d’adapter leurs produits pour profiter de la liquidité actuellement présente dans les pays musulmans.
Article rédigé par Mehdi Sethom et Younès Molato.
(1) Pour plus de détails, voir le chapitre 19 du Vernimmen 2005.
(2) Pour plus de détails voir le chapitre 52 du Vernimmen 2005.
(3) Pour plus de détails voir le chapitre 52 du Vernimmen 2005.
(4) Pour plus de détails voir le chapitre 53 du Vernimmen 2005.
(2) Pour plus de détails voir le chapitre 52 du Vernimmen 2005.
(3) Pour plus de détails voir le chapitre 52 du Vernimmen 2005.
(4) Pour plus de détails voir le chapitre 53 du Vernimmen 2005.
Tableau : Les sorties de cote
L’AMF a publié récemment une intéressante étude sur les sorties de cote (1). Ce travail montre qu’il concerne chaque année une fraction relativement stable des sociétés cotées : de 2 % au Japon à 7 % en France et aux Etats-Unis et jusqu’à 12 % au Royaume-Uni.
Comme l’écrivent les auteurs de cette étude, « cette disparition régulière d’entreprises de la cote peut être rapprochée du principe de « destruction créatrice » défini par Schumpeter et inhérent au système capitaliste ».
(1) Pour plus de détails sur les sorties de cote, voir le chapitre 47 du Vernimmen.
Recherche : Contrôle familial et performance
Les relations entre les actionnaires et les dirigeants des entreprises font partie des questions les plus explorées par la théorie du gouvernement d’entreprise. L’article fondateur de A. Berle et G. Means (1932) (1) a mis en évidence le problème d’agence entre l’actionnaire et le chef d’entreprise (problème d’agence n°1), le second n’ayant pas nécessairement les mêmes intérêts que le premier.
En 1986, A. Schleifer et R. Vishny (2) ont expliqué qu’un autre problème d’agence pouvait exister, entre l’actionnaire majoritaire et les minoritaires (problème d’agence n°2). Si l’existence d’un actionnaire majoritaire permet un meilleur contrôle du dirigeant et réduit ainsi le problème n°1, cet actionnaire peut aussi détourner (de manière légale ou illégale) une partie des bénéfices de l’entreprise à son profit, au détriment des minoritaires.
Un problème d’agence se substitue ainsi à un autre. Au total, la présence d’un actionnaire majoritaire augmente-t-elle la valeur de l’entreprise ? Autrement dit, le problème n°2 est-il moins grave que le problème n°1 pour la communauté des actionnaires, et en particulier les minoritaires ? C’est à cette question que permet de répondre l’étude des entreprises dites « familiales », c’est-à-dire celles dont l’actionnaire principal est un individu ou une famille. En effet, lorsque l’actionnaire principal est institutionnel, il est lui-même, le plus souvent, la propriété de plusieurs actionnaires. Son incitation au contrôle et à l’expropriation des minoritaires est donc moins importante. L’étude des entreprises familiales permet de mettre plus facilement en évidence les effets typiques de l’actionnariat majoritaire.
Dans une étude portant sur les plus grosses entreprises familiales américaines sur la période 1994-2000, B. Villalonga et R. Amit (2004) (3) montrèrent que la propriété familiale n’est favorable à la valorisation de l’entreprise que lorsque le fondateur fait lui-même partie de l’équipe dirigeante. Les auteurs ont étudié pour cela la valorisation des plus grandes sociétés cotées américaines entre 1994 et 2000. Lorsque l’actionnaire fondateur dirige l’entreprise, il réduit le problème d’agence n°1, ce qui se traduit par un ratio q de Tobin (4) plus élevé. En revanche, lorsque ce sont ses descendants qui prennent le contrôle de l’entreprise, le problème d’agence n°2 devient plus important. A l’expertise du fondateur succède un contrôle excessif de sa famille, au détriment des minoritaires. Le problème devient plus élevé lorsqu’il existe des mécanismes de renforcement du contrôle, comme différentes classes d’actions.
B. Maury (2005) (5) étudie pour sa part l’impact de la propriété familiale sur les sociétés cotées européennes. L’intérêt particulier de cet article est de distinguer la valorisation (estimée par le ratio q de Tobin) et la profitabilité (estimée par la rentabilité sur actif ou return on assets).
Il montre que la propriété familiale augmente systématiquement et significativement la profitabilité de l’entreprise (grâce à la réduction du problème d’agence n°1). En revanche, cette profitabilité accrue ne se traduit pas par une meilleure valorisation si la famille possède une majorité forte et que la protection des actionnaires minoritaires est faible. Une partie du profit serait bien « détournée » d’une façon ou d’une autre par la famille majoritaire (problème d’agence n°2). Finalement, l’auteur tend à démontrer que la propriété familiale n’est favorable à l’ensemble des actionnaires que lorsque la concentration de l’actionnariat n’est pas excessive et qu’elle s’exerce dans des environnements bien réglementés.
(1) Berle A. et Means G., 1932, The Modern Corporation and Private Property, Harcourt, Brace & World, New York.
(2) Shleifer A. et Vishny R., 1986, Large Shareholder and Corporate Control, Journal of Political Economy, 94, pages 461-488.
(3) Villalonga B. et Amit R., How do Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value ?, Journal of Financial Economy, 80, pages 385-417.
(4) Rapport de la valeur boursière de l’entreprise sur la valeur de ses actifs.
(5) Maury B., Family Ownership and Firm Performance : Empirical Evidence from Western European Corporations, Journal of Corporate Finance, 12, pages 321-341.
Q&R : Qu'est-ce qu'un staple financing ?
Au pied de la lettre, il s’agit d’un « financement agrafé ou épinglé ». Lors de la vente d’une entreprise (1) une banque propose à tout acquéreur qui le désire un financement lui permettant de financer une partie de l’acquisition. D’entrée de jeu, l’acquéreur putatif connaît ainsi les conditions (montant, taux, durée, mode d’amortissement, covenants, documentation,..) d’un financement bancaire possible.
En très peu de temps, le staple financing est devenu une pratique répandue que l’on trouve dans à peu près la moitié des transactions, en particulier dans les transactions entre fonds de LBO dans le cadre de LBO secondaires, tertiaires,…
Le vendeur trouvera dans le staple financing l’assurance d’éviter qu’un accord conclu avec un acheteur ne se concrétise jamais, faute pour ce dernier d’avoir pu obtenir le financement bancaire nécessaire. Il peut aussi espérer que proposer un financement dès le début du processus accroisse le nombre d’acheteurs potentiels, et donc, in fine le prix. Par ailleurs le staple financing permet d’accélérer le processus de vente, et donc, de minimiser les risques de fuite, même si elles sont inhérentes à un processus de vente aux enchères, en particulier, avec des fonds d’investissement. Dans les transactions entre fonds de LBO, le staple financing fait partie de la panoplie standard fournie dès le début du processus avec la vendor due diligence et le contrat d’acquisition. Il peut permettre de réaliser une transaction en un mois.
L’acheteur y trouvera a minima un financement certain qui lui permet de gagner du temps, et dans le meilleur des cas, une base de négociation pour convaincre d’autres prêteurs potentiels de lui prêter dans de meilleures conditions. En effet, le staple financing n’est généralement pas une obligation pour l’acheteur, c’est simplement une option. Dans certains cas, nous avons vu la banque offrant le staple financing négocier avec le vendeur un droit à participer pour une quote-part au financement qui sera mis en place par un de ses concurrents bancaire si le staple financing qu’il proposait n’a pas été retenu. Ceci n’est pas sans compliquer la négociation finale puisque le vendeur devait alors demander à l’acheteur de faire de la place dans le crédit d’acquisition pour la banque du staple financing. Cela montre aussi que celui qui propose ce type de financement est loin d’être sûr de gagner à tous les coups !
La banque conseil du vendeur n’est pas nécessairement la banque qui propose le staple financing. D’abord parce que toutes les banques n’exercent pas nécessairement ces deux activités, puis parce que l’intérêt du vendeur comme de l’équipe qui le conseille est que les conditions du staple financing soient les meilleures possibles afin d’espérer maximiser le prix de vente.
Lorsque la même banque tient ces deux rôles on pourrait craindre des risques de conflits d’intérêts : le conseil du vendeur aurait aussi pour client l’acheteur à qui il prête des fonds sur la même transaction. Un acheteur sera de son côté d’autant plus enclin à prendre le staple financing qu’il espère se mettre ainsi dans les bonnes grâces du conseil du vendeur. Comme la banque gagne généralement plus en commissions de mise en place du financement bancaire (versées par l’acheteur) qu’en commissions de conseil en fusion/acquisition (versées par le vendeur), le vendeur pourrait craindre que son conseil le pousse à choisir l’offre d’un acheteur qui prend le staple financing plutôt que l’offre la meilleure pour lui.
Ce serait oublier que le vendeur est rarement myope, en particulier les fonds de LBO qui ne sont pas peuplés d’enfants de chœur ; que la rémunération plus élevée de la banque dans ce cas n’est que la contrepartie d’une prise de risque forte que la bonne conjoncture actuelle ne doit pas faire oublier ; et qu’enfin le banquier conseil, attaché à la pérennité de sa relation avec son client le vendeur, le préférera à ses collègues du département bancaire. Cela vaut toute les murailles de Chine !
(1) Pour les techniques de vente d’une entreprise, voir le chapitre 47 du Vernimmen 2005.