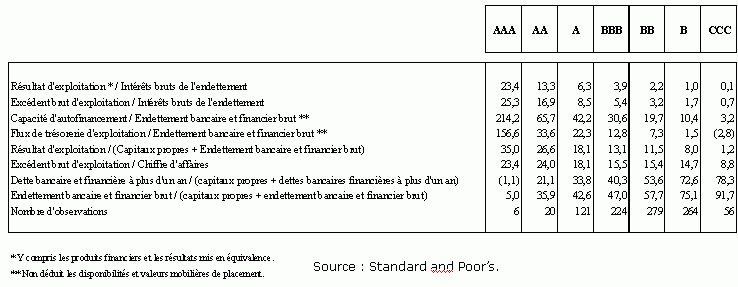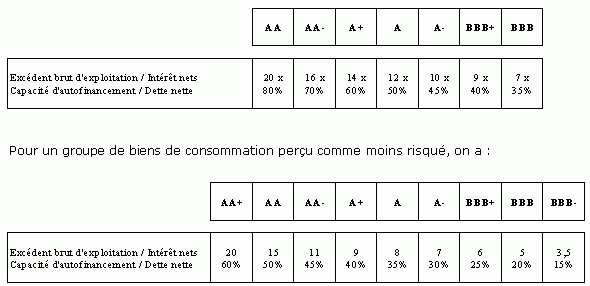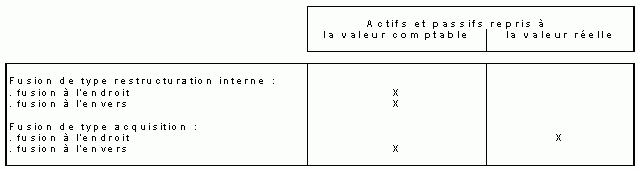La Lettre n°32 de Octobre 2004
Actualités : La société européenne
Le statut de la SE a fait l’objet d’un Règlement communautaire (1) en date du 8 octobre 2001. Une Directive (2) du Conseil, également du 8 octobre 2001, l’a complété en ce qui concerne l’implication des salariés.
La date d’entrée en vigueur du Règlement communautaire est fixé au 8 octobre 2004. Toutefois, ses dispositions ne pourront être appliquées dans un Etat membre qu’à compter du jour où cet Etat aura transposé en droit interne la Directive européenne sur l’implication des salariés et aura procédé à l’adaptation de son droit interne à la SE sur les points non couverts par le Règlement ou sur ceux pour lesquels les Etats membres disposent d’une option. A ce jour, aucun projet de loi portant sur la SE n’a été rendu public en France. Des parlementaires ont bien déposé des propositions de loi en ce sens, mais on ne sait toujours pas quand le sujet sera à l'ordre du jour au parlement. Notons que la Belgique a déjà fait son devoir et que le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont sur le point de les faire.
Pourquoi créer une société européenne ? L’enjeu de la SE est de faire disparaître les contraintes juridiques, financières et pratiques qui résultent de vingt-cinq ordres juridiques différents qui gênent les entreprises souhaitant s’organiser au niveau communautaire. Elle permettra de diminuer les coûts administratifs en réduisant le nombre de sociétés nécessaires à l’activité. Elle créera une plus grande fluidité dans la mise en œuvre des décisions.
La SE permettra ainsi de constituer une société qui ne soit ni française, ni allemande, ni italienne … mais "européenne". En particulier, l’institution de la SE apparaît comme un outil tout-à-fait approprié pour faciliter les fusions transfrontalières, opérations souvent quasiment impossibles à mettre en œuvre en raison des distorsions et des incompatibilités des législations applicables dans les différents Etats membres. On est alors obligé de passer par des offres, des apports ou des structures très compliquées comme les dual-listing (Reed Elsevier, Shell).
Par exemple, un groupe italien pourrait éviter de lancer une OPE pour s’unir avec un groupe espagnol en fusionnant tout simplement avec ce dernier et en créant ainsi une société qui ne sera ni italienne, ni espagnole mais européenne. De plus, la fusion ne devrait normalement pas être perçue par l’environnement espagnol comme une prise de contrôle d’un actif national par des intérêts italiens comme peut l’être une offre publique.
Comment créer une société européenne ? Techniquement, quatre modes de constitution d’une SE sont prévus : la constitution par fusion, par création d’une société holding, sous forme de filiale commune et par transformation d’une société anonyme de droit national (ayant des activités dans au moins deux Etats membres).
Sans être bien sûr exhaustifs, nous avons indiqué ci-après, les principaux enjeux techniques relatifs à la constitution d’une SE à avoir en tête :
-
Siège social : si la SE est avant tout européenne, son siège social doit se situer dans un pays membre. Ce choix est important car il déterminera l’application des lois nationales sur un certain nombre de points non couverts par les dispositions communautaires (droit des sociétés notamment). Insistons bien sur ce point : même si la société est européenne, elle se rattache à un droit local pour les dispositions que la réglementation européenne ne traite pas.
Par ailleurs, le siège social doit se situer dans le même Etat que celui où se trouve son administration centrale, c’est-à-dire son siège réel. Ultérieurement, il pourra être transféré dans un autre Etat membre sans dissolution ni création d’une nouvelle personne morale à condition que le siège réel se déplace également.
-
Corporate Gouvernance : la SE pourra revêtir soit une organisation selon le système dualiste (organe de direction et organe de surveillance) soit selon le système moniste (organe d’administration classique). Il est à noter que le droit français connaît déjà ces deux systèmes ce qui n’est pas le cas de tous les pays européens : l’Allemagne ne connaît que le système dualiste que la Belgique ignore.
-
Participation des salariés : il est prévu que les salariés interviennent au niveau de la surveillance et du développement de la stratégie de l’entreprise. La loi nationale peut choisir entre plusieurs modèles de participation des salariés :
- soit le modèle intégrant les salariés au sein de l’organe de surveillance ou d’administration ;
- soit celui d’un organe distinct représentant les salariés de la SE ;
- ou tout autre modèle à construire contractuellement.
-
Capital social : la SE doit avoir un capital minimal de 120.000 euros, seuil ne constituant pas une barrière pour les groupes développant leurs activités à l’échelle européenne ;
Toutefois, il est important de noter que la constitution d'une SE supposera une négociation sur l'implication des salariés avec un organe représentant tous les salariés des sociétés participantes. Il sera impossible pour une SE de se constituer et de pouvoir fonctionner tant que le volet social sur la participation des salariés n'aura pas été réglé.S’il se révèle impossible de parvenir à un accord satisfaisant, un jeu de principes "standard" s’appliquera alors.
Dans le cas d’une SE constituée dans le cadre d’une fusion, les principes "standard" concernant la participation des salariés s’appliqueront automatiquement si 25% au moins des salariés bénéficiaient auparavant, avant la fusion, d’un droit de participation aux décisions. Autrement dit, les groupes situés dans des pays connaissant des droits sociaux contraignants (Allemagne) ne pourront pas profiter de leur fusion dans une SE pour réduire significativement les droits des salariés.
-
Fiscalité : sur le plan fiscal, la législation européenne relative à la SE est encore en voie de définition. Par exemple, en matière d’impôt sur les sociétés, la SE sera traitée comme n’importe quelle multinationale c’est-à-dire qu’elle sera soumise au régime fiscal de la législation nationale applicable au niveau de la société comme de ses succursales. Les SE resteront donc assujetties aux impôts de tous les Etats membres où leurs établissements stables seront situés. Par ailleurs, la Directive visant à mettre en place un régime fiscal favorable des remontées de dividendes notamment pour les SE, doit être transposée par les Etats membres avant le 1er janvier 2005.
* * *
En conclusion, si la SE apparaît comme un outil visant à favoriser la gestion et la constitution des groupes européens, de nombreuses questions restent encore en suspens tant que tous les pays européens n’auront pas transposé la réglementation européenne dans leurs droits nationaux. Espérons que ce sera le cas rapidement. En théorie, tout aurait dû être prêt le 8 octobre 2004, mais il faudra probablement attendre plus longtemps pour voir apparaître la première société européenne.
Rome ne s’est pas faite en un jour…
(2) Une Directive formule un certain nombre de résultats à atteindre. Elle doit donc être traduite dans le droit interne des Etats membre de l'Union Européenne par des mesures de transposition.
Tableau : Les critère des agences de rating
En effet, les caractéristiques sectorielles (partage coût fixe / coût variable, sensibilité à la conjoncture, visibilité, …) font qu’un euro de cash flow n’a pas le même niveau de pérénité et donc de risque dans l’agroalimentaire que dans la sidérurgie par exemple.
A titre d’exemple, on estime qu’actuellement un groupe phamaceutique présentant les ratios financiers suivants est éligible à une notation, selon l’échelle de Standard and Poor’s, suivante :
Recherche : Pourquoi les dividendes sont-ils de nouveau à la mode ?
Le récent exemple de Microsoft, qui n’avait initié sa distribution de dividendes que très récemment, est à ce titre particulièrement illustratif du changement de comportement des entreprises et de leurs dirigeants. En juillet, le géant du logiciel a annoncé qu’il paierait un dividende exceptionnel de 32 Md$ cette année, et distribuerait 44 Md$ sous la forme de rachat d’actions et de dividendes au cours des quatre prochaines années. Comment expliquer qu’une société qui s’était abstenue si longtemps accepte enfin redistribuer une partie de sa trésorerie à ses actionnaires sous forme de dividendes ?
Cette question nous semble d’autant plus intéressante que cette tendance au retour du paiement de dividendes touche tant les Etats-Unis que l’Europe : Veolia vient de s’engager à augmenter pendant les trois prochaines années son dividende de 15% par an. Même les entreprises des secteurs high-tech, dont on disait qu’il valait mieux qu’elles s’abstiennent d’une telle politique pour mieux profiter de leurs opportunités de croissance, se mettent de la partie. Des éléments de réponses à ces questions peuvent être tirés du travail de recherche de Malcom Baker et Jeffrey Wurgler sur la politique de dividendes.
Quels sont les comportements des entreprises concernant leur politique de redistribution des bénéfices ? M. Baker et J. Wurgler (1) montrent qu’aux Etats-Unis le pourcentage effectif des entreprises qui ont payé des dividendes a constamment diminué au cours des quarante dernières années, à l’exception de la période 1971-1977.
Toutefois, cette simple analyse ne permet pas de comprendre l’évolution générale de la politique de distribution de dividendes des entreprises, toutes choses égales par ailleurs. En effet, les caractéristiques des entreprises ont largement évolué au cours du temps, et il est évident qu’une entreprise opérant dans un secteur dans lequel les opportunités de croissance sont élevées aura une incitation à distribuer des dividendes plus faible qu’une entreprise d’un secteur plus mûr nécessitant relativement peu d’investissements (2).
Les auteurs prennent donc en compte cette objection, et construisent une mesure de ce qu’ils appellent la propension (3) des entreprises américaines du New York Stock Exchange à distribuer des dividendes. En procédant de la sorte, et en se concentrant sur les variations annuelles de cette mesure, ils parviennent à distinguer quatre grands régimes de distribution des dividendes entre 1963 et 2000 :
- de 1963 à 1966-68, la propension des entreprises à payer des dividendes augmente chaque année; de 1967-69 à 1972-74, la propension des entreprises à payer des dividendes diminue chaque année ;
- de 1973-1975 à 1977, elle augmente à nouveau ;
- à partir de 1978 la propension à payer des dividendes diminue de manière constante jusqu’à la fin de la période étudiée, c’est à dire en l’an 2000, atteignant un niveau historiquement bas.
Parallèlement à cette étude historique, les auteurs tentent de mesurer l’évolution au cours du temps de ce qu’ils appellent une “ prime de dividende ”. Cette variable mesure le différentiel moyen de valorisation entre les entreprises qui distribuent des dividendes et les entreprises qui n’en distribuent pas.
L’hypothèse qui est avancée par les auteurs est que les marché financiers ne sont pas efficients sur ce point (4) et que la prime, ou la décote, accordée par les marchés financiers aux entreprises payeuses de dividendes, non justifiée, influence de manière significative la politique de distribution de l’ensemble des dirigeants d’entreprise. Ceux-ci, ajusteraient leur politique de distribution, afin de faire bénéficier leur entreprise, à court terme, de la prime de distribution ou de non distribution de dividende. En un mot lorsque les dividendes sont à la mode comme aujourd’hui, en verser de copieux se traduit souvent, toutes choses égales par ailleurs, par une meilleure valorisation de l’action. A l’inverse, ne pas en distribuer, c’est prendre le risque fort d’avoir un cours sous-évalué. Bref, d’une certaine façon, il suffit aux investisseurs d’en demander pour en obtenir compte tenu du mécanisme de sanction / récompense au niveau de la valorisation !
L’analyse des données semble donner raison à nos chercheurs. L’étude de l’évolution au cours du temps de la prime de dividende correspond assez précisément aux quatre périodes observées précédemment. En période de prime positive des dividendes, les entreprises ont une propension croissante à payer des dividendes, un grand nombre d’entreprise tend à initier un paiement de dividendes, alors qu’en période de prime négative, ou de “décote des dividendes”, la proportion d’entreprises distribuant des dividendes diminue significativement.
Toutefois comment s’assurer que ce phénomène résulte d’une non rationalité des marchés financiers ? Dans leur second article (5), M. Baker et J. Wurgler tentent de justifier empiriquement que les marchés sont effectivement inefficients sur ce point. En effet, dans le cadre de leur théorie, dans les périodes où les marchés valoriseraient relativement mieux les entreprises distributrices de dividendes, si cette valorisation était irrationnelle, on devrait observer une rentabilité ultérieure de leurs actions plus faible que celle des entreprises non distributrices de dividendes. C’est l’effet «gueule de bois» de tout phénomène de mode. Les auteurs montrent que c’est effectivement le cas.
Inversement, dans les périodes où les marchés valorisent relativement mieux les entreprises non distributrices de dividendes, la rentabilité ultérieure de leurs actions devrait être moins bonne, selon la théorie développée par les auteurs, que celle des entreprises distributrices de dividendes. Encore une fois, cette prédiction est observée empiriquement. Les marchés semblent donc bien inefficients sur ce point, et les dirigeants d’entreprises seraient opportunistes dans leur politique de distribution.
Cette analyse suggère donc une interprétation intuitive de la politique de distribution des dividendes suivie en moyenne par l’ensemble des entreprises. La prime de dividende tend à être négative, et la propension à payer des dividendes pour l’ensemble des entreprises devient négative, lorsque le sentiment envers les titres de croissance (typiquement de faibles distributeurs de dividendes) est positif. C’est ce que l’on a pu observer à la fin des années 1960 et depuis la fin des années 1970 jusqu’en 2000 et l’éclatement de la bulle TMT. Inversement lorsque le sentiment envers ce type de titres est négatif, la prime de dividende augmente car les investisseurs se portent davantage vers des titres ayant moins d’opportunités de croissance, c’est à dire moins risqués. Dans ce cas, les dividendes tendent à faire leur réapparition pour l’ensemble des entreprises, malgré le traitement fiscal défavorable qu’ils supportent souvent par rapport, notamment, aux gains en capital (6).
Ainsi, aujourd’hui, les entreprises et leurs dirigeants ne feraient que répondre à la demande des investisseurs pour le paiement des dividendes. Ces investisseurs, sans doute traumatisés par les faibles performances boursières passées des titres de croissance, réagiraient de manière excessive en attribuant une prime élevée aux titres versant des dividendes, faisant leur la devise “ un tiens vaut mieux que tu l’auras ”. Toutefois, il est à prévoir que du fait de cette réaction excessive, les bonnes affaires futures soient à trouver parmi les titres ne versant pas de dividendes, car d’après l’étude de M. Baker et J. Wurgler, ce sont ces actions qui vont bénéficier, dans le futur, de performances supérieures aux actions payant des dividendes…
A moins que maintenant que cette recherche a été publiée, le marché ait corrigé de lui-même ce biais. L’avenir nous le dira.
Au total, M. Baker et J. Wurgler nous disent que les dividendes sont de nouveau à la mode tout simplement parce que les investisseurs en veulent et qu’ils sont prêts à surpayer une action qui verse de copieux dividendes et à sous payer celle qui pratique l’austérité dans ce domaine.
(2) Voir “Mais que sont devenus les dividendes ?”, Lettre Vernimmen.net de septembre 2001.
(3) Les auteurs calculent la propension à payer des dividendes en mesurant la différence entre la proportion effective d’entreprises payant des dividendes à une période donnée et la proportion théorique espérée, calculée statistiquement d’après les caractéristiques du marché à cette date et l’historique complet des données.
(4) L’efficience des marchés telle qu’elle a été définie par E. Fama recouvre en réalité trois niveaux d’hypothèses (efficience faible, semi-forte et forte). Les auteurs remettent ici en cause l’hypothèse d’efficience semi-forte. De manière intuitive, cette hypothèse stipule simplement qu’il n’est pas possible de prédire les rendements des titres financiers par l’observation de variables connues de tous. Autrement dit, l’information publique disponible à chaque instant est parfaitement incorporée dans le prix des actifs financiers. Voir Chapitre 21 du Vernimmen.
(5) M. Baker et J. Wurgler ”A Catering theory of dividends”, Journal of Finance, Juin 2004.
(6) Voir Chapitre 44 du Vernimmen.
Q&R : Qu’en est-il de la liberté de comptabiliser les apports à leur valeur comptable ou à leur valeur réelle dans les comptes sociaux (1) ?
Le 4 mai 2004, le CRC (Comité de Réglementation Comptable) a édicté un règlement qui codifie étroitement le champ des possibles. Il s’appliquera obligatoirement à partir du 1er janvier 2005.
Si les deux entreprises fusionnées sont sous contrôle commun (une maison mère et sa fille, deux sociétés sœurs), l’opération s ’analyse comme une restructuration interne. La fusion est alors comptabilisée sur la base des valeurs comptables. Dans ses comptes sociaux, l’absorbante reprend les actifs et les passifs de la société absorbée pour le montant auquel ces actifs et ces passifs sont inscrits au bilan de la société absorbée à la date d’effet de l’opération.
Si les deux entreprises fusionnées ne sont pas sous contrôle commun, l’opération s’analyse comme une acquisition de l’une des sociétés par l’autre. Dès lors, dans l’optique de se rapprocher des normes IAS et de garantir la cohérence des normes comptables françaises (comptes sociaux / comptes consolidés), les régulateurs comptables auraient souhaité que les actifs et les passifs de la société considérée comme acquise dans la fusion soient systématiquement évalués -et donc comptabilisés- à leur valeur réelle.
Toutefois, en cas de fusion à l’envers (c ’est-à-dire lorsque l’actionnaire de référence de la société absorbée, agissant seul ou de concert, prend le contrôle de la société absorbante), cela aurait nécessité une réévaluation des actifs et passifs de la société absorbante. Mais une telle réévaluation est techniquement impossible au niveau du traité d’apport où seuls les actifs et passifs de la société absorbée peuvent être réévalués.
Dès lors, une opération de fusion de type acquisition n’est enregistrée à la valeur réelle que si elle est à l’endroit, la valeur comptable continuant à s'appliquer pour les fusions à l’envers. Soit en résumé :