La Lettre n°123 de Avril 2014
Actualités : MOOC Analyse financière
Vous avez été plus de 10 000 l’automne dernier à suivre sur 5 semaines le premier MOOC (Massive Open Online Course) en français consacré à l’analyse financière, animé par l’un de nous deux sur la plateforme First Business MOOC.
Une seconde édition commence à partir du 30 avril pour une durée de 4 semaines de cours suivies de 2 semaines de préparation à l’examen final qui, si les résultats sont à la hauteur de vos espoirs, vous permettra de recevoir une Attestation de Réussite, comme pour 850 personnes en décembre dernier. La durée de la phase d’examen a été allongée à 2 semaines vous laissant plus de temps pour bien le préparer et assimiler le contenu du cours qui prend la forme de 18 vidéos d’une dizaine de minutes chacune, de quiz, d’un cas fil rouge et de forums de discussion que nous animons, sans oublier 5 sessions en direct où nous répondons aux questions des participants.
Si vous voulez apprendre ou vous remettre à niveau en analyse financière, l’un des deux piliers de la finance d’entreprise, lire autrement les chapitres 9 à 15 du Vernimmen 2014, ce MOOC qui se termine le 8 juin est fait pour vous. Pour le découvrir plus en détail et vous inscrire, cliquez sur ce lien.
Actualités : Bâle III
Il y a bien longtemps que nous voulions écrire un article sur ce sujet afin de vous présenter factuellement les principales contraintes prudentielles qui s’appliquent aux banques ou vont s’appliquer à elles (Bâle III). Mais la gestation de ces nouvelles règles a été longue, à de nombreuses reprises le projet a été modifié et amendé. Il semble aujourd’hui, presque 5 ans après le sommet du G20 de Pittsburgh qui donna l’impulsion première, que le cadre réglementaire futur soit stabilisé dans ses grandes lignes et que nous puissions le décrire sans trop risquer de devoir faire un amendement majeur dans trois mois.
Le comité de Bâle a été créé en 1974 par les banques centrales des 10 principaux pays du monde occidental de l’époque suite à la faillite d’une banque allemande moyenne, la banque Herstatt, qui, du fait de ses activités hypertrophiées sur le marché des changes, en particulier avec des banques américaines, entraîna une paralysie temporaire du système interbancaire américain. Le nom de comité de Bâle vient du fait qu’il est hébergé par la Banque des règlements internationaux (BRI), basée dans la ville suisse.
Ses trois objectifs étaient de renforcer la sécurité des systèmes bancaires, d‘établir des standards minimaux en matière de contrôle prudentiel des banques et de promouvoir une harmonisation des conditions de concurrence entre les grandes banques. À sa création, le comité de Bâle est une instance de recommandations qui n’acquièrent de force légale que si elles sont adoptées et transposées par les États dans leurs réglementations nationales.
En 1988, un accord est trouvé – on l’appelle Bâle I – qui impose aux banques de disposer d’un minimum de 8 de capitaux propres à chaque fois qu’elles accordent 100 de crédits à une entreprise. C’est le ratio Cooke, du nom du premier président du comité de Bâle. Pour calculer ce ratio, les crédits étaient pondérés à 0 % pour des risques souverains OCDE, à 10 % pour certaines entités du secteur public, à 20 % pour les prêts à des banques OCDE ou les prêts à court terme pour des banques non OCDE et à 100 % pour les autres, en particuliers les entreprises.
Les capitaux propres réglementaires requis sont assez loin de la définition stricte que nous leur donnons[1]. Bâle I distingue en effet un core capital (Tier 1), composé du capital social et des réserves, qui doit représenter au moins 50 % des capitaux propres réglementaires ; et cette première moitié peut être composée à son tour de jusqu’à 50 % d’actions de préférence. Les autres 50 % de capitaux propres réglementaires, appelés Tier 2, peuvent eux aussi se répartir en deux catégories : des instruments perpétuels (Upper Tier 2) et des instruments avec une échéance (Lower Tier 2). Dans le cas extrême, les vrais capitaux propres ne peuvent constituer que le quart des capitaux propres réglementaires et donc 2 % des encours pondérés de crédit. C’est avec cette structure financière que RBS a été autorisé à reprendre sa part d’ABN Amro à l’automne 2007 et c’est sans surprise que celle-ci ne l’a pas beaucoup aidé à affronter la tempête qui déjà menaçait.
Le goodwill et les participations dans d’autres institutions financières sont déduits dans le calcul des capitaux propres réglementaires.
Au total, le ratio Cooke est simple mais fruste : il ne s’intéresse qu’à la solvabilité d’une banque, laissant de côté d’autres sources de fragilité comme la liquidité, les risques de marchés ou opérationnels. De surcroît, sa prise en compte du risque de crédit est simpliste et repose sur l’appartenance de l’emprunteur à des catégories institutionnelles.
* * *
Quelques années plus tard, des faillites bancaires (Barings en 1995), des fraudes de traders (Daïwa en 1995, Sumitomo en 1996) ou des faillites d’États (l’Argentine en 2003) font prendre conscience des limites du ratio Cooke et de l’existence de risques opérationnels et de marché qu’il ne couvre pas. Parallèlement, les progrès de la technologie informatique permettent aux banques de mieux analyser les caractéristiques de leurs actifs et de développer des modèles sophistiqués d’analyse des risques comme la VaR (Value at Risk pour les activités de marché[2]).
Naît alors en 2004 Bâle II, qui est appliqué principalement par les banques européennes (depuis 2008) et les japonaises (depuis 2007), mais pas par les banques américaines, leur régulateur considérant à la vue des études d’impact que Bâle II entraînerait des baisses de capitaux propres réglementaires qu’il trouvait inopportunes.
Bâle II a pour objectifs principaux non d’accroître les capitaux propres réglementaires mais de les proportionner plus finement aux risques pris et de prendre en compte des risques laissés de côté par Bâle I.
Bâle II se compose de 3 piliers :
1/ Une exigence de capitaux propres affinée et ne couvrant plus que le seul risque de crédit mais aussi le risque de marché et les risques opérationnels. Le ratio McDonough succède au ratio Cooke. Il prévoit toujours un ratio de 8 % de capitaux propres réglementaires mais accepte une pondération plus fine en fonction du risque de crédit. Ce dernier est soit estimé par les modèles internes des banques les plus importantes (qui ont démontré pouvoir développer des mesures fiables sur une certaine période de leurs risques de crédit) ou selon une approche standardisée similaire à Bâle I pour les banques les moins importantes. Ainsi un crédit à une entreprise pondéré à 100 % sous Bâle I (et requérant donc 8 % de capitaux propres) peut l’être sous Bâle II à 20, 50, 100 ou 150 % selon son risque perçu et les garanties prises, entraînant un besoin en capitaux propres réglementaires de 1,6 % à 12 % de son montant.
Le risque de marché est pris en compte à travers une pondération forfaitaire des actifs négociés sur un marché selon leur type (approche standardisée) ou selon les modèles de type VaR pour les plus grandes banques.
Le risque opérationnel recoupe les risques de fraudes, de défaillance des systèmes informatiques ou des modèles utilisés, d’incendies, etc. Difficiles à mesurer, les capitaux propres réglementaires qui le couvrent sont le plus souvent estimés forfaitairement à 15 % des revenus annuels.
2/ Le second pilier recoupe tous les risques qui ne sont pas traités par le précédent : risque de mauvaise diversification du portefeuille de crédits, risque de surestimation des valeurs de récupération, risque de gestion actif/passif, risque de liquidité, etc. Certains pays ont décidé d’accroître forfaitairement leurs exigences en capitaux propres réglementaires à ce titre, comme le Royaume-Uni, d’autres pas (France, Allemagne).
3/ Le troisième pilier traite de la discipline que le marché financier peut exercer sur les banques pour autant qu’elles communiquent aux investisseurs des informations pertinentes et en quantité. Il s’agit donc ici essentiellement d’une liste d’informations requises.
Bâle II ne modifie qu’à la marge la définition des capitaux propres réglementaires.
Au total, Bâle II marque un progrès puisque le montant des capitaux propres réglementaires est mieux lié aux risques pris et puisque les risques de marché et opérationnels sont intégrés au raisonnement. Mais ceci au prix d’une complexité fortement accrue, avec un risque de liquidité qui est quasiment ignoré ; et les événements de 2008 vont vite démontrer que le risque de marché est sous-évalué. Il est souvent apprécié à partir de modèles reposant sur la loi normale qui sous-évaluent la fréquence des risques extrêmes[3].
* * *
La crise de 2008 a amené les régulateurs bancaires à prendre conscience que les banques étaient trop endettées, avec des capitaux propres pour partie de mauvaise qualité, sans coussin de liquidité suffisant.
Comme on l’a vu, le passage de Bâle I à Bâle II s’est fait en précisant le mode de calcul des actifs moyens pondérés (AMP) sans changer la définition des capitaux propres. Le passage de Bâle II à Bâle III s’est fait à l’opposé : le mode de calcul des AMP est peu affecté mais la définition des capitaux propres réglementaires est fortement revue et ces derniers sont augmentés en proportion des AMP. Par ailleurs, de nouveaux ratios sont mis en place pour encadrer l’effet de levier et réguler la liquidité des banques.
Bâle III répartit dorénavant les capitaux propres principalement en Common Equity Tier 1 (CET 1), qui comprend le capital social, les primes d’émission, d’apport ou de fusion et les résultats reportés. Les produits hybrides sont tolérés à condition qu’ils puissent être utilisés d’un point de vue comptable et juridique pour absorber des pertes sans devoir passer par le stade de la liquidation de la banque. De ce fait la plupart des quasi capitaux propres, qui n’avaient de capitaux propres que le nom et qui étaient cependant acceptés comme capitaux propres au sens de Bâle II, ne sont plus comptés comme capitaux propres réglementaires. La distinction entre Upper et Lower Tier 2 est abolie, et de facto l’essentiel des capitaux propres des banques doit être constitué de capitaux propres purs et durs (CET 1).
Certes, au pied de la lettre, Bâle III ne demande que 4,5 % de CET 1 minimum avec un Tier 1 de 6 % minimum (y compris CET 1) et donc un Tier 2 de 2 % sur un total de 8 % minimum des actifs moyens pondérés (AMP). Mais Bâle III prévoit 3 coussins de capitaux propres supplémentaires exprimés eux aussi en pourcentage des AMP.
Le premier, obligatoire, est de 2,5 % et trouvera à s’appliquer progressivement entre début 2016 et fin 2018. Dès qu’une banque fonctionne avec un ratio de capitaux propres réglementaires qui tombe en dessous 8 % + 2,5 % = 10,5 % tout en restant au-dessus de 8 %, sa capacité à verser des dividendes et des bonus (ce qui dans cette industrie est factuellement perçu comme plus important que les dividendes) devient dépendante du régulateur bancaire. C’est une contrainte et un stigmate potentiels qui expliquent que les banques qui se sentaient fragiles ont voulu montrer qu’elles étaient de bons élèves et ont devancé l’appel. Les autres ont dû suivre. Ce qui explique aujourd’hui que la plupart des banques ont un CET 1 de l’ordre de 10 %, même si la contrainte réglementaire ne joue qu’à partir de 2019.
Le deuxième coussin de capitaux propres réglementaires est, lui, facultatif. Il est à la main du régulateur bancaire qui peut exiger que, durant les périodes de bonne conjoncture, les banques constituent un matelas supplémentaire de capitaux propres pouvant atteindre 2,5 % des AMP. Cette demande sera supprimée ou allégée durant les phases de mauvaise conjoncture dans lesquelles les profits bancaires risquent de baisser, voire de devenir des pertes. C’est clairement un outil contra cyclique puisque, notre lecteur l’a bien compris, le montant des crédits que les banques peuvent offrir dans l’économie est directement lié au montant de leurs capitaux propres réglementaires. Ainsi en février 2013, le régulateur suisse a imposé un coussin supplémentaire sur les crédits immobiliers sur lesquels il observait une surchauffe.
Le troisième coussin de capitaux propres réglementaires ne concerne, lui, que les plus grandes banques, 29 Sifis (Systematically Important Financial Institutions) à ce jour, qui devront constituer, de 2016 à 2018, un matelas supplémentaire compris entre 1 % et 3,5 % de leurs AMP : 2,5 % pour HSBC et JP Morgan ; 2 % pour Barclays, BNP Paribas, Citi, et Deutsche Bank ; 1,5 % pour Bank of America, Crédit Suisse, Goldman Sachs, Crédit Agricole, etc. ; 1 % pour Bank of China, Santander, BPCE, Société Générale, etc. Les régulateurs nationaux peuvent imposer à leurs banques des matelas similaires même si elles ne font pas partie du groupe des 29 Sifis. C’est ainsi que le Danemark a imposé à certaines de ses banques un coussin supplémentaire de 5 % des AMP.
Bâle III durcit aussi les règles de déductibilité des capitaux propres réglementaires : dorénavant la plupart des actifs incorporels (logiciels, etc.) doivent être déduits ; de même pour les gains que les banques peuvent tirer de la valorisation en valeur de marché de leurs dettes[4].
Au total les banques sont donc de facto requises d’avoir au minimum 10,5 % de leurs AMP en capitaux propres réglementaires dont au minimum 7 % en CET 1,5 % en capitaux propres Tier 1 et 2 % en Tier 2. La plupart couvrent l’essentiel de leurs capitaux propres réglementaires en CET 1, c’est-à-dire avec des vrais capitaux propres.
Prenons l’exemple de BNP Paribas, qui n’a jamais été une banque mal capitalisée. Nous estimons ses AMP 2008 au sens de Bâle III à environ 820 Md€ pour des capitaux propres CET 1 2008 de 29 Md€, soit un ratio de 3,5 %. En 2013 les AMP sont, au sens de Bâle III, de 627 Md€ soit une baisse d’un quart, pour des capitaux propres CET 1 de 65 Md€ (en hausse de 125 %), soit un ratio de 10,3 %. Dans ce cas, un euro d’AMP nécessite donc environ 3 fois plus de capitaux propres réglementaires sous Bâle III que sous Bâle II (et dans ce cas, sans tenir compte de la surcharge Sifi qui ne s’applique qu’à partir de 2016).
Voici pour les ratios de solvabilité.
La complexité de la pondération des actifs des banques en fonction de la perception de leurs risques et l’observation de pratiques de pondération différentes de banques à banques pour le même actif ont nourri la suspicion, en particulier du régulateur bancaire américain, et l’ont conduit à favoriser un ratio de solvabilité sur une base non pondérée. Bâle III l’a repris à son compte sous forme d’un ratio de levier qui se calcule comme le rapport des capitaux propres Tier 1 sur le total du bilan et du hors-bilan de la banque[5]. Celui-ci doit être supérieur à 3 % à partir de 2018, mais il trouve déjà à s’appliquer dans la pratique. Ainsi la Banque d’Angleterre a contraint Barclays à l’été 2013 à procéder à une augmentation de capital afin d’améliorer son ratio de levier.
En réaction à la quasi absence de traitement du sujet crucial de la liquidité par Bâle II, Bâle III introduit deux ratios de liquidité. Le premier est un ratio de liquidité à court terme (LCR, liquidity coverage ratio) qui vise à permettre aux banques de résister pendant au moins 30 jours à des retraits massifs de déposants particuliers et entreprises grâce à un stock d’actifs facilement cessibles et faiblement risqués. Le ratio se calcule donc comme la division du second par les premiers et doit être d’au moins 100 %. Les actifs pris en compte sont à 60 % au moins des liquidités et des titres d’États et pour le solde des obligations d’entreprises cotées au moins AA–, voire des titres cotés plus risqués pour 15 %.
Le second ratio de liquidité restreint la capacité des banques à utiliser des ressources à court terme (moins d’un an) pour financer des engagements à long terme (plus d’un an), c’est-à-dire limite leur capacité à faire de la transformation qui est un de leurs fondements économiques, mais aussi la principale source de leur défaillance (Northern Rock, Dexia, etc.).
Ce ratio, appelé en anglais Net Stable Funding Ratio ou NSFR pour les intimes, se calcule comme le rapport des financements stables disponibles sur les besoins de financement stables et doit être supérieur à 100 %. Son mode de calcul est encore en discussion mais devrait être le suivant dans ses grandes lignes.
Font principalement partie des financements stables disponibles : l’intégralité des capitaux propres réglementaires et des emprunts ou dépôts à plus d’un an, 90 ou 95 % de dépôts à vue ou à terme de moins d’un an des particuliers et des PME, 50 % de dépôts à moins d’un an des grandes entreprises, des États et des entités publiques, et des prêts interbancaires compris entre 6 mois et un an.
Font principalement partie des besoins de financement stables : les immobilisations, les actifs donnés en garantie, les prêts aux banques à plus d’un an, les crédits avec des retards d’échéance ; 5 % des titres émis par un État, une entité publique ou une banque centrale ; 15 % des obligations ou billets de trésorerie d’entreprises notés au moins AA– ; 50 % des prêts à moins d’un an aux particuliers, aux entreprises, aux États, aux entités publiques et banques centrales, des obligations ou billets de trésorerie d’entreprises notés entre A+ et BBB–, des obligations foncières notées au moins AA, des prêts compris entre 6 mois et un an à d‘autres banques ; 65 % des prêts hypothécaires de plus d’un an ; et 85 % des prêts à plus d’un an aux entreprises ou aux particuliers.
* * *
D’une certaine façon, Bâle III témoigne du pragmatisme des banquiers centraux. Ils ont compris que beaucoup de banques étaient devenues trop grosses[6] pour que les États aient les moyens financiers de les sauver à l’avenir, qu’elles seraient toujours en avance d’une innovation par rapport à eux et qu’il serait très difficile de corriger leur culture trop portée à la prise de risques en bonne période économique. À défaut, autant les doter fortement en capitaux propres afin de leur permettre d’absorber de lourdes pertes sans tomber en détresse, et les corseter au niveau de la liquidité, seconde source habituelle de leur défaillance. L’avenir dira si les rubans du corset ont été serrés au bon niveau pour éviter la survenance de crises systémiques.
[1] Dans le chapitre 36 du Vernimmen 2014.
[2] Pour plus de détails sur la Value at Risk, voir le chapitre 54 du Vernimmen.
[3] Pour plus détails, voir La Lettre Vernimmen.net no 122 de février 2014.
[4] Pour plus de détails, voir La Lettre Vernimmen.net no 80 d’octobre 2009.
[5] Il existe toujours une incertitude sur la façon de prendre en compte les dérivés dans le hors bilan, à savoir nettés ou non.
[6] Souvent d’ailleurs parce qu’elles ont racheté en 2008-2009 d’autres banques afin de leur éviter la faillite ou la liquidation (Fortis, Lehman, Bear Stearns, etc.).
Tableau : Pourcentage des salariés couverts par une représentation dans les conseils d'administration des grandes entreprises européennes
Si vous croyez que l’Europe se divise entre le Nord et le Sud ou entre la zone euro et le reste, il va falloir que vous révisiez vos connaissances. En fait, elle se divise entre les pays où les salariés sont très rarement représentés au conseil d’administration et ceux où ils sont très souvent représentés au conseil d’administration.
Ç’en est même caricatural car l’écart entre la Grèce, dernier pays du premier bloc, et la France, premier du second bloc, atteint 30 points soit quasiment la moyenne européenne de 36 % qui, au cas particulier, ne veut rien dire.
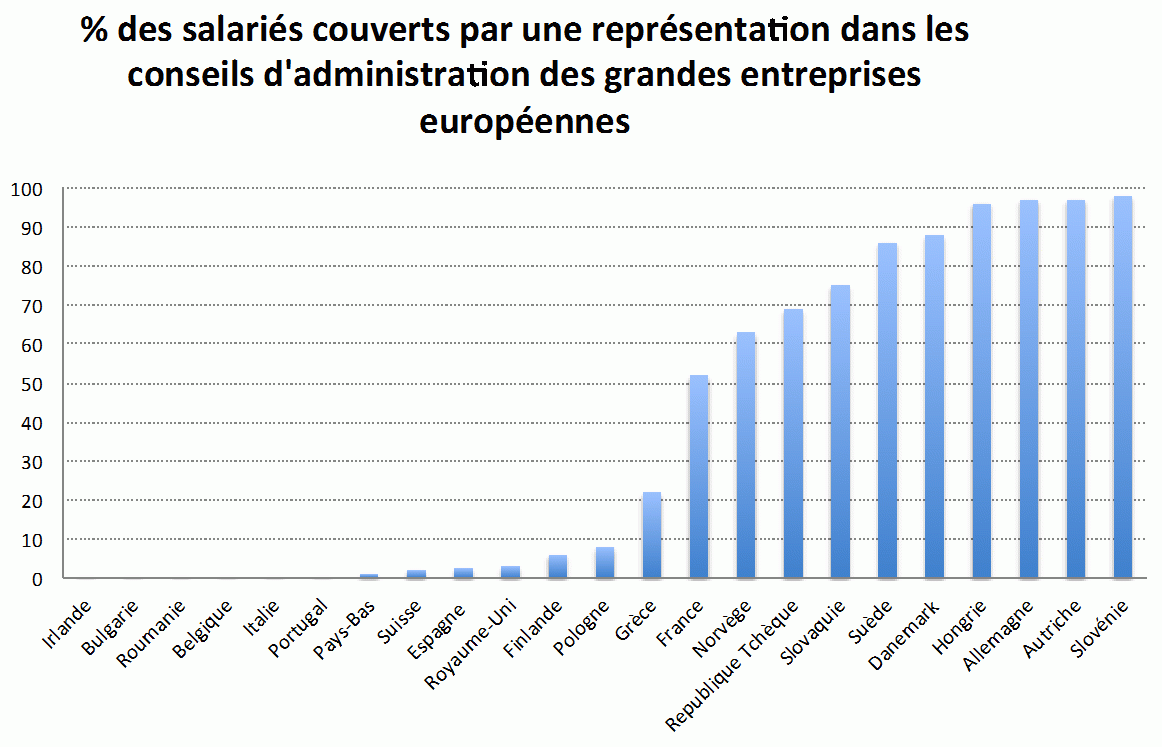
Source : Fédération européenne de l’actionnariat salarié, 2013.
Recherche : L'influence de la situation des prêteurs sur la sévérité des covenants des contrats de prêts
avec la collaboration de Simon Gueguen - Enseignant-chercheur à Paris Dauphine
L’étude scientifique des contrats de prêt nécessite de prendre en compte d’autres éléments que le seul taux d’intérêt. L’article présenté le mois dernier[1] montrait notamment l’impact positif d’un marché de CDS sur les éléments non-prix des contrats (clauses et garanties). De même, l’article que nous présentons ce mois-ci[2] s’intéresse aux déterminants de ces éléments non-prix. Un chercheur de Yale montre que les banques renforcent les clauses des prêts (les fameux covenants[3]) qu’elles accordent lorsqu’elles subissent par ailleurs des défauts de paiement.
La plupart des études portant sur la conception des contrats de prêt se focalisent sur les caractéristiques de l’emprunteur. Lorsque la probabilité de défaut d’un emprunteur est élevée, les prêts qu’il obtient sont non seulement plus chers mais contiennent aussi des clauses plus strictes[4]. Notre article montre que les déterminants de ces clauses se situent également du côté de l’offre : à caractéristiques de l’emprunteur équivalentes, les prêts accordés par les banques qui ont récemment subi un défaut sont plus sévères.
Pour mesurer cela, l’auteur a d’abord construit une mesure de la sévérité des clauses dans les contrats de prêt. Ces clauses consistent à donner la possibilité au prêteur d’exiger le remboursement immédiat ou la renégociation du prêt dès lors que certains seuils (niveau de cash flow, ratios d’endettement…) sont franchis. Sans rentrer dans les détails de la formule, l’article considère les contrats comme plus sévères lorsque la probabilité de déclenchement de l’une quelconque de ces clauses augmente.
Utilisant cette mesure, l’auteur montre que les banques rédigent des contrats plus sévères après avoir subi un défaut dans leur portefeuille de prêts. Cet effet reste valable lorsque le défaut a eu lieu dans un autre secteur et une autre zone géographique que le prêt considéré. L’auteur en déduit que ce défaut ne constitue pas un signal sur la qualité de l’emprunteur, mais une information pour le prêteur sur sa propre capacité à évaluer les risques. La banque qui subit un défaut prend conscience de ses limites dans la sélection des entreprises qu’elle finance ; cette incertitude accrue se traduit par des exigences renforcées en matière de clauses contractuelles. Bien entendu, la survenue d’un défaut se traduit par une diminution des capitaux propres de la banque qui, elle aussi, conduit à resserrer les conditions. Mais l’auteur montre que la prise en compte de cet effet ne supprime pas l’effet informationnel.
Économiquement, l’effet est très significatif. L’étude économétrique porte sur 2 642 contrats de prêt (syndiqués et bilatéraux) d’entreprises américaines non financières auprès de banques entre 1984 et 2008. Une augmentation du nombre de défauts dans le portefeuille de prêts d’une banque de 2,7 (soit un écart-type) a le même impact sur la sévérité des clauses qu’une dégradation d’un cran du rating de l’emprunteur par Standard & Poor’s. Ce résultat est intéressant car il va à l’encontre de l’intuition selon laquelle les caractéristiques des contrats de prêt ne dépendraient que des qualités de l’emprunteur.
Enfin, l’auteur se demande ce qui pousse les emprunteurs à accepter ces contrats plus sévères. Des études précédentes ont montré que les entreprises étaient souvent mieux servies en matière de prêts par un petit groupe de banques sur des relations de long terme que par un marché concurrentiel ouvert de prêteurs. Les entreprises acceptent de conserver leurs prêteurs historiques même lorsque ces derniers renforcent les conditions de prêts.
L’étude montre toutefois que les entreprises dépendantes d’un petit nombre de prêteurs sont davantage sensibles à une dégradation du portefeuille de prêts de leurs banques partenaires que les autres. Ainsi, il y a pour les entreprises un compromis à trouver entre des relations étroites prêteur-emprunteur (afin de réduire les asymétries d’information) et des relations plus indépendantes (afin de ne pas être victime d’une dégradation de la situation des banques partenaires). Une nouvelle illustration de la difficulté d’échapper à cette loi qui veut qu’on ne peut avoir au même moment le beurre et l’argent du beurre . . .
[2] J. MURFIN (2012), “The supply-side determinants of loan contract strictness”, Journal of Finance, vol. 67, no 5, pages 1565 à 1601.
[3] Voir le chapitre 43 du Vernimmen 2014.
[4] Voir par exemple C. DEMIROGLU et C.M. JAMES (2010), “The information content of bank loan covenants”, Review of Financial Studies, vol. 23, pages 3700 à 3737.
Q&R : Pourquoi ne pas prendre la valeur des capitaux propres et non leur montant comptable pour calculer leur rentabilité ?
Parce qu’il ne faut pas mélanger les choux et les carottes !
La rentabilité des capitaux propres est une façon de mesurer la performance de l’entreprise. Soit cette rentabilité est comptable, soit elle est financière.
Si elle est comptable, on rapporte le résultat net de l’entreprise qui revient à ses actionnaires (libre à eux de le distribuer sous forme de dividendes ou de le réinvestir dans l’entreprise) aux capitaux propres de l’entreprise qui ont été apportés par les actionnaires, ou laissés à disposition sous forme de résultats nets passés non distribués en dividendes. On répond ainsi à la question : de combien cette entreprise, sur un exercice donné, a-t-elle fait fructifié les fonds que je lui ai confiés ? Mais cette rentabilité comptable, calculée sur un an, est assez théorique pour l’actionnaire car il ne la touche réellement que si, à la fin de la période, on liquide l’entreprise sans coût, ce qui est heureusement rarement fait.
Elle n’est cependant pas sans intérêt car, comparée à la rentabilité exigée par l’actionnaire, elle permet de mesurer la valeur créée ou détruite sur l’année[1].
Pour pallier son caractère un peu théorique, on peut calculer son pendant financier qui ne prend en compte que des flux de trésorerie effectivement décaissés ou encaissés, sur une période donnée, pas nécessairement l’année mais la période de détention de l’action par l’investisseur. C’est le taux de capitalisation qui permet d’égaler la valeur initiale de l’action et celles des dividendes éventuels versés dans l’intervalle à la valeur actuelle de l’action. C’est le TRI (taux de rentabilité interne) en matière de choix d’investissement que l’on appelle TSR (total shareholder return[2]) au cas particulier. Il répond à la question : de quel taux de rentabilité sur ma période de détention ai-je effectivement bénéficié ?
Taux de rentabilité comptable et TSR divergent le plus souvent. Ainsi en 2013, le SBF 120 a progressé de l’ordre de 20 % de dividendes réinvestis contre environ 15 % pour la rentabilité comptable des capitaux propres. Mais il a chuté de 15 % en 2011, alors que les rentabilités comptables des capitaux propres étaient largement positives. Sur longue période, voire très longue période, les deux doivent converger.
Ramener le résultat net, agrégat comptable, à la valeur des capitaux propres et non au montant comptable des capitaux propres dans un effort improbable de synthèse n’a donc pas de sens. Dans l’immense majorité des cas l’actionnaire ne touche pas le résultat net. Il n’y a donc pas lieu de le rapporter à la valeur actuelle de son investissement qui est la valeur des capitaux propres. Tout au plus ce qui sera mesuré par ce ratio, c’est l’inverse du PER (valeur des capitaux propres / résultat net), mais cela nous fait une belle jambe !






