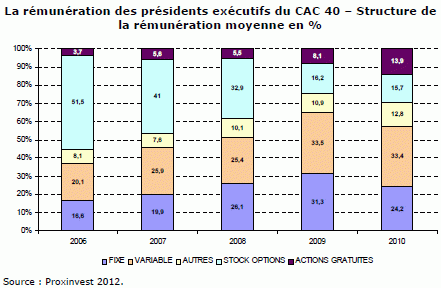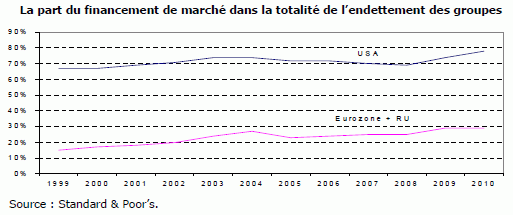La Lettre n°106 de Mars 2012
Actualités : Quelques réflexions sur la rémunération des dirigeants
La rémunération des dirigeants est un sujet sensible (en particulier en période électorale). Toute information relative à ce sujet est relayée et commentée par la presse. Ainsi récemment, la publication par Proxinvest de son rapport sur la rémunération des dirigeants, la recommandation AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants ou l’annonce par le PDG de L’Oréal de l’arrêt de l'octroi de stock options au profit d'actions gratuites ont ravivé les discussions.
Si l’on cherche à exprimer quelques idées simples, on peut rappeler qu’il existe quatre grands leviers de rémunération :
• le salaire fixe,
• la rémunération variable (intéressement et participation liés aux résultats collectifs, primes et bonus plus liés à l'obtention de résultats individuels),
• les rémunérations diverses (voiture, retraite complémentaire, …) et,
• la rémunération directement liée à la performance de l’action (actions gratuites et stock options principalement).
Au-delà de l’aspect moral de la rémunération qui vient compenser un travail (et une prise de risque), la fixation de la rémunération doit répondre aux objectifs suivants :
• attirer initialement les personnes a priori les mieux à même de remplir la fonction ;
• les retenir tant qu’elles donnent satisfaction ;
• s’assurer que leurs intérêts personnels convergent avec ceux des actionnaires.
Notre objet n’est pas ici de disserter sur le niveau absolu de rémunération que l’on peut observer, mais d’apporter une réflexion sur les leviers de rémunération et leur adéquation avec les objectifs recherchés.
Le dernier objectif que nous avons mentionné fait écho à ce que l’on appelle en finance la théorie de l’agence. Cette théorie met en avant que les acteurs de l’entreprise peuvent avoir des intérêts divergents ; les dirigeants peuvent poursuivre des objectifs personnels (taille de l’entreprise, limitation du risque, profit personnel, …) différents de celui des actionnaires (maximisation de la valeur de l’action) (1). Ainsi, un bon système de rémunération permettra de garantir que le dirigeant ait à coeur de maximiser sur le long terme la valeur de l’entreprise.
L’outil traditionnel pour inciter les managers à « bien faire leur travail » est le bonus. C'est-à-dire la part variable de la rémunération payée en cash annuellement. Le bonus est déterminé sur la base de la performance de l’année passée. Il est théoriquement versé si certains objectifs quantitatifs ou qualitatifs ont été atteints. Le caractère variable du bonus est très certainement incitatif, mais ses principes présentent certains défauts. Tout d’abord, il a tendance à s’institutionnaliser et son caractère variable devient alors pour partie théorique. Par ailleurs, la définition des objectifs est complexe : ils doivent être suffisamment précis pour être mesurables et dépendants directement de l’action du management tout en garantissant une maximisation de la valeur sur le long terme et moins sur le court terme.
Pour rendre la rémunération encore plus incitative, un produit a été développé et largement diffusé en Europe depuis les années 1990 : les stocks options. Cet instrument octroyé comme un élément de la rémunération permet en quelque sorte d’indexer la rémunération sur la performance de l’action puisqu'il s'agit d'une option d'achat. Il présente de ce fait l’avantage d’offrir un levier important laissant au dirigeant une perspective de gain très élevée en cas de progression sympathique de la valeur de l'action boursière. Par ailleurs il est théoriquement fortement incitatif car sa valeur peut être nulle en cas de sous-performance. Dit comme ça, il semble être la panacée. Mais est-ce le cas ?
Revenons sur ses principaux inconvénients. Son principal défaut est que sa valeur peut être assez largement déconnectée de la performance relative de l’entreprise. En période d’euphorie boursière, les stocks options pourront prendre une valeur importante, et ce même pour les entreprises gérées de façon médiocre. À l’inverse, en période de morosité économique et boursière, les efforts et les politiques efficaces de certains managers ne seront pas récompensés par un gain sur les stocks options même si de la valeur a été créée.
Autrement dit parce que la variation d'un cours de bourse ne reflète pas les performances de l'entreprise sur la période écoulée mais la variation de la perception de son futur par les investisseurs, un biais est introduit. Ainsi en 2012, 40 % environ des entreprises de l'Eurostox 600 ont un cours de bourse inférieur au niveau de 2000 alors que la plupart ont créé de la valeur pour leurs actionnaires en dégageant des rentabilités économiques supérieures au coût du capital. Simplement ceci ne s'est pas traduit dans les cours de bourse sur cette période, car cela avait été sur anticipé dans la période précédente. Il est d’ailleurs bien possible que ce soit là l'une des raisons qui ont poussé les dirigeants de L’Oréal à renoncer aux stock-options au profit de l'attribution d'actions gratuites.
Mentionnons que le versement de dividende ayant un impact négatif sur la valeur des stocks options, les sociétés ayant attribué des stocks options risquent fort de voir leur management adopter une politique de distribution « prudente » préférant réinvestir afin de faire grossir la valeur plutôt que de la réduire par des dividendes. Au pire ils se résigneront à faire des rachats d'actions. Le principe "action, réaction" étant universel, il n'est pas réservé à François Berléand dans le film Les choristes !
Autrement dit, il est probable qu'une entreprise dont le rythme de croissance se ralentit préfèrera attribuer à l'avenir des actions gratuites qui auront toujours une valeur plutôt que des stock-options qui en vaudront de moins en moins. C'est plus sûr en termes d'incitations et d'efficacité managériale.
L’attribution d’actions gratuites ou « actions de performance » est liée à des critères objectifs qui sont censés refléter l’action effective du management et non les variations de la valeur de l'action : taux de rentabilité comptable minimum, taux de progression du bénéfice par action, etc. Les critères peuvent être non financiers : degré de satisfaction des clients, taux d'accidents du travail, niveau de la part de marché, etc. La valeur de ces actions, une fois acquises grâce à l'atteinte de critères économiques, dépend évidemment de la performance du titre mais, sauf faillite, elle n'est pas nulle comme souvent la valeur des stock-options ces temps-çi.
Ce qui rend le tableau de Proxinvest trompeur puisque la valeur des stock options au moment de l’attribution n’a rien à voir avec la valeur que son bénéficiaire pourra cristalliser ou non correspondant aussi au transfert de valeur éventuel des actionnaires vers ceux qui exercent leurs stock options. La volatilité structurellement moindre des actions par rapport aux options (2) réduit ce biais.
Reste la complexe définition des objectifs… Ceux-ci seront nécessairement différents pour chaque entreprise. Pour un comparatif des critères de création de valeur, nous revoyons notre lecteur au chapitre 32 du Vernimmen. Dans le contexte qui nous intéresse, les critères comptables restent les plus simples à mettre en œuvre.
Au total, l’effacement relatif des stock options au profit des actions gratuites résulte, en France, de la convergence de plusieurs facteurs :
• le politiquement correct (car moins spéculatif et associant directement les bénéficiaires au capital, …) ;
• la fiscalité qui en France favorise les actions gratuites (les cotisations salariales et patronales sont de 2,5 % et 10 % respectivement contre 8 % et 14 % pour les stock options), à condition que l’octroi ne dépasse pas 18 000 € par salarié ;
• le contexte boursier des années 2000 (12 ans après, l’indice Eurostoxx 600 est en retrait de 30 % par rapport à son niveau de 2000), bien différent de celui des années 1980 et 1990 globalement marquées par une euphorie boursière ;
• la difficulté de continuer à trouver de la croissance pour un groupe de taille importante ;
• et ce qui en est le corollaire, la hausse des taux de distribution.
(1) Pour plus de détails sur la théorie de l’agence, voir le chapitre 31 du Vernimmen 2012.
(2) Pour plus de détails sur ce point, voir le chapitre 28 du Vernimmen 2012.
Tableau : La répartition des financements bancaires et de marché
La situation est très différente entre les Etats-Unis où l’endettement de marché procure quasiment 80 % des ressources d’endettement des groupes alors qu’au Royaume-Uni et dans la zone Euro le chiffre n’est que de 30 % environ.
L’explication d’un tel écart est essentiellement historique. Aux Etats-Unis, le marché obligataire s’est créé il y a 150 ans pour permettre le financement des grandes compagnies de chemin de fer, alors qu’il n’a que 13 ans dans la zone Euro.
Echaudé par un long historique de faillites bancaires, le directeur financier américain est incité à se tourner vers les marchés plutôt que vers des banques qui sont là aujourd’hui mais qui pourraient avoir disparu demain. Le mouvement n’est pas près de s’arrêter puisqu’il y a encore 7 000 banques aux Etats-Unis et que la loi empêche de dépasser une part de marché de 10 % par croissance externe, ce qui est un frein à la concentration.
Du coté européen, Bâle III va certainement changer tout ceci dans les années à venir, poussant les entreprises européennes à recourir plus souvent au marché obligataire pour lever des dettes et moins aux banques.
En effet, les nouvelles contraintes de ratio de liquidité des banques vont restreindre considérablement leur activité naturelle de transformation, ce qui réduira leur capacité de prêter aux groupes pouvant accéder au marché. C’est déjà le cas pour de très grands groupes comme Sanofi-Aventis, Siemens ou BAE et cela affectera de plus en plus les groupes de taille plus petite dans le futur proche.
Recherche : Les restructurations après acquisitions
avec la collaboration de Simon Gueguen
Enseignant-chercheur à Paris Dauphine
La volonté de se bâtir un empire (empire building) constitue l’une des principales motivations pour les fusions-acquisitions, d’après la théorie économique (1). Pour des questions de rémunération ou simplement de prestige, les dirigeants auraient tendance à élargir exagérément les frontières de l’entreprise dont ils ont la charge. Un article récent (2) remet en cause la véracité empirique de cette idée par une approche originale.
Cet article montre qu’une acquisition n’est que la première étape d’un processus de redéfinition des frontières de l’entreprise. Pour en mesurer les conséquences à long terme, il est donc nécessaire d’étudier les cessions d’unités de production dans les mois qui suivent l’opération. Les auteurs ont étudié la restructuration des entreprises après une acquisition ; ils montrent que celle-ci répond à une logique d’efficacité économique plutôt que d’empire building.
L’étude combine les données contenues dans une publication annuelle américaine (3) sur la production, l’emploi et les dépenses des unités de production (manufacturing plants) et celles d’une base de fusions-acquisitions sur des cibles américaines, entre 1981 et 2000. L’échantillon peut paraître ancien pour une étude publiée en 2011, mais les auteurs avaient besoin de recul pour mesurer les restructurations dans les années qui suivent l’opération (sans compter les délais de publication !). La période est suffisamment longue pour couvrir deux cycles complets de fusions-acquisitions aux Etats-Unis (4). L’échantillon final contient près de 1 500 opérations de fusions-acquisitions.
Dans les trois ans qui suivent une acquisition totale, 27% des unités acquises sont vendues et 19% sont fermées. En comparaison les entreprises des secteurs concernés par ces opérations, mais qui n’y ont pas participé, vendent 9% et ferment 3% de leurs unités de production sur la même période.
De plus, cette restructuration répond à une logique économique. L’acquéreur conserve en majorité les unités qui se situent dans son activité principale, et il conserve davantage d’unités lorsque sa productivité dans les activités périphériques est élevée. Autrement dit, il cherche à exploiter ses avantages comparatifs. Par ailleurs, la décision de fermer ou de vendre ne dépend que des caractéristiques fondamentales de l’entreprise et de l’unité de production considérée, et non du fait de provenir historiquement de la cible ou de l’acquéreur. C’est bien la logique économique qui prime. Enfin, les auteurs vérifient que la productivité des unités de production acquises et conservées augmente, alors que celle des unités revendues n’augmente pas.
Ces résultats montrent qu’une acquisition ne doit pas être considérée comme une opération instantanée mais plutôt comme le point de départ d’un processus de restructuration qui s’étend sur trois ans environ (5). Sans exclure totalement à court terme l’empire building, sur le long terme ces restructurations sont gouvernées par la rationalité économique. Elles permettent ainsi une meilleure allocation macroéconomique des ressources.
(1) Pour plus de détails, voir le chapitre 47 du Vernimmen 2012.
(2) V. MAKSIMOVIC, G. PHILLIPS et N.R. PRABHALA (2011), Post-merger restructuring and the boundaries of the firm, Journal of Financial Economics, vol.102, pages 317-343.
(2) V. MAKSIMOVIC, G. PHILLIPS et N.R. PRABHALA (2011), Post-merger restructuring and the boundaries of the firm, Journal of Financial Economics, vol.102, pages 317-343.
(3) Annual Survey of Manufactures, gérée par le Census Bureau, institut de statistique de l’administration des Etats-Unis.
(4) Le début des années 80 et le début des années 90 correspondent à des bas de cycle, la fin de chacun de ces décennies à des hauts de cycle.
(5) Les résultats sur 5 ans ne sont pas fondamentalement modifiés ; l’essentiel de la restructuration liée à l’opération est achevé après trois ans.
Q&R : Les réformes fiscales menacent-elles les LBO ?
Le renforcement des contraintes fiscales françaises pour la déductibilité des intérêts dans le cadre d’opérations à effet de levier, les projets de convergence fiscale avec l’Allemagne où les intérêts ne sont fiscalement déductibles qu’à hauteur de 30% de l’excédent brut d’exploitation et des projets de candidats à la présidentielle font parfois dire que les LBO sont menacés. Ceci nous parait procéder d’une erreur de raisonnement majeure.
Le fondement d’un LBO n’est pas la recherche d’une économie fiscale mais la mise en place d’une gouvernance adhoc permettant d’améliorer sensiblement les performances économiques de la société rachetée (1). Les études menées par les chercheurs sur les LBO montrent qu’ils sont le plus souvent créateurs de valeur grâce au développement de l’activité (par croissance organique ou externe), à une meilleure gestion permettant une amélioration des marges, à une sélectivité plus grande des investissements (ce qui ne veut pas dire qu’il s’en fait moins mais mieux), et d’un meilleur contrôle des besoins en fonds de roulement (2). L’économie d’impôt réalisée sur les intérêts de la dette d’acquisition ne contribue que marginalement à la création de valeur.
Le LBO repose d’abord sur une motivation accrue des équipes dirigeantes, garantie d’une part par leur participation directe ou indirecte au capital et donc à la création de valeur, d’autre part par le niveau de dette important qui leur impose de se focaliser sur la génération de cash flows. Bref, c’est le bâton et la carotte !
En dépit de leur image parfois négative auprès d’une partie de l’opinion publique, les LBO sont, le plus souvent, un outil efficace d’amélioration de la compétitivité des entreprises (et en particulier des PME). Différentes études ont même montré leur impact positif sur l’emploi.
Sans l’avantage fiscal de la dette, les prix que les fonds de LBO pourront proposer seront certainement légèrement réduits, tout comme le sera leur compétitivité dans les processus de vente. D’autant que souvent ils sont seuls à se disputer certains actifs sans subir la compétition d’industriels peu intéressés ou contraints par les règles anti-trust ou le désir des vendeurs de ne pas vendre à des concurrents historiques. C’est une preuve de plus de leur utilité.
Sans déductibilité fiscale des intérêts de la dette d’acquisition, le taux de rentabilité espéré baisse de 1,5 % à 2 %, ou le prix payé doit baisser de l’ordre de 7% pour maintenir la même rentabilité. Pas de quoi remettre en cause ce type d’opérations. Ne confondons pas action de lobbying et rigueur intellectuelle . . .
(1) Pour plus de détails, voir le chapitre 49 du Vernimmen 2012.
(2) Voir par exemple la Lettre Vernimmen.net n° 84 de février 2010.