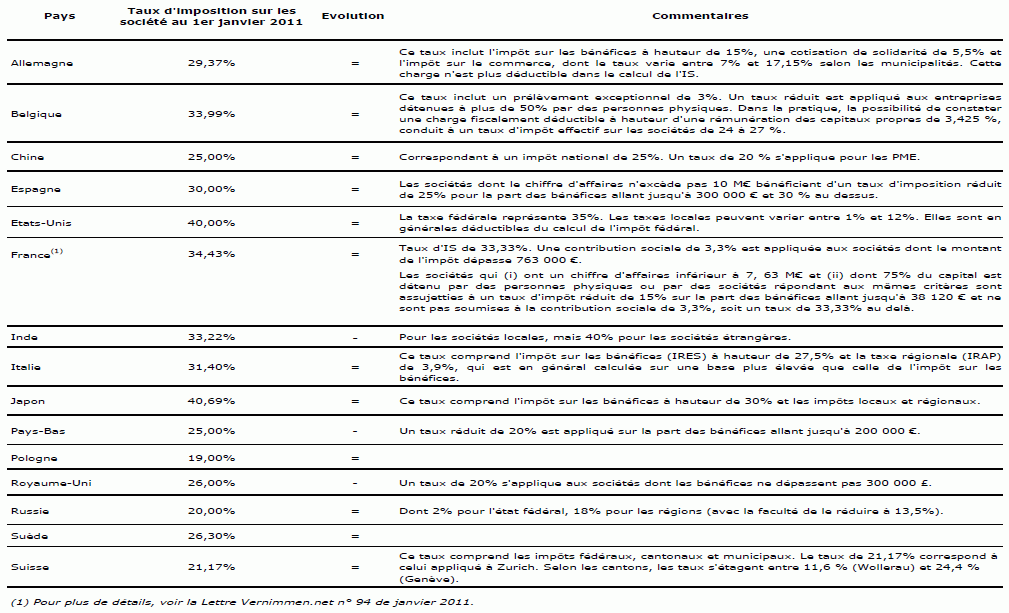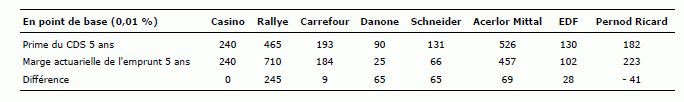La Lettre n°101 de Octobre 2011
Actualités : La nouvelle édition du Vernimmen en anglais
Comme nous vous l’annoncions dans le numéro précédent de la Lettre Vernimmen.net, non content de vous offrir à la rentrée une nouvelle édition à jour du Vernimmen, nous avons aussi publié la 3ème édition du Vernimmen anglais. Elle a plus qu’un air de ressemblance avec la version française, même si elle est plus courte (seulement 1 000 pages !).
Naturellement totalement mise à jour des exemples, statistiques, dispositions comptables, réglementations fiscales, juridiques et autres, elle comprend les nouveaux chapitres que nous avons créés ces deux dernières années dans la version française : l’introduction en bourse, la gestion du besoin en fonds de roulement et les liens entre stratégie et finance.
Elle n’a pas vocation, comme l’édition française, a être publiée tous les ans (ouf de soulagement de nos épouses !), mais tous les 2 – 3 ans.
Pour la découvrir, cliquez ici et la commander ici.
Quelques unes de ces utilisateurs réguliers nous ont fait la gentillesse d’écrire ces lignes la concernant :
“Corporate Finance is a very useful reference book for students and practitioners both of whom will get great help in the present complex environment in understanding the principles of the financial markets and their practical application. The book’s approach is both logical and sequentiall and presents some interesting cases that make study easier and more stimulating.”
GABRIELE GALATERI, CHAIRMAN OF TELECOM ITALIA
“Written in a fluent and readable style and supplemented by numerous real-world examples, “Corporate Finance: Theory and Practice” has served as an excellent aid to my studies of finance. The book’s broad content has been indispensable in acquiring a better understanding of all the core areas of finance, ranging from the basics of financial analysis through to the workings of complex M&A transactions and cutting edge financial products.”
GEOFFREY COOMBS, STUDENT AT ESCP EUROPE
"What sets the Vernimmen apart from other text books is its integration of practice and current affairs in a rigorous theoretical framework. Recipes and pontification are replaced by a scientific approach. And, thanks to the Newsletter, this is done practically in real time!"
CHRISTOPHE EVERS, PROFESSOR OF FINANCE AT THE SOLVAY BRUSSELS SCHOOL, EXECUTIVE DIRECTOR OF TEXAF
"Corporate finance is a lively subject that changes from day to day and evolves regularly, depending on new market developments. The Vernimmen is a true bible of corporate finance. With regular updates through their monthly newsletter and upgrades, the authors have made it applicable to any place, any time. This is pretty unique in the field. "
MEHDI SETHOM, MANAGING DIRECTOR, SWICORP, HEAD OF ADVISORY
Actualités : Réformer la fiscalité ?
Dans un triple contexte d’excès des dépenses publiques par rapport aux recettes (les 366 Md€ de dépenses prévues en France en 2012 représentent 129 % des recettes estimées à 284 Md€), d’importance des prélèvements obligatoires (834 Md€) par rapport à la richesse créée en France et de vives critiques sur leur structure, et enfin d’élections présidentielles ou législatives (proches en Espagne, Etats-Unis, France, Allemagne et Italie), la fiscalité est un sujet qui devrait rester d’actualité au moins quelques trimestres.
Nous avons fait un rêve. Nous voici bombardés ministre des finances avec une Représentation nationale et des citoyens qui ont, tous, de longue date fait du Vernimmen leur livre de chevet.
Oublions que la fiscalité résulte le plus souvent de l’accumulation de mesures contingentes prises sous l’effet de la conjoncture, d’une volonté politique à un instant donné et du poids des intérêts particuliers. Oublions que la fiscalité n’est jamais neutre. Que faisons-nous ?
Nos réflexions, dénuées d’orientations politiques comme vous le constaterez, et naturellement avec une optique financière, c'est-à-dire un adoptant le point de vue de l’entreprise et de l’investisseur et en essayant de raisonner en équité, vont dans six directions indépendantes :
1. D’un point de vue financier, il n’y a pas de raison que l’imposition des revenus du capital (intérêts, plus values, dividendes) diffère de celle des revenus du travail.
Nous avons eu beau chercher, nous n’avons pas trouvé de raison. On pourrait certes dire que souvent le patrimoine résulte de revenus du travail accumulés et déjà taxés une première fois et qu’il conviendrait donc de ne pas les taxer une seconde fois.
Mais cela ne tient pas la route puisque les revenus du travail dépensés en consommation sont taxés une seconde fois par la TVA. L’autre argument souvent avancé - le capital est mobile, le travail l’est moins - et donc le premier mérite qu’on le taxe moins pour éviter qu’il ne fuie, est assez cynique et n’est pas facteur de cohésion sociale. D’autant que les Etats ayant à peu près partout les mêmes problèmes budgétaires, la mobilité fiscale risque de perdre de son attractivité d’autant que la mauvaise presse persistante de la finance, les mouvements des indignés ici et là et les appels des milliardaires à être plus taxés ne vont pas dans le sens d’une moindre imposition des revenus du capital.
2. D’un point de vue financier, il n’y a pas de raison de taxer différemment le revenu de la plus value encaissée.
Comme il est souvent possible de transformer l’un en l’autre par la capitalisation des intérêts (emprunt à coupon zéro (1)), ou par le réinvestissement ou les rachats d’actions qui génèrent des plus values, autant éviter que ces décisions, qui peuvent être lourdes de conséquences économiques, ne soient prises pour des raisons fiscales alors qu’elle devraient l’être pour des raisons économiques ou financières.
3. D’un point de vue financier, il n’y pas de raison que les intérêts et les dividendes soient traités fiscalement différemment au sein de l’entreprise ni au niveau de l’investisseur.
Intérêts et dividendes constituent la rémunération des pourvoyeurs de fonds de l’entreprise qui finance ainsi son actif économique. Au nom de quelle logique faut-il que les intérêts de la dette soient déductibles de la base fiscale de l’entreprise alors que les dividendes ne le sont pas ?
On comprend bien l’influence de la comptabilité qui vise à établir le résultat net revenant aux actionnaires. Dans cette optique, les frais financiers sont une charge et le dividende une répartition du résultat net dont il ne peut pas être par définition comptablement déductible.
La fiscalité n’étant pas systématiquement alignée sur la comptabilité, on peut très bien concevoir de cesser de favoriser par la fiscalité de l’entreprise l’endettement au détriment des capitaux propres. Cet avantage accordé à la dette est un pousse au crime car l’endettement rend plus faibles les entreprises alors que les capitaux propres les confortent (2).
Cette neutralité fiscale par rapport aux sources de financement pourrait être obtenue de deux façons :
• rendre fiscalement déductibles les dividendes versés à l’instar des intérêts. Les entreprises risqueraient assez vite de porter à 100 % leur taux de distribution puis de procéder ensuite à des augmentations de capital pour reconstituer leurs liquidités. D’un point de vue financier, cette évolution, qui redonnerait un pouvoir de contrôle aux actionnaires sur l’utilisation de la capacité d’autofinancement, serait bénéfique et éviterait probablement des gâchis, c’est-à-dire des investissements faits par des dirigeants ayant leurs propres agendas (3). Elle aurait comme inconvénient rédhibitoire de réduire à zéro le produit de l’impôt sur les sociétés. Seule une partie de cette déperdition fiscale pourrait être rattrapée au niveau des actionnaires car tous, tant s’en faut, ne sont pas des résidents fiscaux français et ne sont donc pas imposés en France ou marginalement par le biais de retenues à la source ;
• supprimer la déductibilité fiscale des intérêts. L’Allemagne a entrepris de le faire partiellement il y a quelques années (pour la fraction des frais financiers excédant 30 % de l’EBE). S’il est un moment pour passer à l’acte, c’est maintenant quand les taux d’intérêt sont faibles dans une perspective historique et que les entreprises sont, en moyenne, faiblement endettées.
Techniquement, il faudrait prévoir que les produits financiers soient eux aussi non imposables à hauteur du montant des frais financiers pour éviter de pénaliser indûment ceux qui empruntent pour reprêter (la maison mère dans un groupe, les banques). Seule la marge d’intérêt (si elle est positive) serait alors imposée.
De la même façon, au niveau de l’investisseur, nous ne voyons pas pourquoi les revenus des différents éléments du capital (revenus et plus values, intérêts et dividendes) devraient être imposés différemment (base, taux, abattement), même si depuis quelques années la fiscalité française a réduit les différences de traitement (4). La différence de risque supportée par l’investisseur ne nous parait pas être, en soi, une raison pertinente car elle s’accompagne d’une différence de rentabilité qui la justifie et la compense sans que la fiscalité ait besoin de surcroît de venir à son secours.
Au contraire la fiscalité de l’investisseur, le plus souvent favorable aux capitaux propres, peut pousser des individus à assumer les risques des capitaux propres, guidés par le seul appât d’une moindre imposition, alors qu’ils ne peuvent pas les supporter. Il y a là une certaine part d’irresponsabilité des pouvoirs publics.
Il y a enfin une incohérence entre une fiscalité des entreprises poussant celles-ci à favoriser l’endettement et une fiscalité des particuliers les incitant à investir en capitaux propres. Peut être le législateur a-t-il voulu rétablir, consciemment ou inconsciemment, une neutralité de la fiscalité globale entre dette et capitaux propres ; la fiscalité plus favorable aux capitaux propres au niveau de l’investisseur annulant la fiscalité plus favorable à la dette au niveau de l’entreprise ? Mais dans ce cas, le résultat n’est pas atteint.
La pratique nous a montré que de nombreux financiers d’entreprise survalorisent l’avantage fiscal de la dette et oublient la contrepartie négative au niveau des investisseurs qui la leur font pourtant payer.
Elle nous a aussi fait voir des particuliers peu sophistiqués acheter des actions pour un seul avantage fiscal qui s’avère souvent illusoire (le CAC 40 est actuellement à son niveau de mi-1997).
4. D’un point de vue financier, il n’y a pas de raison de taxer chez les investisseurs les dividendes qui proviennent des résultats déjà taxés au niveau de l’entreprise.
Après tout les actionnaires (ou équivalents) des sociétés fiscalement transparentes (sociétés en nom collectif, OPCVM) sont imposées entre leurs mains sur leur quote part des résultats faits par l’entreprise sans que celle-ci ait été préalablement imposée sur ces mêmes résultats. Pourquoi ce qui est admis pour certains types de sociétés ne serait pas généralisé ?
Les Pouvoirs Publics en sont bien d’ailleurs conscients eux qui créent, suppriment puis recréent des mécanismes (avoir fiscal puis abattements en France, ACT au Royaume-Uni, …), qui limitent partiellement cette double imposition. Mais si le principe est acquis, tous ces systèmes sont bien compliqués. Il suffirait de décider que les dividendes ne sont pas imposables. Mais quel défi pédagogique auprès du grand public !
Heureusement que nous avons commencé par mentionner un principe qui ferait que les plus values sur capitaux propres (y compris celles dues au stock-options) ou sur dettes, que les intérêts des dettes non fiscalement déductibles (celles des Etats, des collectivités publiques, …) seraient imposées selon les mêmes modalités que les revenus du travail …
5. D’un point de vue financier, il n’y a pas de raison d’imposer différemment les bénéfices réinvestis des bénéfices distribués.
Dans les années 1980, l’Allemagne et la France ont connu un régime d’imposition différencié des bénéfices selon qu’ils étaient réinvestis ou distribués. En France, les bénéfices non distribués étaient moins taxés. En Allemagne, c’était l’inverse.
L’investissement n’est pas systématiquement un bien qu’il faudrait favoriser fiscalement. Que l’on pense aux situations de surinvestissement (les bateaux de plaisance dans les DOM-TOM par exemple). De la même façon, la distribution n’est pas un mal qu’il faudrait pénaliser fiscalement pour le réduire, d’autant que la pente naturelle des dirigeants fait qu’ils n’ont pas besoin d’incitations fiscales pour préférer l’autofinancement à la distribution. C’est au contraire un facteur de mobilité du capital, gage d’une meilleure allocation de cette ressource rare. De nouveaux secteurs jaillissent régulièrement qui doivent être impérativement financés par capitaux propres très majoritairement compte tenu de leurs risques. Si ceux-ci sont piégés dans des entreprises pour des raisons fiscales à courte vue et placés comme de la trésorerie à court terme (et donc transformés en dettes), ils ne peuvent pas jouer ce rôle crucial pour le développement économique.
6. D’un point de vue financier, il nous parait bon que la fiscalité sorte de sa neutralité pour avantager le long terme au détriment du court terme.
Dans une société très marqué par le zapping et l’impatience, tout ce qui donne du temps au temps nous parait constituer un utile contrepoids. Ainsi, dans le calcul de l’impôt sur la plus value, le prix de revient des titres cotés pourrait être revalorisé chaque année par un facteur d’érosion monétaire. Ce serait mieux que des taux d’impôt réduits qui s’appliquent de façon assez indifférenciée. Le nombre considérable de déclarations fiscales maintenant faites par Internet rend assez simple cette réalisation.
* * *
L’application conjointe de ces six principes indépendants n’est pas aisée car il y une contradiction entre, d’un coté, vouloir un même traitement fiscal pour le dividende et la plus-value, et de l’autre, ne pas imposer au niveau de l’investisseur les dividendes issus d’un profit après impôt et imposer les plus values.
Disons que dans un monde idéal, les entreprises seraient taxées sur le résultat d’exploitation (majoré des éléments exceptionnels). Au niveau des investisseurs, les plus values encaissées de toute nature et les intérêts de la dette émise par des entités non imposables (les pouvoirs publics) seraient imposés comme les revenus du travail. Les dividendes seraient non imposés car provenant du résultat net qui vient de l’être de même que les intérêts des dettes émises par des entités imposables pour lesquelles ils ne constitueraient pas des éléments déductibles de leur résultat imposable.
* * *
Nous avons bien conscience que la fiscalité peut être guidée par des considérations autres que la pure logique financière et nous espérons que notre lecteur nous pardonnera ce moment d’évasion dans le songe.
(1) Pour plus de détails, voir le chapitre 25 du Vernimmen 2012.
(2) Pour plus de détails, voir le chapitre 40 du Vernimmen 2012.
(3) Pour plus de détails, voir le chapitre 38 du Vernimmen 2012.
(4) Pour plus de détails, voir le chapitre 38 du Vernimmen 2012.
Tableau : Les taux d'IS dans le monde
Le taux moyen d’impôt sur les sociétés dans le monde s’est établi en 2011 à 22,96 % en baisse continue depuis 1993 (38 % ! Mais les pays de l’ex-bloc soviétique ont fait baisser la moyenne d’autant que le périmètre de l’étude de KPMG s’est élargi à de nombreux petits pays qui ont plutôt des faibles taux d’impôt pour attirer les investissements).
En moyenne, tous les continents participent à cette baisse, sauf l’Europe dont le taux moyen remonte marginalement de 0,1 %.
Recherche : De l'impact des dividendes sur l'actionnariat
La politique financière des entreprises répond parfois à des effets de clientèle. Le montant des dividendes versés dépend notamment des préférences des investisseurs (selon leur style, leur information disponible, leur capacité à contrôler les dirigeants…). Il dépend aussi de leur situation fiscale.
Les études économétriques sur ce point ont pourtant donné peu de résultats jusqu’à présent. Elles consistaient la plupart du temps à distinguer les investisseurs individuels des institutionnels, les premiers étant supposés plus averses aux dividendes car subissant une fiscalité plus lourde : ils préfèrent que les résultats soient réinvestis et leur apportent une plus-value, plus faiblement taxée. Les institutionnels, dont la fiscalité est plus neutre entre dividendes et plus-value, devraient donc se trouver relativement en plus grande proportion dans les entreprises qui versent beaucoup de dividendes. Statistiquement, ces effets sont souvent apparus peu significatifs.
L’étude que nous présentons ce mois-ci (1) obtient quant à elle des résultats significatifs. Ceci grâce à une analyse plus fine : les auteurs ont distingué les différents types d’investisseurs institutionnels selon leur aversion supposée aux dividendes.
Par exemple, les compagnies d’assurance ont une faible aversion aux dividendes car leur statut d’entreprise leur permet de bénéficier de déductions fiscales. Au contraire, un gestionnaire de fonds pour grandes fortunes aura une forte aversion aux dividendes du fait de sa clientèle. Il faut préciser que l’étude se concentre sur un échantillon d’entreprises américaines entre 1980 et 1997 (2) ; si les résultats sont vraisemblablement généralisables, leur ampleur exacte sera différente pour d’autres environnements fiscaux.
Les résultats confirment qu’il existe une relation forte entre les préférences fiscales des actionnaires institutionnels et la politique de distribution. Après prise en compte des effets liés à la taille, à la profitabilité ou aux opportunités d’investissement des entreprises, une plus grande part d’institutionnels averses aux dividendes réduit le montant des dividendes versés, ainsi que la probabilité d’initier des versements. Si la proportion d’averses aux dividendes passe de 0% à 100%, le rendement (ou dividend yield(3)) est réduit de 0,4%. Le montant est économiquement significatif, le rendement moyen de l’échantillon se situant autours de 2%.
Le papier étudie ensuite le sens de la causalité : est-ce que les entreprises ajustent leur politique de distribution en fonction des préférences de leurs actionnaires institutionnels, ou est-ce que ce sont ces derniers qui choisissent d’investir ou non dans les entreprises selon leurs pratiques ? Les deux effets semblent présents simultanément.
Les techniques utilisées pour étudier le sens de la causalité sont assez complexes mais très robustes scientifiquement. Concernant le premier effet, les auteurs montrent que les entreprises ajustent leur politique de distribution à une modification des préférences de leurs actionnaires institutionnels, même si cet ajustement se fait à long terme. Pour le second effet, les résultats indiquent qu’une augmentation exogène (4) de 10% du rendement se traduit par une baisse de 19% de la proportion d’actionnaires institutionnels averses aux dividendes.
D’un côté, certains investisseurs sont attentifs aux conséquences fiscales de la politique de distribution des entreprises. De l’autre, les entreprises ajustent leur politique financière en fonction des préférences de leur actionnariat.
Pour plus de détails sur ce sujet, voir le chapitre 41 et 42 du Vernimmen 2012.
(1) M.A.DESAI et L.JIN (2011), Institutional tax clienteles and payout policy, Journal of Financial Economics, n°100, pages 68-84.
(2) L’échantillon peut sembler ancien pour une publication de 2011; les auteurs ont dû se limiter à cette période sur laquelle ils disposaient de données fiables concernant la classification des investisseurs institutionnels.
(3) Ici défini comme le quotient du dividende versé sur le cours de l’action en fin d’année.
(4) C’est-à-dire non liée à une modification des préférences des actionnaires.
Q&R : CDS et coût de financement
Le taux implicite du CDS d’une entreprise à un moment donné représente-t-il son coût du crédit au même moment ?
En théorie oui, en pratique non.
Rappelons d’abord que le Credit Default Swap représente d’abord un outil de couverture du risque crédit d’un émetteur. L’investisseur qui cherche à se protéger contre le risque de défaut d’un émetteur achète une protection auprès d’un vendeur.
L’acheteur, comme dans une police d’assurance, verse au vendeur sur toute la durée du contrat, par exemple 5 ans, une somme fixe trimestrielle qui, exprimée sur une base annuelle en pourcentage du montant assuré, constitue la prime du CDS (comme la prime d’une police d’assurance).
Ainsi, fin octobre 2011 il aurait coûté 90 points de base pour se couvrir contre un risque de défaillance de Danone, soit pour 10 M€ à couvrir par exemple, un paiement de 90 000 € par an.
En cas d’évènements de crédit, c’est-à-dire de défaut prononcé de non paiement en temps et en heure des intérêts ou du capital d’une obligation assurée par un CDS, l’acheteur de la protection règle au vendeur la prime trimestrielle prorata temporis depuis la dernière échéance payée et livre au vendeur l’obligation couverte (c’est-à-dire l’obligation de référence désignée au contrat). En contrepartie, il reçoit du vendeur 100 % du montant nominal de l’obligation.
Des chercheurs ont montré par un raisonnement d’arbitrage que la prime du CDS (1) devrait être égale à la marge actuarielle de l’emprunt obligataire d’échéance équivalente.
Les exemples suivants montrent que cette situation théorique ne s’observe actuellement pas toujours dans la réalité. En général, la prime des CDS est plus élevée que la marge actuarielle de l’emprunt, mais il y a des contres exemples :
Les conditions nécessaires à la réalisation de l’arbitrage ne sont en effet pas toujours réalisées. En effet, la liquidité sur les obligations des entreprises est faible car les investisseurs portent souvent les obligations émises jusqu’à échéance.
Du fait de cette faible liquidité du sous jacent qui restreint les possibilités de vente, les investisseurs qui veulent se protéger sont conduits à acheter des CDS. Et ils peuvent être rejoints dans ce mouvement d’achat par les détenteurs de crédit sur l’émetteur.
L’appréciation du risque par les obligations et les banquiers peut aussi être différente, d’où une source de différence supplémentaire.
Et la liquidité des CDS, marché de gré à gré, n’est pas toujours claire.
Parallèlement, la situation grecque a créé, là aussi, des perturbations. En effet, les détenteurs de dette de l’Etat grec subissent sur leurs obligations une moins value de plus de 50 % en prenant en compte une valeur de marché, certes très sujette à caution car le volume des transactions s’est spectaculairement tari sur ces obligations, mais qui fait sérieusement douter de la capacité de la Grèce à assurer à 100 % le remboursement de 100 % de ses dettes.
Néanmoins, comme aux yeux de la pratique gouvernant les CDS, la Grèce n’a pas fait formellement défaut, le détenteur de l’obligation grecque ne peut pas récupérer au titre du CDS ce qu’il perd sur l’obligation. Sa couverture par le CDS s’avère donc moins efficace qu’anticipé.
Chat échaudé craignant l’eau chaude, les détenteurs de dettes d’autres pays qui craignent pour la valeur de leurs créances se disent que si l’Etat ne peut pas faire officiellement faillite compte tenu de la solidarité européenne, les banques de ce pays peuvent faire faillite. Et le CDS d’une banque jouerait alors plus efficacement son rôle de couverture que celui de l’Etat.
Aussi, pour couvrir le risque pesant sur les obligations de ce pays, les investisseurs achètent les CDS des banques de ce pays. La prime du CDS se déconnecte alors de la marge actuarielle payée sur leurs emprunts, d’autant que les obligations sous jacentes des banques sont trop peu liquides pour permettre à des arbitrages de refaire converger vers l’équilibre la prime du CDS et la marge actuarielle.
(1) Pour la démonstration simple, voir le travail de Emmeline Travers en cliquant ici.